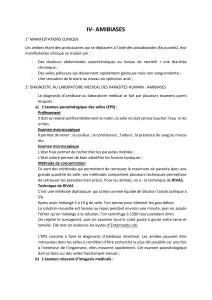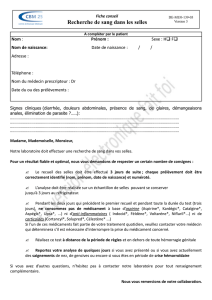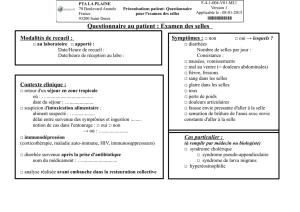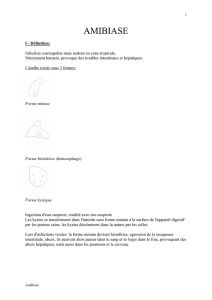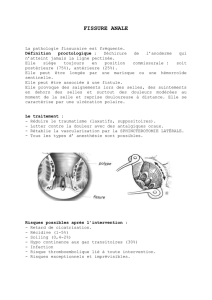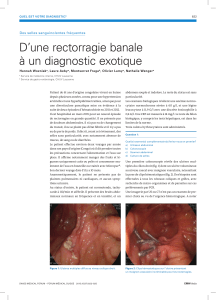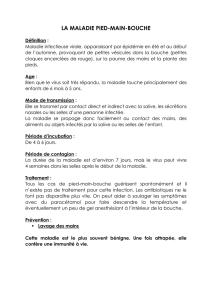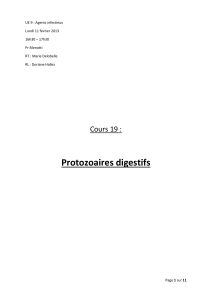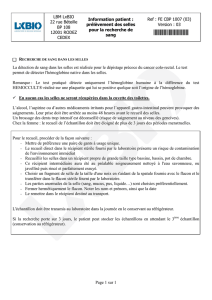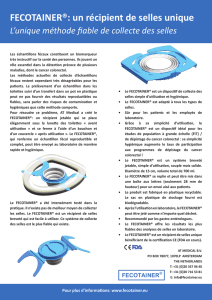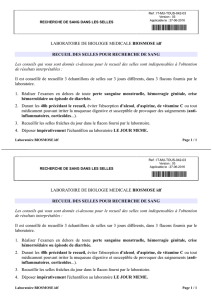Lire l`article complet

Dossier thématique
Dossier thématique
140
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007
POINTS FORTS
Il existe une hyperéosinophilie dans les helminthiases
digestives :
En France
Dans les pays tropicaux
et tempérés chauds
Distomatose En plus des parasitoses cosmopolites
Ascaridiose Anguillulose
Tæniasis avant émission d’anneaux Ankylostomose
Trichinose Bilharziose intestinale et urinaire
Toxocarose Rupture de kyste hydatique
Trichocéphalose
Oxyurose
Il n’y a pas d’hyperéosinophilie dans les protozooses
(amibiase intestinale et hépatique).
L’amibiase intestinale aiguë est due à Entamœba histolytica
hématophage, seule amibe pathogène.
Pour tout patient présentant une éosinophilie supérieure
à 500/mm3 ou ayant séjourné (même il y a longtemps) dans
une zone tropicale ou chaude, il faut rechercher une anguillule
par la technique de Baermann dans un laboratoire spécialisé
en parasitologie, surtout s’il doit recevoir une corticothérapie
en raison du risque mortel d’anguillulose maligne.
Chaque parasitose a un traitement spéci que ; cela implique
d’en faire la preuve au mieux par un examen parasitologique
direct, en adaptant les recherches et les concentrations en
fonction de la parasitose suspectée.
Mots-clés : Parasitose – Diarrhée du voyageur – Examen
parasitologique.
Keywords: Parasitosis – Travellers’ diarrhoea – Parasitologie
investigation.
왘
왘
왘
왘
왘
왘
C
e chapitre vise à répondre de façon pratique à l’attente
des gastroentérologues lors d’une consultation et ne s’at-
tache pas à détailler chaque parasitose, ni les examens
complémentaires tels que l’imagerie. Plusieurs motifs et signes
d’appel peuvent orienter le clinicien vers une parasitose digestive
tropicale : symptomatologie, origine géographique du patient,
facteurs de risque, signes biologiques. Tous ces éléments sont
à prendre en compte pour apporter une réponse pertinente
lors de la demande d’examens biologiques. L’interprétation des
résultats est aussi un aspect non négligeable, car elle conditionne
la conduite à tenir pour la répétition éventuelle d’examens dans
des laboratoires spécialisés. Enfi n, un tableau synthétique résu-
mera les possibilités thérapeutiques.
QUE DOITON FAIRE PRÉCISER AU PATIENT
LORS DE L’INTERROGATOIRE ?
Au cours de l’interrogatoire, il faut demander au patient s’il a
séjourné en zone tropicale, récemment ou non (l’anguillulose peut
persister à vie), combien de temps et de quand date son retour. Il
faut faire préciser des comportements à risque qui peuvent orienter
le diagnostic : baignade en eau de rivière (bilharziose), voyage “sac à
dos”, absence de règles hygiénodiététiques (protozooses : amibiase,
giardiose, coccidioses), marche pieds nus dans l’eau ou la boue
(anguillule, ankylostome), consommation de viande de bœuf
ou de porc (tæniasis et cysticercose), consommation de suidés,
de viande de cheval (trichinose), de poissons insuffi samment
cuits tels les sushis ou le ceviche (anisakiase), de poissons des lacs
(bothriocéphalose), consommation de cresson ou de pissenlit, ou
de toute autre plante aquatique sauvage (douve).
QUAND FAUTIL PENSER À UNE PARASITOSE CHEZ
UN PATIENT DE RETOUR D’UN PAYS TROPICAL ?
Devant une diarrhée qui persiste et qui résiste au traite-
ment antibactérien, sans fi èvre habituellement. L’amibiase
intestinale aiguë est la pathologie tropicale qu’il faut suspecter
d’emblée, notamment lorsque la diarrhée est accompagnée de
signes évocateurs : douleurs abdominales modérées (épreintes),
glaires mucopurulentes striées de sang, appelées crachats
rectaux, ou de selles franchement sanglantes.
D’autres étiologies parasitaires sont à envisager lors d’une diarrhée
hydroélectrolytique persistante avec des signes de malabsorption,
왘
Parasitoses digestives tropicales
Tropical digestive parasitosis
쐌쎲 Claudine Sarfati*
*Service de parasitologie-mycologie, hôpital Saint-Louis, université Paris VII - Denis Diderot,
Paris.
>>>

Dossier thématique
Dossier thématique
141
Photo 1.
Oxyure vu en coloscopie.
Photo 2.
Anneau de tænia et adulte.
Photo 3.
Ascaris adultes mâle et femelle (la plus longue).
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007
en particulier la giardiose, parasitose cosmopolite, les cocci-
dioses tropicales à Isospora belli et à Cyclospora sp. Il faudra
aussi considérer la possibilité d’une contamination par une autre
coccidiose, la cryptosporidiose ainsi que la microsporidiose,
toutes deux cosmopolites, en sachant que ces deux dernières
aff ections, bien que mieux connues chez les patients VIH, ne
sont néanmoins pas l’apanage des sujets immunodéprimés.
Il ne faudra pas oublier qu’une fi èvre accompagnée de troubles
digestifs à type de diarrhée chez un patient au retour d’un pays
tropical doit faire systématiquement rechercher un accès palustre
et demander en urgence un frottis et goutte épaisse.
Les autres symptomatologies à type de constipation ou d’alter-
nance de diarrhée et de constipation n’ont rien de spécifi que et
n’orientent pas le diagnostic. Néanmoins, une douleur gastrique
vive dans les heures suivant l’ingestion de poisson cru doit faire
rechercher une
anisakiase
. Des douleurs à type d’hépatalgies, en
dehors de l’amibiase hépatique, orientent plus particulièrement
vers deux autres parasitoses : distomatose ou kyste hydatique.
Un syndrome de Löffl er associant toux, dyspnée et infi ltrat
pulmonaire labile fera rechercher une ascaridiose en phase de
migration larvaire par examen sérologique, un pseudo-Löffl er
évoquera une ankylostomose et une anguillulose, un larva
currens, migration larvaire sous-cutanée visible au niveau des
fesses et des lombes, fera suspecter une anguillulose.
Devant la présence d’un élément macroscopique évoquant
un parasite pour le patient, il convient de demander au patient
d’isoler ce “parasite”, et de le conserver dans un récipient trans-
parent, non stérile, si possible dans de l’alcool à 70° ou 90° dilué
dans de l’eau, afi n de l’identifi er. Les parasites sont très facilement
identifi ables en fonction de leur taille et de leur forme :
– l’oxyure (photo 1) est un parasite cosmopolite très fréquent
chez l’enfant. Ses caractéristiques : 1 cm à 1,5 cm, blanc, vivant,
découvert à la surface des selles, sur la marge anale ;
왘
– l’anneau de tænia (photo 2), fragment d’un ver plat segmenté,
comparé par le patient à une tagliatelle, mobile, franchissant
activement le sphincter anal (tænia saginata du bœuf, mélangé
aux selles pour le tænia solium du porc), blanc, de 2 cm de long
sur 7 mm de large ;
– l’ascaris (photo 3) gros ver rond, blanc rosé, de 15 à 25 centi-
mètres de long, ressemblant à un ver de terre, émis dans les
selles ou lors de vomissements.

Dossier thématique
Dossier thématique
142
Photo 4.
Forme végétative d’Entamœba histolytica hémato-
phage (hématie dans le cytoplasme) ; grossissement x 400.
Photo 5.
Biopsie rectale à Schistosoma hematobium ; grossis-
sement x 400.
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007
Devant un patient adressé pour la découverte d’une éosi-
nophilie supérieure à 500 éléments/mm3. Le pourcentage
d’éosinophiles pris isolément n’a aucune signifi cation ; seule la
valeur absolue d’éosinophiles sera prise en compte, notamment
chez les Africains, habituellement neutropéniques. Après avoir
éliminé une étiologie allergique ou médicamenteuse, il convient
de rechercher une étiologie parasitaire avant d’entreprendre
d’autres investigations.
Seules les helminthiases induisent une éosinophilie élevée.
Elles comprennent les nématodes, les trématodes et les
cestodes, dont la liste ci-dessous permet d’orienter l’inter-
rogatoire et la recherche plus particulière d’une parasitose
digestive :
– les nématodes :
parasitoses cosmopolites
• ascaris de l’homme responsable de l’ascaridiose ;
• ascaris des animaux, la toxocarose, responsable d’un larva
migrans viscéral ;
• trichine ;
• anisakis ;
• oxyure ;
• trichocéphale.
parasitoses exclusivement tropicales
• ankylostome ;
• anguillule.
– les trématodes (douves hépatiques, intestinales tropicales ou
cosmopolites, bilharzies exclusivement tropicales).
– les cestodes (Tænia saginata, T. solium et la cysticercose,
sa forme larvaire ; Ecchinoccocus granulosus, tænia du chien
responsable de l’hydatidose ou kyste hydatique ; Ecchinoccocus
multilocularis, tænia du renard, responsable d’une aff ection très
proche d’un cancer du foie, l’échinoccocose alvéolaire, Hyme-
nolepis nana, petit tænia, fréquent chez l’enfant en Afrique du
Nord, à transmission interhumaine ou par les vers de farine,
Dyphilobothrium latum, tænia lié à la consommation de poissons
de lacs dans les régions tempérées, responsable de la bothrio-
céphalose).
En revanche, les protozooses comme Entamœba histolytica,
responsable de l’amibiase intestinale et hépatique, ne donnent
jamais d’hyperéosinophilie. Le kyste hydatique se révèle par une
hyperéosinophilie lors de la fi ssuration du kyste.
L’éosinophilie est variable en fonction du cycle parasitaire :
minime lors d’un cycle direct court sans migration larvaire
(oxyurose, trichocéphalose), plus élevée et parfois supérieure
à 1 500 éosinophiles/mm3 au cours de la migration larvaire lors
d’un cycle long. Elle évolue en fonction du délai entre la conta-
mination et l’apparition des symptômes : maximale lors de la
phase de migration du parasite avant l’émission des œufs et des
larves, elle décroît lors de la phase adulte du parasite. Après un
taux maximal lors de la contamination, elle se poursuit en dents
de scie dans l’anguillulose.
D’autres anomalies biologiques devront orienter vers une
ankylostomose ou une trichocéphalose devant une anémie
microcytaire, et vers une bothriocéphalose devant une anémie
macrocytaire avec défi cit en vitamine B12.
왘
왘
QUEL EST LE RÔLE DE L’ENDOSCOPIE
EN PARASITOLOGIE ?
La rectoscopie peut révéler des lésions en coup d’ongle dans
l’amibiase intestinale aiguë, et ainsi permettre la mise en
évidence de l’amibe hématophage par un examen immédiat dans
du sérum physiologique, entre lame et lamelle, des sécrétions
prélevées au niveau des lésions (photo 4). La biopsie rectale,
eff ectuée lors de la rectoscopie, permet le diagnostic de bilhar-
ziose (photo 5) quelle qu’en soit l’espèce, urinaire ou digestive. La
biopsie réalisée est à adresser dans un pot non stérile, dans une
goutte de sérum physiologique, surtout sans milieu de fi xation,
en parasitologie et non pas en anatomopathologie.
Les autres biopsies digestives adressées en parasitologie ne
doivent pas être desséchées afi n de pouvoir réaliser des examens
à frais entre lame et lamelle (formes végétatives vivantes de
Giardia) et des appositions en vue de colorations spécifi ques. Si
les biopsies duodénales et jéjunales de bonne qualité permettent
de diagnostiquer giardiose, cryptosporidiose, microsporidiose,
isosporose, cyclosporose, la recherche de ces parasites dans

Dossier thématique
Dossier thématique
143
Photo 6.
Douve hépatique dans la vésicule biliaire vue en
échoendoscopie. Remerciements au Dr Alain Aubert (hôpital
Saint-Louis, AP-HP).
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007
les selles reste beaucoup plus simple et doit être eff ectuée en
premier lieu.
L’échoendoscopie pour visualiser les canaux biliaires est d’un
grand intérêt pour le diagnostic des distomatoses à Fasciola
hepatica. Elle permet de visualiser le parasite mobile dans les
voies biliaires (photo 6).
Enfi n, des éléments parasitaires sont parfois découverts à l’oc-
casion d’une endoscopie : tænia et ascaris dans l’intestin grêle,
oxyure et trichocéphale dans le cæcum, larves d’anisakis, ver
rond blanc rosé de 2 à 4 cm, dans la paroi gastrique.
LES EXAMENS DE LABORATOIRE
Faut-il en demander en urgence ? Quels examens demander ?
Les demandes systématiques sont-elles utiles ? Quelle est leur
pertinence ? Faut-il répéter les examens parasitologiques des selles
3 jours de suite ? Quel est le rendement ? Comment interpréter
les résultats ? Autant de questions qui méritent d’être traitées
séparément.
QUAND FAIRE LES EXAMENS DE LABORATOIRE ?
Une seule urgence : l’amibiase, intestinale aiguë et/ou hépa-
tique. Il faut demander en urgence un examen parasitologique
des selles sur des selles fraîchement émises, mieux encore dans
les crachats rectaux. L’amibe hématophage responsable meurt
dans l’heure qui suit l’émission des selles, et les concentrations
ne permettent pas de la mettre en évidence ultérieurement. Alors
que la sérologie amibienne n’est pas très utile à ce stade, elle prend
toute sa valeur au cours de l’amibiase hépatique, toujours secon-
daire ou concomitante à une amibiase intestinale, suspectée lors de
douleurs hépatiques, d’une fi èvre, d’un syndrome infl ammatoire.
La sérologie doit alors être demandée en urgence, et le premier
résultat de l’hémagglutination rendu dans les 3 heures. Cette
왘
왘
sérologie est très sensible et spécifi que. En revanche, l’examen
parasitologique des selles n’est pas toujours contributif ; il pourra
toutefois mettre en évidence la présence d’amibe
Entamœba
histolytica hématophage ou d’amibe Entamœba histolytica sous
sa forme végétative ou kystique, ou ne révéler aucune amibe.
Les délais d’apparition des œufs ou des larves permettant
de faire un diagnostic varient en fonction de chaque parasite ;
ainsi, les larves d’anguillules sont mises en évidence après un
peu moins d’un mois, les œufs d’ascaris après 2 à 3 mois, les
embryophores de tænia après 3 à 4 mois, les œufs de douve ou
de bilharziose après 3 mois. Il est donc nécessaire de répéter
les recherches si l’examen a été réalisé prématurément, ce qui
peut arriver chez les patients européens inquiets à la suite d’un
comportement à risque au retour d’un pays tropical.
QUE DEMANDER ET QU’ATTENDRE DES EXAMENS
DE LABORATOIRE ?
La demande d’examen doit systématiquement être accompa-
gnée de renseignements concernant le patient : provenance
géographique, séjour – même ancien – en pays tropical, symp-
tômes, facteurs de risque (immunodépression), traitements
corticoïdes.
Deux types d’examen peuvent être envisagés : les sérologies,
l’examen parasitologique des selles et non pas une coproculture
demandée pour la recherche d’une étiologie bactérienne :
– les examens sérologiques sont utiles dans la phase de migration
larvaire et parfois indispensables, car seuls à permettre le diagnostic
(trichinose, toxocarose, kyste hydatique ± distomatose) ;
– l’examen toujours indispensable est l’examen parasitologique
des selles, ainsi que des urines éventuellement.
Que faut-il préciser pour l’examen parasitologique
des selles (EPS) ?
Il faut recommander au patient d’apporter au laboratoire des
selles fraîchement émises, en grande quantité de façon à pouvoir
réaliser plusieurs concentrations. Faut-il répéter l’examen trois
jours de suite ? Non : il faut attendre le premier résultat, qui peut
déjà permettre le diagnostic de parasitose digestive ; néanmoins,
il faut le demander à nouveau si la suspicion persiste, et dans un
laboratoire spécialisé en parasitologie. L’émission inconstante de
certains parasites nécessite de renouveler l’examen avec un délai
de plusieurs jours entre deux examens ; c’est le cas pour Giardia,
Isospora belli, Cryptosporidium sp. La bilharziose est une aff ec-
tion au cours de laquelle les œufs logés dans la muqueuse sont
éliminés en petite quantité dans les selles ou les urines et de façon
irrégulière. Il convient alors de répéter trois fois l’examen pour
faire la preuve d’une parasitose active, surtout si la sérologie bilhar-
zienne s’est révélée positive. La recherche d’anguillule, parasitose
tropicale qui peut persister même très longtemps après un séjour
en zone d’endémie, n’est pas systématiquement eff ectuée, faute
de renseignements concernant la provenance géographique. La
technique de Baermann, indispensable pour sa recherche, n’est
habituellement pas réalisée dans les laboratoires de ville.
왘

Dossier thématique
Dossier thématique
144
Photo 7.
Anisakis vu en broscopie œso-gastroduodénale.
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007
Comment interpréter les résultats de l’EPS ?
Il faut en premier lieu s’assurer que l’examen direct à frais
a bien été réalisé, que deux techniques de concentration ont
été eff ectuées, ainsi qu’une technique de Baermann pour la
recherche d’anguillule si le patient a séjourné en zone tropicale,
et enfi n que des colorations spécifi ques ont été réalisées lors de
diarrhées inexpliquées.
왘
Les amibes se présentent sous forme végétative vivantes, mobiles,
ou sous forme kystique. Une seule est pathogène : Entamœba
histolytica hématophage, et seuls deux fl agellés sont pathogènes :
Giardia intestinalis et Dientamœba fragilis. Le Chilomastix,
autre fl agellé, peut éventuellement être à l’origine d’une entérocolite.
Ainsi, les amibes et fl agellés suivants, témoins d’une contamination
orale par l’eau ou les aliments, ne sont pas pathogènes : Entamœba
coli, Entamœba hartmanii, Endolimax nana, Pseudolimax butchlii,
Trichomonas intestinalis, Retortamonas, Enteromonas.
Comment interpréter le résultat suivant : présence d’une forme
végétative et/ou kystique d’Entamœba histolytica/Entamœba
dispar (E.h/E.d) ? La fréquence d’isolement de ces deux amibes
est de l’ordre de 1 %. Elles peuvent coloniser le tube digestif. E.d
n’est jamais pathogène, E.h peut le devenir : sa forme végétative
grossit, acquiert des propriétés protéolytiques et hématophages ;
elle est alors responsable de l’amibiase intestinale aiguë et, secon-
dairement, de l’amibiase hépatique. Des techniques de recherche
par ELISA et PCR, non eff ectuées en routine, permettent la
diff érenciation morphologique de ces deux espèces. Une étude
eff ectuée en Hollande a montré qu’une sérologie serait positive
en présence d’E.h, ce qui pourrait permettre d’orienter le trai-
tement avec une sensibilité supérieure à 80 % et une spécifi cité
supérieure à 96 % (1).
Les cristaux de Charcot-Leyden sont le témoin d’une éosino-
philie digestive qui n’est pas corrélée à une hyperéosinophilie
sanguine ; elle doit néanmoins faire rechercher une helminthiase,
telle l’anguillulose, et une isosporose.
Les Blastocystis hominis signalés, lorsqu’ils sont présents en
grand nombre, peuvent être traités en fonction de la sympto-
matologie. ■
왘
왘
왘
왘
Tableau.
Quel traitement pour quelle parasitose ?
Protozooses Amibiase :
E.h hématophage
E.h infestation
Métronidazole : Flagyl® 6 à 8 cp/10 j + Intetrix® 2 à 3 cp x 2, 10 à 20 j
Tinidazole : Fasigyne® 500 4 cp en 1 prise, 2 j
Tibroquinol : Intetrix® seul 2 g/j, 10 j
Giardia intestinalis Métronidazole : Flagyl® 500 mg x 3, 5 j
Albendazole : Zentel® 400 mg/ j, 5 j
Isosporose : Isospora belli Triméthoprime sulfaméthoxazole : Bactrim fort®
4 cp/j, 10 j. Si VIH : 3 semaines, puis 2 cp/2 semaines
Cyclospora sp Bactrim fort®, 2 cp/j, 7 j
Cryptosporidium sp Nitazoxanide : Alinia® 2 g/j, 30 j
Rifaximin : Xifaxan®
Dientamœba fragilis Métronidazole, tétracyclines 2 g/j, 10 j
Blastocystis hominis Flagyl® 2 g/j, 7 j
Tinidazole : Fasigyne® 500, 2 g en 2 prises/1 j
Microsporidiose Microsporidie Fumagilline : Flisint® 1 gél. 3 x /j, 14 j en ATU (Enterocytozoon bieneusi)
Albendazole (Encephalitozoon)
Nématodoses Oxyure Flubendazole 100 mg 1 cp pour toute la famille (Fluvermal®)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%