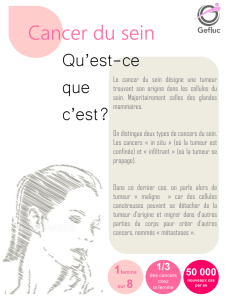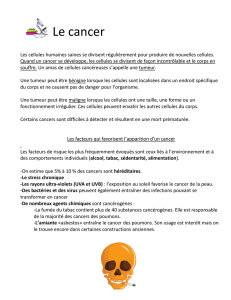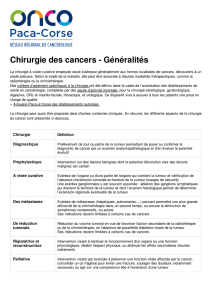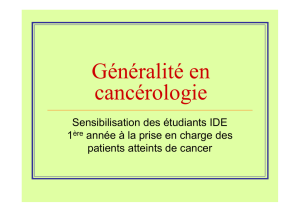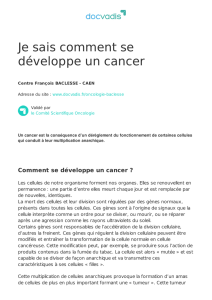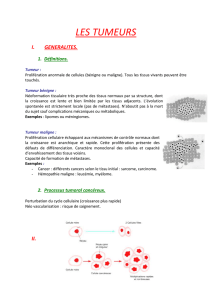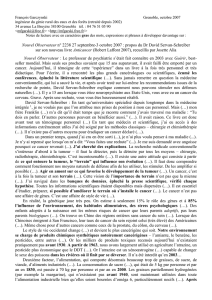Télécharger le dossier de presse

OCTOBRE 2016
UN DOSSIER DE L’IPC
CANCER DU SEIN :
GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX

CANCER DU SEIN : GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX
I - L’ONCOGENÈSE MAMMAIRE : UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE
DE MIEUX EN MIEUX COMPRIS ET UNE AUTRE FAÇON DE « PENSER » LA TUMEUR 4
II - AUGMENTER LE TAUX MOYEN DE GUÉRISON AU-DELÀ DES 90 % 5
III - BIEN CARACTÉRISER, À TEMPS, LE CANCER DE CHAQUE PATIENTE 6
IV - UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DES MALADIES D’ORIGINE FAMILIALE 7
V - LES GÈNES DE PRÉDISPOSITION : QUOI DE NEUF ? 7
VI - ANTICIPER LES RECHUTES 8
VII - POUR LES CANCERS DU SEIN LOCALISÉS, LA DÉSESCALADE THÉRAPEUTIQUE 9
VIII - DÉVELOPPER LES RCP DE MÉDECINE MOLÉCULAIRE ET PRÉDICTIVE 10
IX – LA PISTE DES CELLULES SOUCHES 11
X - COMPRENDRE LES MÉCANISMES D’ÉCHAPPEMENT DE LA TUMEUR
FACE AU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LES CONTRER GRÂCE À L’IMMUNOTHÉRAPIE 12
2

CANCER DU SEIN : GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX
4
CANCER DU SEIN : GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX
Le cancer du sein se soigne de mieux en mieux. Selon l’INCa, l’Institut national du cancer, la
mortalité par cancer du sein a globalement diminué de 1,5 % par an entre 2005 et 2012 en
France. Et aujourd’hui, les taux moyens de guérison approchent les 90 % pour les formes lo-
calisées de cancer du sein.
Pour continuer à progresser dans la prise en charge, lutter contre les 10 % d’échecs, mieux
traiter les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique ou localement avancé, réfrac-
taire aux médicaments classiques, l’IPC intensifie ses programmes de recherche sur la résis-
tance thérapeutique.
« À chaque patiente et à sa tumeur, un marquage moléculaire peut être associé, telle une em-
preinte unique. Par conséquent, pour mieux prendre en charge les 10 % de
femmes non guéries à 5 ans, il faut analyser en profondeur et de façon
exhaustive les anomalies moléculaires à l’intérieur de la tumeur grâce au
séquençage à haut débit et à l’analyse génomique, puis comprendre d’où
provient la résistance aux traitements pour chercher à la contourner et ajus-
ter le parcours de soins. »
Par le Professeur Anthony Gonçalves
Parallèlement, les actions se poursuivent sur les autres leviers de la prise en charge :
dépistage, diagnostic rapide, prise en charge spécifique des maladies d’origine familiale.
I – L’ONCOGENÈSE MAMMAIRE : UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE DE MIEUX EN MIEUX COMPRIS
ET UNE AUTRE FAÇON DE « PENSER » LA TUMEUR
Il n’existe pas un mais plusieurs types de cancers du sein. Parfaire la connaissance de la biologie des cancers
du sein a permis aux cliniciens d’améliorer leur classification et de mettre en évidence leur grande hétérogénéité.
Aujourd’hui, un cancer du sein se définit, en fonction :
• de l’aspect des cellules qui prolifèrent (cancer canalaire ou cancer lobulaire) et de sa localisation dans
la glande mammaire ;
• de la taille, de son grade histologique et du degré d’agressivité de la tumeur ;
• de son statut de maladie localisée ou métastatique.
Mais aussi, en fonction de différents biomarqueurs, entre autres :
• selon la présence ou non de récepteurs hormonaux (œstrogène et/ou progestérone) sur les membranes
des cellules tumorales : 70 % des cancers du sein sont dits « hormono-sensibles » car ils expriment ces
récepteurs ;
• selon la présence en grand nombre ou non de récepteurs HER2 (« surexpression »), cible de l’Herceptin®
(anticorps monoclonal) : c’est le cas de 15 à 20 % des cancers du sein, localisés ou métastatiques, diag-
nostiqués chaque année en France ;
• si le cancer n’exprime pas de récepteurs hormonaux et n’exprime pas HER2, il est dit triple négatif.

CANCER DU SEIN : GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX
5
Dans leur ensemble, les tumeurs du sein s’avèrent donc extrêmement hétérogènes entre elles. A cette hétérogé-
néité inter-tumorale s’ajoute par ailleurs une hétérogénéité intra-tumorale, avec la présence de sous-populations
de cellules : toutes les cellules d’une même tumeur ne sont pas identiques entre elles. Le tout induit différentes
réponses aux traitements, comme dans le cas de maladies différentes. D’où une autre façon de « penser » les tumeurs.
On connaît en effet maintenant de nombreux mécanismes moléculaires et de nombreuses anomalies génétiques
associés à l’apparition et au développement de la maladie, ainsi qu’à la dissémination tumorale. Ces altérations
moléculaires ou mutations génomiques constituent parfois aussi le talon d’Achille des cellules de la tumeur et
deviennent une cible thérapeutique particulièrement intéressante pour les malades chez qui l’altération ou la
mutation est présente. Une fois la valeur fonctionnelle de l’altération, c’est-à-dire son rôle dans l’évolution de la
maladie validée, on cherche des médicaments susceptibles de l’inhiber.
A la clé : de meilleures approches thérapeutiques pour combattre les cancers du sein, notamment ceux qui restent
réfractaires aux traitements, développer pour ces cancers de nouvelles stratégies de prise en charge diagnostique
et thérapeutique, augmenter les chances de contrôle et guérir, à terme, encore plus de femmes.
II – AUGMENTER LE TAUX MOYEN DE GUÉRISON AU-DELÀ DES 90 %
Tous types de cancer du sein confondus, le taux global de survie relative à 5 ans après le diagnostic est actuel-
lement estimé, selon l’INCa, l’Institut national du cancer, à près de 89 %.
D’une part, le dépistage permet de prendre en charge des cancers débutants. Plus un cancer du sein est détecté
tôt, mieux il se soigne, avec des traitements moins lourds et moins de séquelles. Un cancer du sein pris en charge
à un stade précoce, s’il est de petite taille, est guéri dans 9 cas sur 10 : le dépistage précoce constitue l'une des
armes les plus efficaces contre cette maladie.
Ce dépistage peut être individuel (suivi chez le gynécologue ou le médecin traitant, mammographie) ou s’effectuer
dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein organisée par les pouvoirs publics pour toutes
les femmes âgées de 50 ans à 74 ans. Enfin, en cas d’antécédents familiaux, un dépistage spécifique peut être
préconisé.
D’autre part, les recherches et les connaissances sur le cancer du sein, notamment la compréhension des ano-
malies génétiques dans les processus de cancérisation, mais aussi les progrès des technologies, ont induit des
évolutions majeures au bénéfice des patientes, dès la prise en charge diagnostique et la prise de décision thé-
rapeutique. De plus en plus systématiquement, la biologie sert de guide à la prise en charge diagnostique, plus
sûre et de meilleure qualité, puis thérapeutique : chaque sous-type de cancer du sein, présentant ses propres
caractéristiques pathologiques, donne lieu à des traitements spécifiques différents.
L’exemple de l’oncogène HER2 est révélateur du processus. Aujourd’hui, pour tous les diagnostics de cancer du
sein, la surexpression de HER2 est systématiquement recherchée, afin de traiter les patientes concernées avec
des traitements ciblés adéquats. Par ailleurs, il est également recommandé de faire un suivi dans le temps de ce
statut HER2, en cas de rechute et de métastases, car la surexpression de HER2 peut évoluer.
Une autre amélioration thérapeutique émergente concerne la prise en charge des cancers du sein hormonodé-
pendants. En ciblant les récepteurs hormonaux, l’hormonothérapie constitue depuis plusieurs années une stratégie
majeure dans le cancer du sein. Néanmoins, un certain nombre de cancers du sein hormonodépendants résistent.
Même si des traitements sont déjà disponibles, il est devenu primordial de parvenir à renforcer l’arsenal contre
ces cancers hormonodépendants résistants : de nouvelles thérapies ciblées sont actuellement en développement.
Actuellement, les chercheurs et les cliniciens de l’IPC travaillent sur le développement du séquençage à haut
débit :

CANCER DU SEIN : GUÉRIR PLUS ET GUÉRIR MIEUX
6
• pour mieux comprendre les anomalies des gènes prédisposant la survenue du cancer (analyse génétique
constitutionnelle) ;
• pour caractériser les gènes présents à l’intérieur de la tumeur (analyse moléculaire somatique), trouver
des mutations qui affectent exclusivement les cellules de la tumeur du patient et qui peuvent permettre
de cibler le traitement.
Chaque tumeur partage des caractéristiques communes avec d’autres mais est en même temps unique. A l’avenir,
on peut imaginer qu’une évaluation biologique et génétique, à la fois exhaustive et raisonnable, sera réalisée à
chaque stade de la prise en charge d’un cancer du sein. Exhaustive, car il convient de chercher tout ce qui peut
être déterminant, au bénéfice de la patiente, de la phase diagnostique au suivi dans le temps. Raisonnable, car
il ne sert à rien de chercher des informations inutiles. En permettant de mieux cibler les traitements, le séquençage
systématique pourrait alors constituer une solution pour baisser les coûts de prise en charge.
III – BIEN CARACTÉRISER, À TEMPS, LE CANCER DE CHAQUE PATIENTE
Bien caractériser, à temps, le cancer de chaque patiente permet de proposer systématiquement une thérapeutique
optimale et d’augmenter les chances de guérison.
Aujourd’hui, lorsque la mammographie a décelé une anomalie, entre la prise de rendez-vous pour obtenir l’avis
d’un spécialiste, la biopsie et les résultats des prélèvements, les délais peuvent aller jusqu’à 5 semaines. Parfois,
le début de la prise en charge n’intervient que 2 mois plus tard. Or, pour les cancers d’évolution rapide, tout retard
s’avère préjudiciable.
Depuis février 2014, l’IPC propose aux femmes de la région PACA une filière innovante de diagnostic rapide,
principalement dédiée aux femmes qui présentent des anomalies cliniques ou des images mammaires suspectes
lors des examens d’imagerie standard.
En appelant le 04 91 22 34 18, numéro direct, un rendez-vous est systématiquement proposé dans les 7 jours.
Lors de ce 1er rendez-vous, le dossier de la patiente est analysé avec précision par l’équipe dédiée. Si nécessaire,
des clichés supplémentaires sont réalisés et une biopsie peut être pratiquée dans la journée.
Pour finaliser le diagnostic, caractériser la tumeur, y détecter la présence d’éventuels biomarqueurs spécifiques
(par exemple, des récepteurs hormonaux), en fonction desquels l’oncologue déterminera le parcours thérapeu-
tique optimal, un délai de 72 heures est actuellement nécessaire. L’analyse vise à donner une réponse complète
pour une prise en charge globale et précise.
Si une biopsie a été réalisée, et si un cancer a été diagnostiqué, l’annonce est effectuée lors du 2ème rendez-vous.
L’oncologue ou le chirurgien présente et explique les différentes étapes de la prise en charge programmée. Selon
le résultat de la biopsie, de façon à optimiser les chances de guérison, le traitement proposé est différent : chirurgie
d’emblée, chimiothérapie néoadjuvante…
En 2014 et 2015, ce nouveau parcours de prise en charge rapide a respectivement accueilli 724 et 704 patientes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%