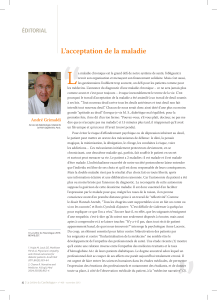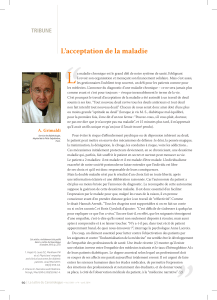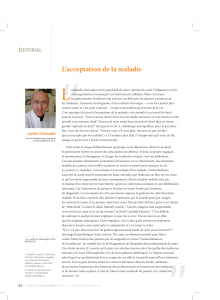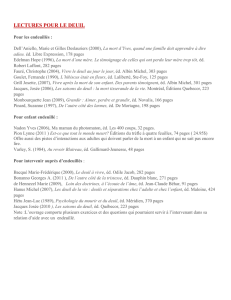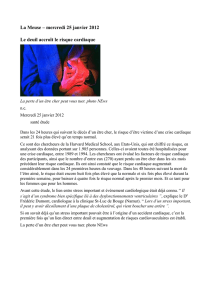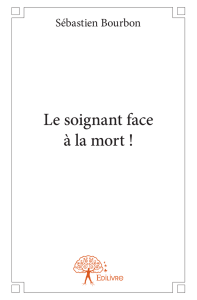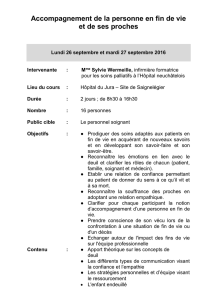Le Deuil traumatique

Edwige SUTRE
Psychologue clinicienne
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN
HYPNOSE ERICKSONIENNE
DE L'INSTITUT MILTON H. ERICKSON DU RHONE
LE DEUIL TRAUMATIQUE
Formateurs :
Mohammed EL FARRICHA
Françoise MONTANIER Décembre 2014

Remerciements à :
- Marion, Chantal et Georges qui se reconnaîtront
- Mohammed El Farricha et Françoise Vanmuysen
qui, dans le cadre de cette formation, m'ont ouvert
les portes du monde de l'hypnose éricksonienne,
- aux différents membres du groupe de formation
pour leur bienveillance,
- à Mme K

TABLE DES MATIERES
Introduction 2
I- TRAUMATISME, PSYCHOTRAUMATISME ET ESPT 3
1- Le traumatisme 3
2- Le psychotraumatisme 3
3- L'ESPT 3
3-1 Epidémiologie 4
3-2 Facteurs prédictifs 4
3-3 Critères diagnostiques 4
3-4 Troubles comorbides 6
II- DEUIL TRAUMATIQUE 6
1- Le travail de deuil 7
2- Le deuil « normal » 8
3- Le deuil traumatique 8
3-1 Le concept de deuil traumatique 9
3-2 Les critères diagnostiques 8
3-3 Les facteurs de risque 10
3-4 De la qualité du lien 10
III- PSYCHOTHÉRAPIE, HYPNOSE ET TRAVAIL DE DEUIL 11
1- Le cadre 11
2- Anamnèse 12
3- Hypnothérapie 13
Les cinq premières séances 13
Sixième séance, objectif et script 14
CONCLUSION 19
ANNEXES 20
Evaluation pré et post thérapeutique, échelle IES
BIBLIOGRAPHIE 23
1

LE DEUIL TRAUMATIQUE
Le deuil jalonne le chemin de l'existence.
Le deuil nous renvoie à l'expérience de la perte, vécue par chaque sujet, dans sa singularité.
Une perte qui va prendre un sens tout particulier pour l'individu, en fonction de son histoire, des
circonstances de la survenue de la perte, des ressources dont dispose alors le sujet pour vivre cette
expérience.
Le deuil, souvent associé à la notion de décès, peut se rencontrer dans d'autres événements de la vie.
Ainsi, une séparation, un déménagement, la fin d'une activité professionnelle, sont-ils des moments,
comme tant d'autres, qui peuvent confronter l'individu à la perte.
Ces épisodes de la vie marquent un avant et un après. La qualité de cet après, son existence même
vont dépendre du travail de deuil, ce mouvement d'acceptation de la perte qui, peu à peu, va
permettre au sujet d'investir de nouveaux objets.
Dans cet écrit, il va être question d'une perte particulière, la perte de l'autre, le décès d'un être cher
et des spécificités du deuil traumatique.
Pour ce faire, nous aborderons dans un premier temps, les notions de traumatisme ,
psychotraumatisme, l'état de stress post-traumatique (ESPT) et ses critères diagnostiques.
Nous verrons ensuite en quoi consiste le travail de deuil et les répercussions sur la dynamique
psychique du sujet lorsque ce processus achoppe notamment dans le cas d'un deuil traumatique.
Enfin, nous présenterons le cas d'une patiente que nous avons accompagnée dans ce travail de deuil,
dans le cadre d'une psychothérapie, cadre pensé dans une articulation et une complémentarité entre
travail de type analytique et travail hypnotique.
2

I-TRAUMATISME, PSYCHOTRAUMATISME ET ESPT
1 – Le traumatisme
Un choc violent, une effraction et leurs répercussions sur l'ensemble de la dynamique
psychique du sujet, c'est ainsi que nous pourrions définir la situation traumatique.
J.Laplanche et JB.Pontalis (1992) évoquent le traumatisme comme étant « un événement de
la vie du sujet qui se définit par son intensité, l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre
adéquatement, le bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans
l'organisation psychique ».
Ainsi, la situation traumatogène aurait-elle pour effet de provoquer une peur, une détresse,
un effroi d'une intensité telle que ces éprouvés déborderaient la psyché du sujet provoquant une
effraction des défenses psychiques et le blocage de la secondarisation de la pensée.
C. Barrois (1998) décrit ce phénomène en termes d'existence qui « se trouve bouleversée par
l'intrusion de quelque chose d'impensable ».
Différentes classifications sont proposées.
C .Tarquinio et S. Montel (2014) reprennent la typologie proposée par Terr, différenciant deux
types de traumatismes.
Le type I désigne un événement traumatique limité dans sa temporalité, ayant un début et une fin.
Le type II est un traumatisme qui s'inscrit dans la durée, dans la répétition et qui fait vivre au sujet
un sentiment de menace permanente.
Un troisième type, ajouté par Solomon et Heide, le type III désigne des événements traumatiques
multiples, violents et s'inscrivant également dans la durée.
D'autres distinctions sont également proposées entre :
- traumatisme direct ou indirect (indirect du fait, par exemple, de relations entretenues avec une
personne ayant subi un traumatisme, d'avoir été témoin...)
-traumatisme simple ou complexe (complexe du fait notamment, de la répétition des événements
traumatiques survenus précocement dans l'existence du sujet...)
2- Le psychotraumatisme
Le psychotraumatisme est une expérience intime qui renvoie à la singularité du sujet. Un événement
prendra ou non une valeur traumatique en fonction, entre autres, de la résonance que cet épisode
peut avoir avec l'histoire du sujet, de la réalité interne de l'individu, de la qualité de la mobilisation
de ses défenses psychiques, de ses ressources au moment où l'événement se produit. Ainsi, une
même expérience peut-elle provoquer un débordement du psychisme pour un individu et avoir un
impact beaucoup plus restreint sur un autre ou bien encore, pour un même sujet, avoir un effet
traumatique à une période donnée de sa vie et non à une autre .
Cette dimension singulière du psychotraumatisme nous paraît centrale, notamment, dans notre
position d'écoute de la souffrance du sujet, dans l'accueil de ce vécu traumatique. Il s'agit, dès lors,
d'accueillir et de reconnaître ces vécus singuliers.
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%