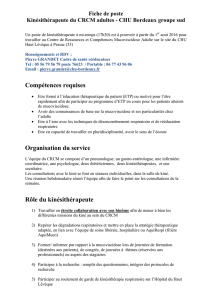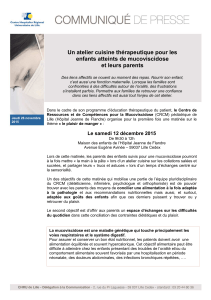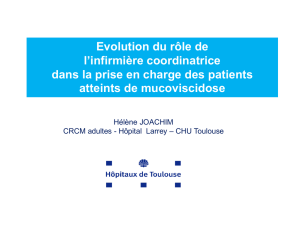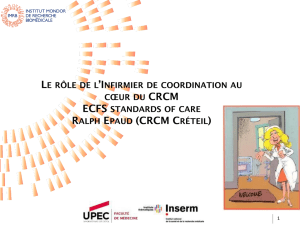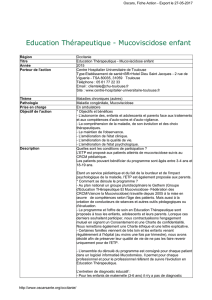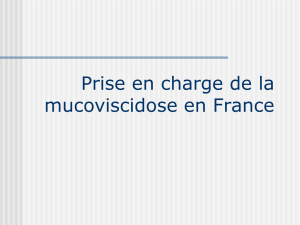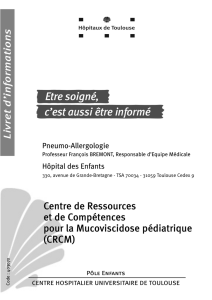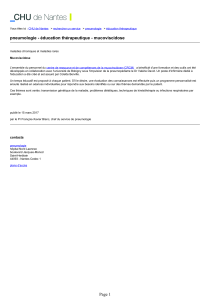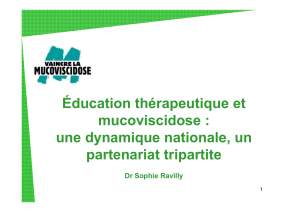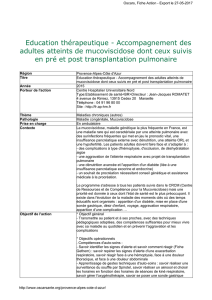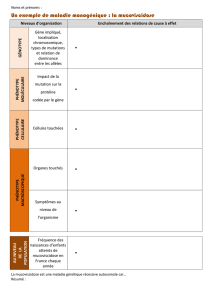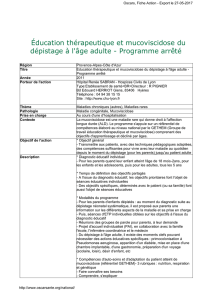Lire l`article complet

La mucoviscidose de l’enfant à l’adulte
Cystic fibrosis: how to grow up? From childhood to adulthood
●
C. Guinet, S. Bronstein, S. Mars (CRCM Montpellier)
L’
amélioration de la prise en charge des patients atteints
de mucoviscidose depuis 20 ans a considérablement
modifié le pronostic, faisant de cette pathologie pédia-
trique une pathologie de l’adulte. Les principaux déterminants
de ce pronostic sont l’amélioration de la nutrition, de la prise en
charge respiratoire et le diagnostic de plus en plus précoce. Le
dépistage à la naissance est réalisé en France depuis 2002. Les
professionnels impliqués dans la prise en charge des enfants
atteints de cette maladie sont aussi ceux qui doivent désormais
prendre en charge les adultes atteints.
Le rendez-vous de Lille, les 27 et 28 mars 2003, a donc été consacré
à cette transition enfant-adulte. Étaient réunis des médecins, des
kinésithérapeutes, des infirmières, des puéricultrices et des assis-
tantes sociales impliqués dans la mucoviscidose, et les Centres
de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM)
en particulier.
Nous proposons ici de relater les points de vue de l’infirmière et
des kinésithérapeutes lors de ce congrès.
L’ŒIL DE L’INFIRMIÈRE-PUÉRICULTRICE COORDINATRICE
DU CRCM
Catherine Guinet (infirmière-puéricultrice coordinatrice du CRCM
du Languedoc-Roussillon, CHU Arnaud-de-Villeneuve, Montpellier)
Parmi les sessions, plusieurs thèmes ont été spécifiquement dédiés
aux infirmières. Nous en avons sélectionné les points forts.
La législation et la mucoviscidose
Un des ateliers infirmiers a été consacré aux “aspects législatifs
des soins à domicile”, coordonné par maître Gilles Devers (Lyon).
La mise en place d’un réseau de professionnels sous la respon-
sabilité d’un CRCM permet une meilleure organisation des soins
pour la mucoviscidose, le tout au bénéfice des patients. La place
de l’infirmière est très importante dans ce réseau de soins et
constitue même un pivot dans son bon fonctionnement, puisqu’elle
est garante de deux missions fondamentales dans la prise en charge
des patients atteints de mucoviscidose.
Il s’agit d’abord d’aider et de guider les parents et les patients
pour assurer une coordination dans les soins entre l’hôpital et le
domicile. Les soins doivent s’intégrer au mieux dans la vie quo-
tidienne, dans l’environnement familial, scolaire et profession-
nel, en fonction des souhaits et possibilités des parents, des
patients et des professionnels.
L’infirmière coordinatrice (IDEC) organise la continuité des
soins : entre l’hôpital et le patient à son domicile en dehors d’une
cure d’antibiothérapie par voie veineuse ou durant celle-ci ;
entre l’hôpital et les partenaires sociaux, le monde du travail,
l’école. Si besoin est, l’IDEC oriente les patients ou les parents
vers les interlocuteurs, les partenaires adéquats.
Il s’agit par ailleurs d’autonomiser progressivement les patients
et leur famille.
L’IDEC partage l’information avec les patients et/ou les familles
sur les pratiques de soins préconisées. Elle organise avec eux une
information et une formation concernant la maladie et son évo-
lution, les traitements (leur bien-fondé, leur évolution, l’alimen-
tation et l’hygiène, etc.), l’organisation des soins (dont les moda-
lités de mise en place des décisions thérapeutiques).
G. Devers a rappelé les deux textes de loi fondamentaux pour la
fonction de l’infirmière. Ces textes mettent en valeur le rôle propre
de l’infirmière, et ils renvoient à son savoir-faire (décret n° 93.221
du 16 février 1993 et décret n° 202.194 du 11 février 2002).
Dans ces décrets, le devoir de regard de l’infirmière sur la pres-
cription du médecin est rappelé. Au domicile du patient, l’infir-
mière vérifie les prescriptions et, si elle juge utile de bénéficier
d’un complément d’information, elle doit le demander au méde-
cin prescripteur.
Les soins à domicile
Lors de la discussion entre G. Devers et les participants, différentes
questions ont été abordées, dont deux paraissent importantes.
“Quelle est la position du parent qui désire prodiguer
des soins à son enfant à domicile ?
Sous quelle responsabilité est-il ?”
Un parent qui désire prodiguer des soins à son enfant à domi-
cile le peut, s’il s’agit de soins ne justifiant pas un apprentissage
particulier.
Pour les soins dits “techniques” dont la pratique nécessite une
formation, il faut les enseigner aux parents et que cette formation
soit reconnue par un diplôme officiel.
Cela rejoint le rôle du CRCM, qui s’engage à assurer l’éducation
thérapeutique du patient et de sa famille, c’est-à-dire l’information
adaptée au patient et à sa famille sur la maladie et sur les traitements.
Celle-ci fait partie intégrante de la prise en charge, tout comme
le soutien aux familles et l’évaluation de leurs capacités à assumer
les traitements.
COMPTE-RENDU DE CONGRÈS
247
La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no6 - novembre-décembre 2003

Ces éléments de la prise en charge sont aussi à envisager au domi-
cile et doivent être développés sans exclure des collaborations
extérieures, comme celles venant du milieu associatif, ou une
réflexion particulière sur le concept d’infirmière de liaison, capable
de se déplacer au domicile des patients.
Le CRCM s’engage aussi à assumer la formation initiale, continue
et pratique des différents intervenants locaux, qu’ils soient des
professionnels de santé, des parents ou des patients.
Lorsqu’un parent assure des soins à domicile à son enfant, il s’inscrit
dans une collaboration médecin-parents, et devient collaborateur
bénévole du centre hospitalier, avec l’accord du médecin du CRCM.
Dans ce cas, c’est la responsabilité du médecin du CRCM qui est
engagée, lorsque celui-ci accepte cette situation.
“Une ordonnance faxée
ou un e-mail ont-ils une valeur juridique ?”
De nos jours, avec l’avancée technologique, certains foyers sont
équipés d’ordinateurs, et beaucoup de patients ou de familles com-
muniquent avec le CRCM par e-mail. De même, pour réduire les
distances et faciliter la communication, le CRCM du Languedoc-
Roussillon, dont le centre se trouve à Montpellier, et les patients
dans tout le Languedoc-Roussillon sont souvent amenés à faxer
des ordonnances. Or, la question de la valeur juridique de ces
nouveaux moyens de communication se pose. G. Devers nous
apprend que ces e-mail et fax ont une valeur juridique, à condition
de garder une preuve de l’envoi de ces courriers dans le dossier
du patient. Et, comme toute prescription médicale, il faut qu’ils
soient signés et datés par le médecin prescripteur, cela afin de
combattre la prescription orale.
Conclusion
L’infirmière coordinatrice est garante du bon fonctionnement
d’un CRCM, de par sa fonction de formatrice, de relais d’infor-
mation, d’aiguilleur, de repérage de la demande, de tiers et d’orga-
nisateur assurant la continuité des soins tout en l’articulant avec
la qualité de vie. En participant à la permanence des soins et à
l’harmonisation des pratiques, l’infirmière contribue également
à la coordination des soins.
L’infirmière coordinatrice est donc bien au cœur du réseau de santé,
tel qu’il est promu par la circulaire ministérielle du 22 octobre
2001 relative à l’organisation des soins pour la prise en charge des
patients atteints de mucoviscidose.
LA PLACE DU KINÉSITHÉRAPEUTE
DANS LE RÉENTRAÎNEMENT À L’EFFORT
DU PATIENT ATTEINT DE MUCOVISCIDOSE
Séverine Bronstein (kinésithérapeute adulte)
Stéphanie Mars (kinésithérapeute enfant)
(CRCM du Languedoc-Roussillon,
CHU Arnaud-de-Villeneuve, Montpellier)
Les thèmes principaux ont été consacrés à la réhabilitation
à l’effort et à ses aspects pratiques. Ils ont été animés par le
Dr Chantal Karila, pneumopédiatre de l’hôpital Necker, à Paris,
et par des kinésithérapeutes : Hugues Gauchez, du centre de réédu-
cation respiratoire Cyr-Voisin de Loos, et Philippe Joud, du centre
de kinésithérapie respiratoire pédiatrique et adulte de Lyon. Nous
en résumons ici les points clés.
L’évaluation de la dyspnée
Au cours de la maladie, la perception de la dyspnée évolue le plus
souvent depuis la petite enfance. Elle paraît très variable et semble
souvent sous-estimée par le patient. Une mesure objective de cette
dyspnée est donc nécessaire. L’épreuve d’effort évalue ainsi l’alté-
ration des performances physiques, cardiaques, respiratoires et
nutritionnelles du patient, permettant de mesurer le décondition-
nement physique et la gravité de la maladie.
De plus, avant d’entreprendre un réentraînement à l’effort, il
est indispensable de réaliser une épreuve d’effort cardiopul-
monaire sur cycloergomètre ou tapis roulant avec mesure des
échanges gazeux.
La mesure de la consommation d’oxygène, ou VO2max, effec-
tuée au cours de cette épreuve d’effort maximale est fonda-
mentale, car la fonction respiratoire de base seule (spirométrie,
hématose) ne permet pas d’évaluer l’importance de la dyspnée.
En effet, les études montrent parfois une grande discordance
entre le VEMS et la VO2max.
Il est recommandé de réaliser cette mesure au minimum une
fois par an.
La quantification de la VO2max reproductible et objective per-
met ainsi de suivre l’évolutivité de la maladie et l’efficacité du
réentraînement à l’effort.
Différents tests permettent aussi d’évaluer la dyspnée : le test de
marche de six minutes, le trois minutes ou step-test, et le test
navette, plus adapté chez l’enfant. La nécessité d’une coopéra-
tion active rend ces tests difficilement réalisables avant l’âge de
6 ou 7 ans.
Les aspects pratiques de la réhabilitation à l’effort
chez le patient atteint de mucoviscidose
Les objectifs de ce programme ne sont pas spécifiques du patient
atteint de mucoviscidose, le principal étant d’améliorer la qua-
lité de vie du patient, de diminuer sa dyspnée et d’améliorer sa
tolérance à l’effort.
Les séances de réentraînement à l’effort se font toujours sous le
contrôle d’un masseur-kinésithérapeute après prescription médi-
cale. Elles se déroulent sur une période minimale de quatre
semaines. En pratique, la plupart des programmes durent six à
huit semaines, ce qui représente vingt à trente séances au total.
Le rythme des séances est de deux à cinq par semaine, à raison
de une à deux heures par séance. Ce programme de réentraîne-
ment peut être effectué au domicile des patients, en ambulatoire,
en centre de rééducation ou encore à l’hôpital, comme pour les
patients atteints de BPCO.
Ces séances pourront être renouvelées en fonction des résultats
obtenus lors de la prochaine épreuve d’effort.
L’organisation pratique d’une séance de réhabilitation respira-
toire comprend plusieurs étapes.
Bilan diagnostique kinésithérapique
Ce bilan tient compte des résultats de l’épreuve d’effort cardio-
respiratoire et des explorations fonctionnelles respiratoires.
COMPTE-RENDU DE CONGRÈS
248
La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no6 - novembre-décembre 2003

Le kinésithérapeute peut réaliser un test de marche initial, qui
pourra être refait au cours du programme de réentraînement
pour contrôler la progression du patient. Il évalue régulièrement
l’encombrement des voies aériennes, ce qui permet de dépister
fréquemment une exacerbation respiratoire de la mucoviscidose
chez les patients sécrétants.
Un examen morphostatique permettant d’apprécier l’attitude du
patient en station debout et morphodynamique, fondé sur l’obser-
vation du mode ventilatoire du patient, sera aussi effectué.
Réalisation d’un drainage bronchique avec ou sans support
instrumental
Les techniques manuelles utilisées sont :
– la ventilation dirigée, encore appelée ventilation abdomino-
diaphragmatique, qui vise à améliorer la cinétique du diaphragme
ou même à la corriger ;
– le drainage autogène, semblable à la ventilation adoptée
pendant le sommeil, facilitant le travail mucociliaire ;
– l’accélération du flux expiratoire, qui consiste à demander
au patient une expiration volontaire forcée glotte ouverte, dont
le but est d’évacuer les sécrétions ;
– la toux contrôlée, qui permet, par un ou deux efforts de toux,
d’expectorer.
Le kinésithérapeute peut s’aider de supports instrumentaux tels
que, par exemple, le flutter, le percussionnaire, le masque à pres-
sion expiratoire positive (masque PEP).
Réalisation d’exercices ventilatoires
Ces exercices sont associés à la ventilation dirigée et à la spiro-
métrie incitative inspiratoire, qui peut être réalisée avec l’aide du
triflo et du voldyne. Ces techniques permettent au patient d’obte-
nir un biofeedback visuel et auditif afin d’améliorer son contrôle
ventilatoire.
Quel protocole ?
Le réentraînement peut se faire sur cycloergomètre, sur tapis de
marche, ou par le biais d’exercices d’endurance.
Les séances, d’une durée allant de 30 minutes à 1 heure, com-
mencent toujours par un échauffement permettant une activation
du système cardiorespiratoire.
Le réentraînement réalisé sur cycloergomètre ou sur tapis de
marche doit se faire selon un protocole personnalisé et défini par
l’épreuve d’effort. On choisira un travail de type rectangulaire
(le patient effectue un effort à charge constante pendant une
longue durée).
Les exercices d’endurance doivent être proches de la fréquence
cardiaque cible, c’est-à-dire de 60 à 80 % de la fréquence cardiaque
maximale, et doivent être maintenus 6 à 12 minutes. Parmi ces
exercices, le kinésithérapeute proposera la “montée et descente
d’escaliers”, le saut à la corde, etc.
Surveillance des paramètres
Elle consiste à évaluer principalement la saturation en oxygène
à l’aide d’un saturomètre afin de dépister un risque éventuel de
malaise. Il s’agit également de mesurer la fréquence cardiaque,
la tension artérielle et la dyspnée, avec une échelle visuelle ana-
logique graduée de 0 à 10.
Renforcement musculaire généralisé
Il concerne, d’une part, les membres inférieurs, avec un travail
statique et dynamique des quadriceps de type fentes, et, d’autre
part, les membres supérieurs, avec un travail dynamique de type
pompes, rameur. Pour le tronc, le kinésithérapeute privilégiera
un travail dynamique des abdominaux et un travail statique du
plan postérieur.
Assouplissements et étirements musculaires
De type stretching, ils concernent les groupes musculaires solli-
cités lors du renforcement.
Relaxation
La relaxation est aussi un point important de la rééducation, à
travers le massage et les techniques de sophrologie.
CONCLUSION
Au terme de cette session, il a été largement démontré que le
réentraînement à l’effort est bénéfique quel que soit son mode.
Afin d’en conserver les acquis, il est nécessaire de conseiller au
patient de continuer à pratiquer un sport d’endurance (natation,
jogging, vélo, équitation, etc.). Le sport est un outil pour motiver
le patient à sortir du cercle vicieux du déconditionnement phy-
sique, et donc de l’altération de sa qualité de vie.
■
POUR EN SAVOIR PLUS...
❒Karila C. Le réentraînement à l’effort de l’enfant malade : cas de la muco-
viscidose. La Lettre du Pneumologue 2001 ; 4 (4) : 151-4.
❒Karila C. Intérêt de l’épreuve d’effort dans l’évaluation de la dyspnée au
cours de la mucoviscidose. Rev Mal Resp 2003 ; 20 : S7-S10.
❒Mise à jour des recommandations BPCO/SPLF sur la réhabilitation respi-
ratoire 2002.
❒Sardet A. Bienfaits de l’exercice physique dans la mucoviscidose. Référence
Mucoviscidose. Elsevier 2000 ; 5 : 31.
❒Sardet A. Kinésithérapie respiratoire et réentraînement à l’effort. Référence
Mucoviscidose. Elsevier 1996 ; 1 : 39.
249
La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no6 - novembre-décembre 2003
Les articles publiés dans “La Lettre du Pneumologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© ALJAC S.A., locataire-gérant de EDIMARK S.A. - octobre 1998 - Imprimé en France - EDIPS - 21800 Quetigny - Dépôt légal : à parution
1
/
3
100%