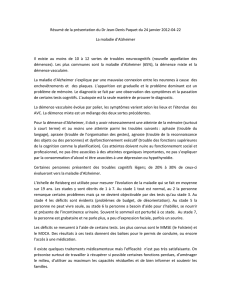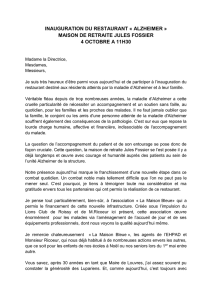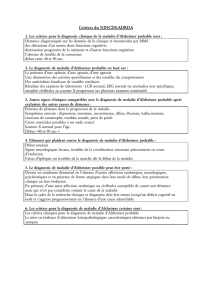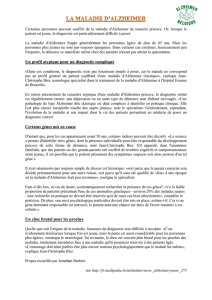La maladie d`Alzheimer

©2002 Successful Aging SA
La maladie d’Alzheimer est définie par les experts de l’Agence National d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé (ANAES) comme une affection neurodégénérative du système nerveux central
caractérisée par une détérioration durable et progressive des fonctions cognitives associée à des lésions
neuropathologiques représentées par des plaques séniles et des dégénérescences neuro-fibrillaires.
Principale cause de démence, cette maladie toucherait près de 500 000 personnes en France. Seules 150
000 d’entre elles sont actuellement diagnostiquées.
EPIDEMIOLOGIE
Quel que soit l’âge des patients, les deux tiers des pathologies démentielles sont causées par la
maladie d’Alzheimer. Avec le vieillissement de la population, l’incidence de cette maladie liée à l’âge
augmente de façon exponentielle.
Elle touche entre 3 et 6 % de la population âgée de plus de 65 ans, et près de 20 % des plus de 85 ans.
PHYSIOPATHOLOGIE
Cette maladie se traduit à l’échelle macroscopique par une atrophie du cortex cérébral ayant pour
conséquence directe une diminution du poids du cerveau. Il s’y associe une dilatation des ventricules.
Cependant cet aspect n’est ni obligatoire à l’établissement du diagnostic, ni pathognomonique de la
pathologie.
C’est au niveau microscopique que l’on observe les lésions les plus évocatrices représentées par les
plaques séniles et les dégénérescences neuro-fibrillaires. Ces lésions corticales touchent principalement
les zones frontales, temporales, pariétales et l’hippocampe.
- Les plaques séniles sont principalement constituées de substance amyloïde. Aussi appelées plaques
neurales, elles représentent des accumulations anormales du peptide β-amyloïde. En concentration
excessive, ce peptide entraîne la mort cellulaire.
- Les dégénérescences neuro-fibrillaires sont constituées d’une accumulation de matériel fibrillaire
anormal au sein du neurone. Le principal constituant de ces fibrilles est la protéine Tau phosphorylée. La
densité observée est corrélée à la sévérité de la maladie.
- D’autres lésions comme l’observation de fibres tortueuses, d’une perte neuronale et synaptique et
d’une angiopathie amyloïde peuvent également êtres retrouvées.
FACTEURS DE RISQUE OU FACTEURS PROTECTEURS ?
L’âge, comme le sexe féminin, sont des facteurs de risque de voir se développer une maladie
d’Alzheimer. Cependant, certains facteurs plus spécifiques comme la notion d’antécédents familiaux
doivent être recherchés.
- Les facteurs génétiques permettent de définir plusieurs formes de maladies d’Alzheimer, formes
familiales autosomiques dominantes et formes sporadiques. La première, très minoritaire, représente
moins d’un millier de personnes et touche des sujets plus jeunes, parfois même avant 60 ans. Les gènes
impliqués ne sont pas encore tous connus. En revanche, les formes sporadiques représentent la grosse
majorité (> 90 %) des cas de maladie d’Alzheimer.
- L’allèle ε4 de l’apolipoprotéine E représente un facteur de risque de la maladie. L’apolipoprotéine E
La maladie d’Alzheimer
Mise au point
T. Cudennec, L. Teillet
Hôpital Sainte Périne, Paris

exerce un rôle régulateur dans le transport du cholestérol et dans le métabolisme des lipides qui
constituent la membrane cellulaire. Elle est également impliquée dans les processus de réparation
cellulaire. La présence de l’allèle ε4 à l’état hétérozygote, multiplie par 4 le risque pour le patient de voir
se développer la maladie par rapport à la population générale. Ce risque est multiplié par plus de 8 pour
les sujets homozygotes. Plus le nombre d’allèles est important, plus on observe de dépôts amyloïdes et
plus la maladie survient précocement.
- D’autres facteurs sont rapportés, comme les antécédents de traumatismes crâniens avec perte de
connaissance, l’HTA, la survenue d’épisodes dépressifs après 65 ans, le niveau d’éducation ou encore le
statut social.
- En revanche, la consommation modérée de vin, un traitement hormonal substitutif de la ménopause ou
la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours s’avèrent des facteurs protecteurs de la
survenue de la maladie d’Alzheimer.
DIAGNOSTIC CLINIQUE
Le diagnostic de certitude de la maladie repose sur le seul examen anatomo-pathologique des lésions
cérébrales lorsque l’histoire clinique est compatible. Malgré tout, un certain nombre d’éléments
cliniques permettent d’évoquer plus ou moins fortement le diagnostic.
La maladie d’Alzheimer correspond à une altération progressive des fonctions cognitives perturbant les
activités de la vie quotidienne de la personne. Ces fonctions perturbées sont la mémoire dans tous les
cas, et au moins l’une des fonctions suivantes : une aphasie, une apraxie, une agnosie ou un trouble des
fonctions exécutives. Les symptômes évoluent sur un mode chronique, ne peuvent êtres expliqués par
une autre pathologie organique ou métabolique éliminée à l’aide des examens complémentaires et ne
surviennent pas au décours d’un épisode confusionnel. Cette définition correspond aux critères établis
par la 4ème édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric
Association (DSM-IV). Un examen clinique complet comportant un interrogatoire permet le plus
souvent d’évoquer le diagnostic.
- Les troubles mnésiques concernent tout d’abord les faits récents. On observe une altération de la
mémoire épisodique, de travail et sémantique. Le patient présente de plus en plus de difficultés à
acquérir des informations nouvelles. Des troubles de l’orientation temporelle et spatiale sont également
rapidement associés.
- Le syndrome aphaso-apraxo-agnosique comporte des troubles du langage marqués, avec un manque
du mot, voire une aphasie sensorielle, une altération de la capacité à réaliser une activité motrice lors
d’atteintes praxiques et une altération de la reconnaissance des objets, des lieux ou des visages dans
l’agnosie. Il s’y associe des difficultés pour le patient à organiser et à planifier son temps et ses
occupations, ainsi que des perturbations du jugement, de la pensée abstraite et une dyscalculie.
Malheureusement, dans de nombreux cas, le diagnostic est posé alors que la maladie est déjà évoluée.
- Ces perturbations des fonctions supérieures sont à l’origine d’une gêne significative dans le bon
déroulement des activités de la vie quotidienne du sujet.
- L’évolution de la maladie s’effectue sur un mode progressif et de façon continue. De plus, elle ne
survient pas au décours immédiat d’une autre affection du système nerveux ou d’un syndrome
confusionnel.
Par la suite, la maladie s’accompagne de troubles d’allure psychiatrique avec des hallucinations,
visuelles le plus souvent, ou une psychose et un délire. Des troubles du comportement comme une
agitation ou une agressivité verbale ou motrice, une déambulation ou encore la survenue de fugues sont
d’observation très fréquente dans l’évolution naturelle de cette pathologie. De même, on observe des
symptômes neurologiques comme la résurgence des réflexes archaïques, l’incontinence urinaire et
fécale, l’hypertonie ou la survenue de crises comitiales. La maladie évolue progressivement sur une
dizaine d’années.
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Ils comprennent tous les examens susceptibles de retrouver une cause organique ou métabolique pouvant
expliquer les troubles des fonctions supérieures et l’existence d’un syndrome démentiel chez un sujet.
- Les tests neuropsychologiques permettent d’évaluer la mémoire, la capacité de concentration,
©2002 Successful Aging SA

©2003 Successful Aging SA
l’orientation temporo-spatiale et l’ensemble des fonctions supérieures de façon plus générale à l’aide
de différents tests. Ils peuvent être de dépistage comme le Mini Mental State (MMS) de Folstein, le test
de l’horloge, le questionnaire de Mac Nair ou l’Instrumental Activities of Daily Living (IADL).
D’autres appartiennent plus directement à l’établissement du diagnostic de la maladie comme le test de
Grober et Buschke, le test de fluence verbale, le test des similitudes ou l’Alzheimer Disease
Assessment Scale (ADAS-Cog).
- Les examens d’imagerie se résument le plus souvent à la réalisation d’un scanner cérébral. Celui-ci
peut retrouver une atrophie cortico-sous-corticale et va permettre d’éliminer l’existence d’une autre
cause de démence telles une tumeur ou une hydrocéphalie à pression normale. Une Imagerie par
Résonnance Magnétique nucléaire (IRM), lorsqu’elle peut être facilement obtenue, est plus
performante et peut révéler une atrophie hippocampique. La tomographie par émission de positons, qui
dévoile un hypométabolisme postérieur, a son principal intérêt pour les programmes de recherche.
- Les examens biologiques comprennent un dosage des hormones thyroïdiennes, de la vitamine B12 et
des folates, une glycémie, un ionogramme sanguin et un hémogramme à la recherche d’une anémie.
Selon le contexte clinique, une sérologie syphilitique ou VIH peut-être demandée. Le génotypage de
l’apolipoprotéine E n’est en aucun cas conseillé à ce stade.
TRAITEMENTS
La prise en charge thérapeutique d’un patient présentant une maladie d’Alzheimer est multifactorielle
impliquant l’intervention de tous les acteurs de soins.
- Le traitement médicamenteux peut être spécifique ou non. Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
sont les seules molécules destinées exclusivement à retarder l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Ils
bloquent l’action des cholinestérases, compensent le déficit cholinergique particulier à la maladie et
permettent à l’acétylcholine de jouer son rôle dans les processus de mémorisation et dans la pensée.
Ces molécules, prescrites en première intention par un spécialiste et efficaces dans plus de la moitié
des cas, permettent de stabiliser durant une certaine période l’évolution des symptômes qui
caractérisent la maladie. Ils s’adressent aux patients présentant des démences débutantes à modérément
sévères. D’autres traitements comme les anti-oxydants, les neuroprotecteurs, les anti-inflammatoires
non stéroïdiens au long cours ou les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, seraient
susceptibles d’améliorer les performances intellectuelles de ces personnes. Enfin, il semble primordial
d’éviter la prescription de molécules susceptibles d’altérer les fonctions supérieures de ces patients
comme les neuroleptiques et les psychotropes de façon plus générale, ainsi que les médicaments
anticholinergiques. La stimulation cognitive, à domicile ou lors de séances d’ateliers mémoires ne
permet pas de réapprendre les éléments oubliés, mais permet de redonner confiance aux patients et de
lutter contre la dépression d’involution.
- Les symptômes de la maladie et leur progression vers une dépendance inévitable au cours des
années d’évolution impliquent un soutien paramédical comportant l’intervention d’infirmières, d’aides
soignants, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de kinésithérapeutes. De même, le soutien
psychologique apporté au patient et à ses aidants, c’est-à-dire le plus souvent à sa famille, est un
élément majeur de la prise en charge thérapeutique.
- Le soutien social peut se traduire par la mise en place d’aides au domicile. Il intervient également
dans la réalisation de dossiers en vue de l’obtention d’aides financières comme le propose l’Allocation
Personne Agée dépendante.
- Enfin, les patients peuvent avoir besoin d’une protection juridique, représentée par la tutelle ou la
curatelle, pour protéger leurs biens.
CONCLUSION
La maladie d’Alzheimer est actuellement la première cause de démence. Sa prévalence comme son
incidence ne cessent de croître. L’existence de traitements spécifiques de cette maladie et leur
meilleure efficacité aux stades précoces nécessite de poser le diagnostic le plus tôt possible. L’avenir
de la prise en charge thérapeutique de ces patients se tourne vers la recherche de traitements
« étiologiques » en limitant ou détruisant les dépôts de substance amyloïde ou en réduisant peut être
les phénomènes d’apoptose.

©2003 Successful Aging SA
REFERENCES
1. Pancrazi M.P., Métais P. Diagnostic de démence de type Alzheimer chez un sujet âgé. La Revue
de Gériatrie, 2003 ; 28 (8) : 673-682.
2. Bentué-Ferrer D., Michel B.F., Reymann J.M., Allain H. Les médicaments face à la maladie
d’Alzheimer. La Revue de Gériatrie, 2001 ; 26 (6) : 511-522.
3. Recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Agence Nationale
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), www.anaes.fr, 20 septembre 2000.
4. Rigaud A.S. Maladie d’Alzheimer. La Revue du Praticien, Médecine Générale, 2002 ; 16 (592) :
1661-1675.
5. Pariel-Madjlessi S., Larcher V., Pouillon M., Belmin J. Diagnostic et évaluation cognitive de la
maladie d’Alzheimer en consultation spécialisée. La Revue de Gériatrie, 2002 ; 27 (10) : 866-
868.
Mf 13-2003
1
/
4
100%