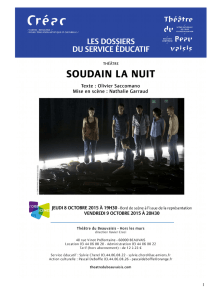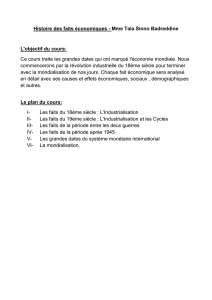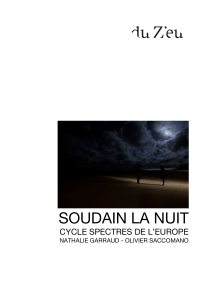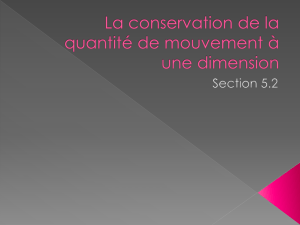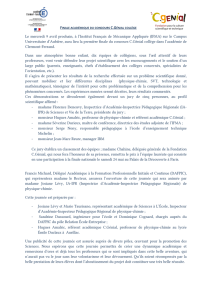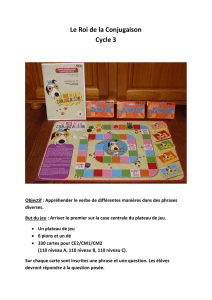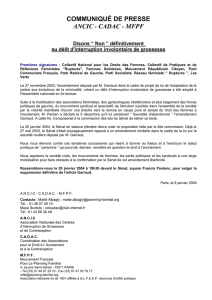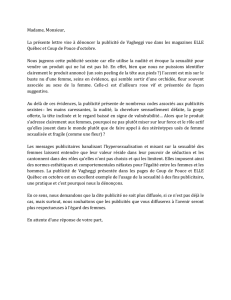Dossier pédagogi que de la Maison de la culture

!
!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dossier pédagogique
Service éducatif de la Maison de la Culture d’Amiens
!
Soudain la nuit
Saccomano/ Garaud

Sommaire
Avant la représentation
Pistes pour une exploitation en classe…
L’espace
1/ Analyse de documents
2/ Un espace signifiant
Entrer dans le texte
1/ Les personnages
2/ Situation, Lieu, Action
Après la représentation
L’écriture de la pièce
1/ Le titre
2/ Ecriture de plateau ?
La scène finale : le radeau
La nudité
Annexe
Textes en écho
Distribution
Liens

Avant la représentation
Pistes pour une exploitation en classe.
L’espace
1/ Analyse de documents
Voici deux croquis dessinés par Nathalie Garraud pour la pièce Soudain la nuit.
- Décrivez le décor, les accessoires et évoquez l’effet produit sur un éventuel spectateur…
- Expliquez l’évolution de l’espace entre le document A et le document B.
Document A

Document B
2/ Un espace signifiant
Vous trouverez ici les notes du metteur en scène évoquant l’espace dans Soudain la nuit. On
pourra proposer aux élèves de confronter leurs éléments de réponse aux intentions du metteur en
scène…
Document C
Eléments du dispositif scénographique :
- Un mur de métal en 5 à 7 pans
- 100 à 200 chaises
- Oreillers
PARTIE 1 - VENUS
Vénus est le nom du désir, Vénus est une déesse (Aphrodite) née de l’émasculation d’Ouranos
(le Ciel de l’aviation) par Cronos (le temps).
Vénus est la séquence de l’arrêt, de l’enfermement, de l’observation, de l’auscultation.
Violence de l’arrêt ordonné, obligatoire, qui réveille la peur, les désirs inconscients…
L’espace est travaillé selon l’idée d’une machine dont la marche est arrêtée, et dont on verrait le
mécanisme (…)

L’espace concret, matériel doit accentuer l’architecture du système, ses traits, il révèle un certain « ordre
» (habituellement camouflé ou adouci) : un mur qui clôt l’espace, des rangées de chaises ordonnées
implacablement.
Ordre, nombre et solitude. Les dizaines de chaises sont ordonnées face au mur, dos au public.
La foule est présente dans la masse de chaises, restées vides, et dans la salle. Acteurs et spectateurs
sont face au mur. Les acteurs sont perdus dans la multitude de chaises alignées. Ils errent dans cet
espace, extirpés du flux, retirés de la circulation, isolés (les lapins pris dans les phares). Mais ils n’en
bouleversent pas l’ordre, ils y restent soumis, terrifiés mais soumis. (…)
Les écrans sont ici des écrans de contrôle. (…)
On est à la fois dans la cellule de « contrôle » et dans la cellule « d’observation ».
PARTIE 2 - SATURNE
Saturne est identifié à Cronos, un des « pères » de Vénus. Lui aussi a donné son nom à une maladie
(le saturnisme), qui est aussi un état d’âme pour quelques poètes (les poèmes saturniens de
Verlaine), généralement assimilé à une tristesse ou à une mélancolie, à un écrasement délicat par l’air
du temps.
Le temps s’allonge, sans actes, la parole occupe toute la place.
Retour sur le temps passé. Quelque chose se craquèle.
Saturne est le temps de la « dépression » - presque au sens atmosphérique du terme ! Le temps
s’allonge, se tord, se « désordonne ». Passé et présent se mélangent, les morts et les vivants.
L’espace se délite, se défait, l’ordre imposé n’y tient plus. Les acteurs parlent, rêvent et modifient
l’espace à la convenance de leurs récits, de leurs rêves et de leurs fantasmes. Ils se tiennent, parlent
et agissent complètement hors du flux, ils ne sont plus soumis à « l’ordre des choses ».
(…)
PARTIE 3 - SOLEIL
Ce temps est celui de l’éclaircie. (…)
Soleil est le temps des hommes libérés de l’ordre implacable de la machine. (…)
C’est le temps de la libération, du réveil, de la renaissance, du retour au monde avec une nouvelle
peau…
Une chose est sûre : les acteurs font face aux spectateurs, ils sont avec eux. Dans quel espace et
dans quel ordre, ça reste à trouver ! Mais le trajet de la pièce nous fait passer d’un espace où les
hommes voient leurs dos et un mur infranchissable, à un espace où les hommes se font face.
Pour exploiter le document C
! Organisation de la pièce
- Comment la pièce semble-t-elle divisée ? Nommez les différentes parties.
- Quels points communs repérés et comment les expliquer ?
- D’après les notes du metteur en scène, renommez le document A et le document B.
- Comparez les effets trouvés dans le premier exercice, pour le document A, aux propos du
metteur en scène.
- Idem, pour le document B.
! A vous de jouer :
Pour la dernière partie de la pièce, « SOLEIL », Nathalie Garraud évoque (à ce moment de la
création) un espace qui est encore à définir. A vous d’imaginer, de construire cet espace
d’après ses intentions. Vous pourrez réutiliser les éléments des parties précédentes… ou pas.
Entrer dans le texte
1/ Les personnages
Voici les didascalies initiales présentant les personnages :
- étudiez la désignation sociale des personnages et répartir ces personnages en deux groupes.
Expliquez l’intérêt de cette répartition en confrontant ces personnages à l’espace dans lequel ils
se trouvent.
-étudiez la répartition des rôles féminins et masculins : que remarquez-vous ? En quoi cette
division est-elle pertinente ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%