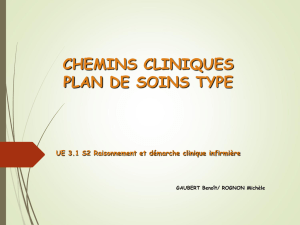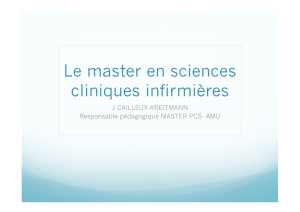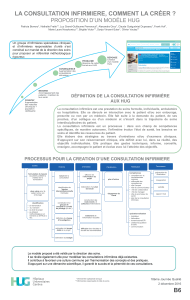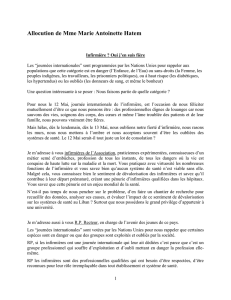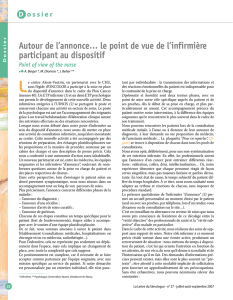Anne Gaudry Muller, com n° 173, Atelier 20

1
Communication n°173 – Atelier 20 : Métier du soin : son exercice
Apprentissages informels des infirmiers à l’hôpital : autoformation et
transmission
Anne Gaudry Muller, Doctorante Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA 1589
Résumé
Les évolutions dans le domaine de la santé ont un impact sur les pratiques infirmières
hospitalières. Les savoirs à mobiliser évoluant rapidement, l’infirmière actualise ses
connaissances pour maintenir et développer ses compétences au jour le jour. Elle est en
situation d’apprenance permanente. A partir d’une recherche doctorale, nous démontrerons
que les infirmières réalisent en situation de pratique professionnelle des apprentissages
informels et ainsi s’autoforment pour être compétentes. L’analyse des données recueillies lors
d’une enquête qualitative précisera les caractéristiques des transmissions infirmières, inscrites
dans une temporalité, une dualité, effectuées de vive voix, non formalisées et ne donnant lieu
à aucune validation. Les résultats montrent des apprentissages quasi exclusifs liés à des
situations de soins présentant des éléments incidents et incrémentaux.
Mots clés : apprentissages informels, autoformation, infirmier, transmission.
------------------------------------------
Introduction
Les mutations sociétales, l’accroissement des besoins en santé, l’accélération des
progrès scientifiques et médicaux, le développement des technologies d’informations et de
communication, les contraintes économiques, la restructuration de l’hôpital génèrent de
nouvelles logiques de soins à l’hôpital et impactent les pratiques soignantes, notamment les
pratiques infirmières. Les professionnelles sont amenées à développer ou actualiser leurs
connaissances, leurs compétences en regard de ces différentes évolutions. Or, le champ des
savoirs mobilisés dans la pratique professionnelle quotidienne est étendu et ces savoirs
évoluent rapidement. Notre questionnement porte sur ce que les infirmières apprennent dans
les services de soins et la manière dont elles le font. A partir d’une recherche doctorale, nous
démontrerons que sur la base de transmission d’informations d’une professionnelle à une
autre, quotidiennement sur leur lieu de travail, les infirmières réalisent des apprentissages
informels et ainsi s’autoforment pour être compétentes. Un professionnel compétent est défini
comme « capable de mettre en œuvre dans une situation donnée,une pratique professionnelle
pertinente tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources (savoirs, savoir-faire,
aptitudes,raisonnements, comportements… » (Le Boterf, 2010). L’autoformation, « notion clé
d’apprendre par soi-même » (Carré, 1997) est ici une « autoformation sociale » (Carré,
2010) : Les infirmières apprennent dans et par le groupe social.

2
L’analyse du recueil des données permettra de préciser les transmissions infirmières
mises en évidence, leurs modalités, leurs contenus et finalités. Les liens entre transmission,
information, apprentissage, socialisation et professionnalisation seront ainsi mis en évidence.
La notion de « transmission » est, depuis tout temps au cœur du métier infirmier. Que
ce soit dans l’exercice professionnel libéral ou en institution, l’infirmière effectue de manière
quotidienne des transmissions aux professionnels avec lesquels elle travaille que ce soit en
collaboration ou en réseau. Les transmissions font partie de la « routine » infirmière, des
« habitus », et peuvent être de formes diverses ou variées, générales ou spécifiques,
individuelles ou collectives. Afin d’en esquisser les contours puis de les décliner plus
précisemment, nous les définirons, en répondant à la question qu’est ce que transmettre ?
Transmettre est un verbe transitif signifiant « faire passer une chose concrète ou
abstraite, une qualité, un caractère, des connaissances d'une personne à une autre ; les
illustrations proposées étant « transmettre le savoir, des traditions » et les synonymes :
communiquer et faire connaître » ( site cnrtl, 2012) . Le dictionnaire encyclopédique de
l’éducation et de la formation indexe quatre articles à propos de « transmission »:
« Transmission voir acculturation ; Communication (techniques de) ; Sciences de
l’éducation », « Transmission culturelle voir Ecole parrallèle », « Transmission des savoirs
voir Vulgarisation » et « Transmission familiale voir Socialisation politique ». Dans le
classement des articles, « école parrallèle » et « vulgarisation » sont considérés comme des
« problématiques » des « Ressources pour l’information et l’éducation », alors que
« Socialisation politique » et « acculturation » sont situés respectivement dans « lien social »
et « culture et norme » des « aspects sociologiques et psychosociologiques ». Pour Dubar, la
socialisation professionnelle des sociologues de l’Ecole de Chicago et la socialisation
anticipatrice (Merton) permettent d’interpréter les conduites des infirmières en formation et de
« rétablir la place éminente de la socialisation latente, informelle, interactive, par rapport à
celle de la socialisation institutionnelle […]. Dans la 3
ème
édition de ce dictionnaire, le
concept est enrichi de deux articles « transmission de connaissances voir Enseignant ;
Machine à enseigner » et « Transmissions des valeurs voir Linguistique et éducation ».
Transmettre trouve donc une place entre socialisation et acculturation, formation et
profession, connaissances et savoirs.
Le terme de « transmission » est omniprésent dans les articles du champ professionnel
mais absent de la littérature scientifique infirmière ainsi que du glossaire du Centre Européen
pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP) définissant les cent
termes essentiels dans le domaine de la politique européenne d’éducation et de formation.
Cette absence interroge et apparaît paradoxale alors que dans le référentiel d’activités du
métier infirmier comme auprès des professionnelles, la transmission est considérée comme
une activité incontournable de la pratique, s’effectuant souvent de manière orale pour
informer ou s’informer de l’état de santé du patient. Les transmissions dans la pratique
quotidienne se limitent elles à la santé du patient ? Y aurait il différents types de
transmissions possibles : des transmissions autour du soin, d’une culture et d’une pratique
professionnelle, liées à l’apprentissage ?
Quelques jalons théoriques
Le terme de transmission peut être défini et précisé selon le sens professionnel qui lui
est attribué le plus couramment, qui est prescrit dans le referentiel métier, le referentiel
compétence ou encore le referentiel de la formation infirmière. Toutefois, ce n’est pas sur
celui-ci que notre regard est porté dans cette recherche mais sur une autre dimension réelle de
la transmission : la transmission comme vecteur d’apprentissages informels et
d’autoformation, mesurant ainsi l’écart entre le prescrit et le réel.

3
Le référentiel métier infirmier décline la notion de transmission dans la sixième
activité nommée : coordination et organisation des activités et des soins. Sept items sont
classés selon deux axes. Le premier porte sur la transmission d’informations vers les
professionnels de santé, entre équipes de soins, orales et écrites à partir de documents utilisés
pour les soins, pour le suivi de la prise en charge du patient et l’élaboration de résumés
cliniques infirmiers. Le second considère la transmission orale d’informations au patient, à la
famille ou aux proches de la personne soignée.
Les transmissions ont pour finalité de prodiguer des soins de qualité, coordonnés au
patient, en regard des projets thérapeutiques ou de soins définis en équipe ou en réseau de
soin. Il s’agit de produire des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à
promouvoir, maintenir et restaurer la santé, de contribuer à l’éducation à la santé et à
l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur
projet de vie.
Les transmissions sont un moyen de réaliser avec compétences des activités cœur du
métier infirmier telles que : évaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de
soins, concevoir et définir des projets de soins personnalisés ; planifier des soins, les
prodiguer et les évaluer ou mettre en œuvre des traitements.
Ces transmissions représentent à la fois un moyen et une nécessité pour les infirmières
d’être compétentes dans le travail en réseau pour produire des soins de qualité de manière
individualisée, organisée et coordonnée à une personne soignée. Elles sont aussi le moyen, en
favorisant les apprentissages informels, l’autoformation des infirmières, d’actualiser leurs
connaissances au fur et à mesure des évolutions du métier, des savoirs et des techniques, des
recommandations et des normes professionnelles pour ajuster leurs compétences tout au long
de la vie professionnelle et maintenir leur professionnalité.
Méthodologie
L’enquête exploratoire de cette recherche, qui s’est déroulée en 2008 sur une durée de
neuf mois a eu lieu auprès d’une population de trente infirmiers, exerçant dans différents
services : médecine, chirurgie, réanimation, bloc, psychiatrie ou prison, sur deux terrains
d’enquête, une clinique et un hôpital en Ile de France. Un outil, le journal de bord, permet le
recueil des apprentissages réalisés chaque jour, pendant six semaines. Les infirmières y
consignent la date, les connaissances, savoir-faire, ou attitudes appris dans la journée,
l’occasion d’apprentissage, les ressources humaines ou matérielles utilisées, ainsi que
l’intérêt pour leur pratique professionnelle. Au terme des six semaines, un entretien en face à
face permet la compréhension objective des écrits.
L’analyse empirique des apprentissages met en évidence une typologie des
apprentissages qui peuvent être classés en trois catégories selon un degré variable
d’intentionnalité et/ou une conscience de l’acquisition de connaissances. A partir de ces
mêmes critères, Schugurensky (2007) a proposé une taxonomie de trois types d’apprentissage
informel : l’apprentissage autodirigé, l'apprentissage accessoire et la socialisation. Carré
(2005) établit, dans les modes d’expression de l’apprenance, trois types d’apprentissages
informels à partir de deux critères : l’intention et la direction (intentionnel, informel et dirigé ;
intentionnel, informel et autodirigé et informel, non-intentionnel et dirigé).
Au terme de notre analyse, trois types d’apprentissages informels sont déclinés. Une
première catégorie concerne des apprentissages conscients et volontaires : des apprentissages
autodirigés, liés à des projets individuels de l’infirmière. La seconde catégorie propose des
apprentissages inconscients et involontaires qui sont conscientisés au décours des entretiens.
La dernière catégorie, la plus représentée, concerne des apprentissages incidents, liés à des
situations inhabituelles ou nouvelles, rencontrées par l’infirmier dans la pratique, tels que les
changements de poste de travail, de prise de responsabilités nouvelles, de dysfonctionnements

4
ou les situations quotidiennes de soins auprès des patients. Ces apprentissages, conscients et
involontaires, de survenue aléatoire sont des apprentissages incrémentaux concernant des
données ou des ressources modifiées, en lien avec l’évolution des savoirs, des techniques ou
des organisations. Ils sont les plus nombreux, car nécessaires dans l’activité infirmière pour
« savoir agir » dans l’ici et maintenant (leBoterf, 2010). Notre publication concerne ce type
d’apprentissage, la transmission entre pairs y tenant une place privilégiée.
Présentation des résultats
Au total, les trente infirmiers déclarent prés de 500 apprentissages composés de
savoirs, savoir-faire et attitudes. Soit 16,5 en moyenne par personne pour tous les
apprentissages confondus : les savoirs sont de l’ordre de 10 apprentissages par personne, les
savoir-faire de 3 par personne, les attitudes entre 1 à 2 par personne. Les savoirs, représentant
67% des apprentissages déclarés, concernent l’institution (administration, culture, valeurs,
organisation, projets, outils de communication intranet) ou des savoirs théoriques spécifiques
au service relatif à la spécialité (les progrès matériels et médicaux, les nouvelles molécules,
les pathologies, les techniques opératoires, et techniques de soins) et les soins infirmiers qui
en découlent, les protocoles et procédures d’entrée, de techniques de soin). Les savoir-faire
représente 21% (mise en œuvre de protocoles, de soins techniques, de commandes) et les
attitudes 9% (gestion de stress, de conflits, prise de position, savoir dire non). Deux
dimensions prépondérantes permettent de les préciser : les dimensions thérapeutique et
organisationnelle avec respectivement dans les deux cas : 53% et 12% pour les savoirs et 34%
et 17% pour les savoir-faire. La dimension thérapeutique des apprentissages est en lien avec
les évolutions scientifiques et techniques, le développement des procédures qualité.
L’infirmier apprend des gestes techniques, des procédures pour agir en situation, être
opérationnelle. La dimension organisationnelle des apprentissages est significative de
l’évolution des structures internes et externes à l’hôpital (la sectorisation, la répartition en
pôles d’activités, les parcours de soins des patients, les réseaux de soins, la collaboration), de
la rationalisation (économie, efficience) du processus qualité (certification des hôpitaux
(V2012,) du mode de management (mode participatif), des conditions et des modes de travail
(ajustement des effectifs, pénurie, flexibilité du travail). Ces savoirs et savoir-faire
représentent 89% des apprentissages.
La majorité de ces apprentissages, conscients et involontaires, se réalisent à l’occasion
de situations de soins dans le service auprès d’un patient, lors d’une activité de soins dans
laquelle l’infirmier agit. Ils ont lieu avant ou pendant l’activité par ce que nécessaires à la
réalisation de cette activité. Les infirmiers déclarent apprendre pour développer des
compétences pour 53% et gérer les situations de soins à 11%, assurer des soins de qualité à
25 % ou encore pour 11% informer le patient. 17% des infirmières déclarent apprendre
seules. 83% apprennent grâce à des ressources humaines : leurs pairs pour 44% puis avec les
médecins pour 27%. Les 12% restants sont répartis entre responsable qualité, agents
administratifs, autres paramédicaux ou patients. Le téléphone est un outil qui permet de
contacter la personne ressource au bon moment, pour répondre à un besoin d’information. La
majorité d’entre elles apprennent à partir d’une information transmisse par une autre
personne. Il est question de « transmission » en tant qu’action de transmettre, de faire passer
quelque chose à quelqu'un ». Une personne transmet une information à une autre,
l’information devient une nouvelle ressource qui peut être combinée avec d’autres pour être
compétent ou encore moyen d’apprentissage. Le résultat de cette action, est, in fine, la
réalisation d’un apprentissage par l’infirmière qui reçoit l’information. Ces apprentissages
sont des apprentissages professionnels informels définis comme : « tout phénomène
d’acquisition et/ou de modification durable de savoirs (déclaratifs, procéduraux ou
comportementaux) produits en dehors des périodes explicitement consacrées par le sujet aux

5
actions de formation instituées (par l’organisation ou par un agent éducatif formel) et
susceptibles d’être investis dans l’activité professionnelle » (Carré, Charbonnier, 2003). La
transmission est un vecteur à finalité d’apprentissage.
Les caractéristiques d’une transmission vectrice d’apprentissage
De la même manière que les infirmières transmettent des informations concernant les
soins personnalisés aux patients, elles vont se transmettre des informations concernant les
pratiques de soins, les activités à réaliser pour produire des soins prescrits, en collaboration,
par le médecin, en regard des dernières recommandations professionnelles. De ce fait, ces
transmissions s’effectuent selon une temporalité significative, coordonnée à l’organisation des
activités dans la pratique professionnelle.
La transmission est quotidienne, séquencée au fil de la journée au cours des
différentes activités du travail, « dans le juste à temps », facile d’accès. Elle est
indispensable à l’infirmière à la fois demandeuse et receptrice de l’information pour « savoir-
agir » avec compétence. (Le Boterf, 2010). Cette transmission qui véhicule la réponse à une
demande formulée, est située, ancrée dans une pratique professionnelle, qui est « le déroulé
de choix, de décisions et d’actions mis en œuvre par le professionnel pour faire face aux
exigences d’une situation professionnelle à gérer » (Le Boterf, 2010).
Cette transmission est une activité secondaire, qui précède ou se superpose à une
autre activité, parce que nécessaire à la réalisation de celle-ci, en regard de critères de
performance attendus. La transmission est séquencée dans la journée en fonction et au fur et à
mesure des besoins d’informations et de connaissances requis dans les différentes activités
quotidiennes, en fonction des aléas du travail. Avant ou au cours d’une activité de soin,
l’infirmière identifie ne pas avoir la connaissance nécessaire pour effectuer le soin dans les
« règles de l’art » et recherche l’information auprès d’une collègue qui « sait » comment faire,
comment agir dans la situation et lui transmet l’information utile pour être en capacité
d’effectuer seule l’activité. La transmission d’information se réalise soit avant le soin mettant
en capacité l’infirmière de produire le soin, soit en cours de soin. Elle correspond à une
variable d’ajustement de la compétence. Les informations transmises viennent enrichir les
ressources de la professionnelle qui les mobilise et les articule avec pertinence dans l’activité
et ainsi se professionnalise (Le Boterf, 2003). La transmission permet de développer ou
d’actualiser les compétences des professionnelles en situation en vue de garantir la qualité de
la production du soin. Elle concoure ainsi à développer la professionnalité des infirmières,
entendue comme l’amélioration de leur développement professionnel (Bourdoncle, 2000),
leur permettant de « gérer une gamme de situations professionnelles qui peuvent aller du
simple au complexe, de l’habituel à l’inédit, du normal au dégradé, de l’incidentel à
l’accidentel » (Le Boterf, 2003) et par extension la professionnalité de l’organisation. Le
professionnalisme est aussi convoqué : la transmission permet à la professionnelle de
respecter dans sa pratique les procédures, les normes ou les valeurs établies par la profession
(Bourdoncle, 2000). Selon un « processus d’identification », en faisant partie d’une équipe,
les professionnelles infirmières suivent la logique de soin actuelle vers l’injonction de qualité
des soins (Dubar, 1998). Cette socialisation peut être qualifiée de socialisation
professionnelle, la socialisation étant définie dans le dictionnaire des Sciences sociales ou
humaines comme « le processus dans lequel les individus intègrent les normes, les codes de
conduite, les valeurs, de la société à laquelle ils appartiennent ». Les infirmières transmettent,
intériorisent et intègrent les valeurs d’appartenance et les normes de fonctionnement de la
communauté de pratique dans laquelle elles se situent, en participant à des activités entre pairs
au travail.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%