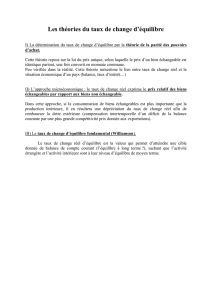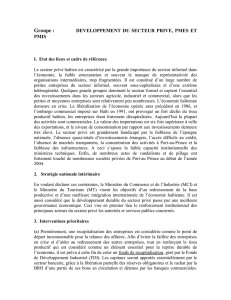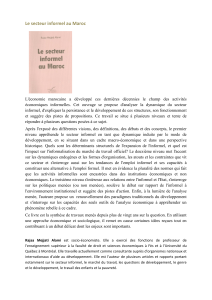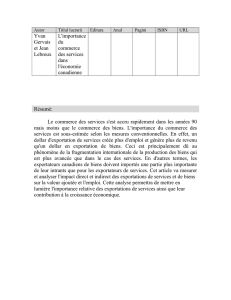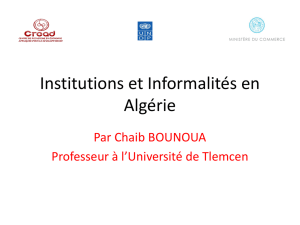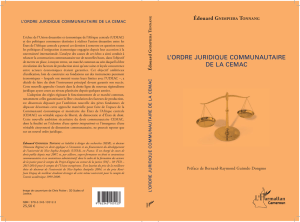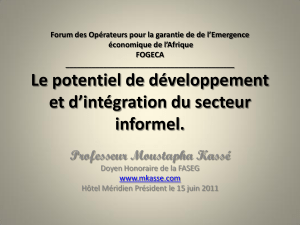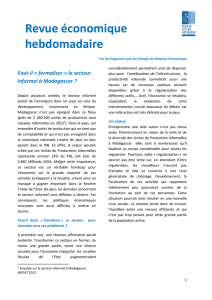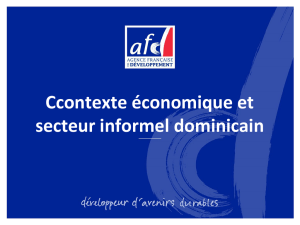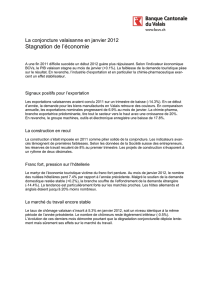2. Commerce international et emploi informel en zone CEMAC

Journal statistique africain, numéro 13, novembre 201150
2. Commerce international et emploi
informel en zone CEMAC
Mathurin Tchakounte Njoda1 et Alain Remy Zolo Eyea2
Résumé
Cet article examine durant une courte période la relation entre le commerce
international et l’emploi informel dans les pays de la zone CEMAC. Cette
zone a la particularité de regrouper des économies qui produisent et exportent
essentiellement des biens primaires, notamment agricoles. Les estimations éco-
nométriques faites sur la base d’un modèle théorique mettent en évidence une
faible influence du commerce international sur l’emploi informel dans différents
pays. Cette influence est d’autant plus négative, c’est-à-dire pas favorable à
l’embauche, que le degré de spécialisation des pays est faible ou leurs économies
diversifiées. Du fait de la structure des économies de la sous-région et des marchés
du travail, l’emploi informel y est plus sensible au commerce international que
l’emploi formel ne l’est.
Mots clés : ouverture commerciale, marché du travail, zone CEMAC
Abstract
This article examines the relationship between international trade and informal
employment during a short time period within the countries of the CEMAC
zone. This zone groups together economies that produce and export primary
goods, particularly agricultural products. The results of the econometric estima-
tions made on the basis of a theoretical model, highlight the negative impact of
international trade on informal employment in the different countries of the
region. The influence of international trade is even more negative, that is to
say, not favorable to hiring, either because the degree of specialization of these
countries is weak or because their economies are diversified. Because of the
structure of subregional economies and their employment markets, the informal
employment is more sensitive than the formal employment to international trade.
Key words: open trade, labor market, CEMAC
1 Mathurin Tchakounte Njoda est Chargé de Cours au Département d’Economie de la
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Ngaoundéré au Cam-
eroun ; B.P.: 454, FSEG, Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun ; Email:
2 Alain Remy Zolo Eyea est Assistant au Département d’Economie de la Faculté de Sci-
ences Economiques et de Gestion de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun ; B.P.: 454,
FSEG,Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun ; Email: alainzoloeyea@yahoo.fr

e African Statistical Journal, Volume 13, November 2011 51
2. Commerce international et emploi informel en zone CEMAC
INTRODUCTION
À la faveur de la mondialisation, le commerce mondial a connu une forte
expansion au cours de la dernière décennie. Selon l’OMC et l’OIT (2009), il
représentait plus de 60 % du PIB mondial en 2007, contre moins de 30 % au
milieu des années 1980. Les pays en développement et en transition ont joué
un rôle plus important qu’auparavant dans l’essor3 des échanges mondiaux :
en 2004 et 2005, ils étaient à l’origine de trois quarts de l’augmentation du
volume des exportations et de 60 % de l’accroissement du volume des im-
portations. Dans bien des cas, cette dynamique des échanges ne s’est jusqu’ici
pas traduite par une amélioration des conditions de travail et des niveaux de
vie ; ni le fonctionnement du marché du travail, ni la quantité et la qualité
des emplois ne se sont améliorés. Dans de nombreux pays en développement,
les emplois ont été principalement créés dans le secteur informel4.
Selon le rapport sur la zone franc5 de la Banque de France publié en 2006,
la valeur des flux commerciaux avec l’extérieur des pays de la CEMAC6 a
plus que triplé entre 1995 et 2005. Cette performance est le produit d’un
accroissement moyen des exportations de 16,4 % par an et d’une progres-
sion annuelle moyenne des importations de 11,8 %. Ces évolutions se sont
traduites par une consolidation significative de l’excédent commercial de la
CEMAC, qui a atteint 31 % du PIB à la fin 2005, contre 15,8 % en 1995.
Au cours de la même période, le taux d’ouverture (somme des exportations
et des importations par rapport au PIB) des économies de la CEMAC a
3 Pour l’OCDE (2007), il serait difficile de contester que cet essor a favorisé la croissance
et la création d’emplois à travers le monde.
4 Le secteur informel est officiellement défini comme « un ensemble d’unités produisant des
biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les person-
nes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de
manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs
de production. Les relations de travail, lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi
occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur des
accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ». Voir BIT (1993), Sta-
tistiques de l’emploi dans le secteur informel, Rapport pour la XVe Conférence internationale
des statisticiens du travail, Genève, 19–28 janvier 1993. Ce secteur ferait vivre plus de la
moitié de la population active des pays en développement.
5 La zone franc est composée de deux unions monétaires et douanières, l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC), ayant chacune une monnaie convertible en euro (ancienne-
ment en franc français), mais ni interchangeable ni convertible entre les deux unions. Voir
A. M. Gulde (2008), Overview, dans Gulde, A. M. et Tsangarides, C. (éd.), The CFA Franc
Zone: Common Currency, Uncommon Challenges, International Monetary Fund Publications.
6 La CEMAC est une zone géographique et économique qui regroupe six pays : Cameroun,
Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo et Tchad.

Journal statistique africain, numéro 13, novembre 201152
Mathurin Tchakounte Njoda et Alain Remy Zolo Eyea
fortement progressé, passant de 69,4 % en 1995 à 93,1 % en 2005. Les
échanges avec l’extérieur ont été fortement influencés par l’évolution de
l’activité des secteurs pétrolier, minier et agricole, dont la part dans la valeur
totale des exportations atteignait en moyenne plus de 90 %. Les éléments
marquants de cette évolution sont notamment :
1) Une forte concentration autour du secteur des industries extractives (pétrole
et minerais), dont la part relative est en hausse, grâce notamment à la
progression des ventes de pétrole de la Guinée équatoriale et du Tchad.
Ainsi par exemple, à la fin 2005, les exportations pétrolières et minières
représentaient 85,5 % du total des exportations, contre 63,9 % en 1995.
2) Un net recul de la part relative du secteur agricole. En dépit d’un
accroissement des exportations agricoles d’environ 3,3 % par an, la part
du secteur dans la valeur globale des exportations avait spectaculairement
chuté à 8,4 % à la fin 2005 par rapport à 24,5 % en 1995. Cette
diminution était notamment liée à celle du volume des exportations
du secteur forestier.
3) Un niveau relativement marginal des exportations de produits commer-
ciaux et manufacturés (2,9 % du volume total des exportations en 2005).
De leur côté, les importations concernent essentiellement les échanges des
entreprises du secteur commercial (24,8 % du total), des industries extrac-
tives (32,5 %) et du secteur industriel (12,1 %). Leur évolution a connu
une rupture prononcée entre 2002 et 2003, suite à l’ajustement du niveau
des importations de biens d’équipement du secteur pétrolier induit par
l’achèvement du pipeline Tchad–Cameroun.
En ce qui concerne les transactions avec le reste du continent africain, leur
contribution est demeurée relativement stable et marginale. En effet, pour
la période 1995–2005, les échanges intracontinentaux (hors échanges au
sein même de la CEMAC) se chiffraient à moins de 6 % du montant total
des flux commerciaux avec l’extérieur. On note la part prépondérante des
échanges avec les pays partenaires ayant une frontière avec la zone. Sur
le montant total des échanges commerciaux des pays de la CEMAC, les
échanges entre le Nigéria et la République démocratique du Congo repré-
sentent 2,8 %, contre une moyenne de 1 % pour les échanges avec les pays
de l’UEMOA7 et de respectivement 0,5 % et 0,4 % pour les échanges avec
les pays d’Afrique australe et du Nord.
7 L’UEMOA est composée de huit pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

e African Statistical Journal, Volume 13, November 2011 53
2. Commerce international et emploi informel en zone CEMAC
Tout comme les échanges à l’échelle du continent, les transactions com-
merciales intracommunautaires comptent pour une part relativement peu
importante dans les flux globaux : elles ne représentent qu’à peu près 3 %
de la valeur totale des échanges (soit 119 milliards de francs CFA par an).
D’après une étude de Madariaga (2010), le commerce intra-zone de la CE-
MAC apparaît en net recul depuis le début des années 2000 et plafonne à
moins de 1 % du PIB, aussi bien vers l’Afrique que sur son propre marché,
alors que son taux d’ouverture sur le continent africain et en intra-zone
avait connu un rebond au milieu des années 1990. Concernant l’UEMOA,
la situation est plus intéressante : le commerce intra-zone y approchait les
8 % du PIB en 2008, en légère augmentation par rapport à 2000, mais à un
rythme nettement moins soutenu que vers l’Afrique ou le reste du monde.
Les réformes économiques et commerciales entreprises au sein des deux
zones après la dévaluation de 1994 semblent avoir stimulé leurs échanges,
mais plutôt en dehors du continent africain.
Comme toutes les économies qui participent à une union économique
et monétaire, les pays de la CEMAC sont loin d’être homogènes tant en
termes de production que d’échanges. Le Cameroun concentre l’essentiel
du total des flux du commerce extérieur8 de la zone et presque la moitié
de son PIB et de sa population. Son économie, la plus grande de la sous-
région, est relativement diversifiée par rapport aux autres économies de la
zone, avec un secteur privé national et un secteur informel plus développés
(voir Tableau 1 et Tableau 2). L’économie de la Guinée équatoriale, le pre-
mier producteur et exportateur de pétrole de la sous-région et le troisième
en Afrique subsaharienne après le Nigéria et l’Angola, est très dépendante
de l’activité pétrolière (dont la part dans le PIB dépasse 80 % et la part
relative par rapport aux exportations totales excède 90 % – voir Tableau
1) ; le secteur privé national et le secteur informel sont, eux, faiblement
développés. Les économies de la République du Congo, du Gabon et du
Tchad dépendent moins du pétrole (dont la part dans le PIB varie entre 40
et 70 % et celle dans les exportations dépasse 80 %). Elles dépendent égale-
ment de la production et de l’exportation d’autres produits primaires (bois,
coton, cacao, sucre, manganèse, etc.) et ont un secteur privé national et un
secteur informel relativement peu développés. L’économie de la République
centrafricaine, le seul pays non producteur de pétrole de la sous-région, est
la moins développée et dépend elle aussi d’un nombre limité de produits
primaires (diamant, café, bois, etc.). Le secteur privé national et le secteur
informel y sont faiblement développés.
8 En 2003 par exemple, les exportations camerounaises atteignaient 100 milliards de
francs CFA, soit 69 % des exportations totales de la zone. Toujours en 2003, sur les 30
millions d’habitants de la sous-région, on estime que 15 millions étaient Camerounais.

Journal statistique africain, numéro 13, novembre 201154
Mathurin Tchakounte Njoda et Alain Remy Zolo Eyea
Tableau 1 : Part des exportations des principaux produits primaires
dans les exportations totales
Pays 1970 1990-
1992
1997-
1999
2000-
2005
Principaux produits en
2000-2005
Pourcentage
Cameroun n.d. 74,3 44,1 50,3 Pétrole, bois brut, cacao
Gabon 82,9 93,2 93,2 90,5 Pétrole, bois brut, man-
ganèse et or
Guinée
équatoriale
- - - 98,7 Pétrole
République
centrafric-
aine
74,3 64,5 73,2 78,1 Diamant, café, bois brut,
République
du Congo
67,4 94,5 85,8 87,4 Pétrole, bois brut, sucre
Tchad 90,8 68,0 52,4 82,6 Pétrole, coton, animaux
vivants
Source des données : Banque mondiale (2005), Indicateurs du développement dans le monde,
CD Database.
Tableau 2 : Classification des pays de la CEMAC suivant les
exportations manufacturières
Pourcentage Part des produits manufacturés dans les exportations totales
1985-1987 2000-2005
0 – 15 Cameroun, Gabon, Guinée équa-
toriale, République centrafricaine,
République du Congo, Tchad
Gabon, Guinée équatoriale,
République centrafricaine,
République du Congo, Tchad
16 – 30 - Cameroun
Source des données : Banque mondiale (2005), Indicateurs du développement dans le monde,
CD Database.
Le fait que le secteur informel soit plus développé au Cameroun que dans
les autres pays de la CEMAC ne signifie pas que l’emploi informel y soit
proportionnellement plus important (par rapport à la population active oc-
cupée) qu’ailleurs (Figure 1). En effet, comme on le verra plus loin, l’emploi
informel revêt un caractère intersectoriel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%