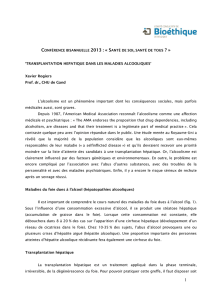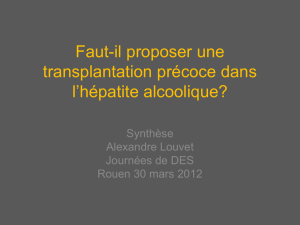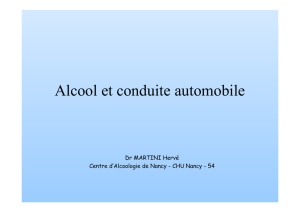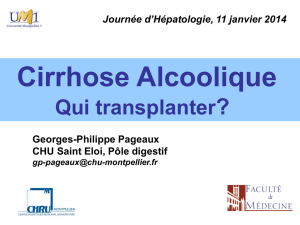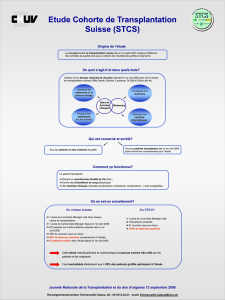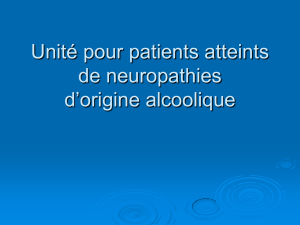Indications de la transplantation hépatique

Indications
de la transplantation hépatique
au cours de la cirrhose alcoolique
Indications of liver transplantation
in alcoholic cirrhosis
Stéphanie Faure,
Georges Philippe Pageaux
CHU Saint-Eloi,
Service hépato-gastroentérologie
et transplantation hépatique,
80, avenue Augustin-Fliche,
34245 Montpellier,
France
e-mail : <[email protected]>
Résumé
La transplantation hépatique est le traitement de choix de la cirrhose
alcoolique grave. La cirrhose alcoolique, qui représente 90 % des causes
de cirrhose en France, est parfois considérée comme une maladie auto-
infligée. Cela pourrait expliquer les réticences à proposer une transplanta-
tion hépatique chez ces patients qui sont moins souvent adressés que
les autres patients cirrhotiques aux centres de transplantation. Pourtant,
les résultats de la transplantation hépatique pour cirrhose alcoolique
(74 % de survie à cinq ans) sont comparables à ceux des autres indications.
Les particularités de la transplantation hépatique chez le patient cirrhotique
alcoolique comprennent la recherche de complications extra-hépatiques
lors du bilan prégreffe et les risques de rechute et de développement
d’un cancer de novo après la greffe. La place de la transplantation
hépatique dans le traitement de l’hépatite alcoolique aiguë sévère et
résistante au traitement médical conventionnel reste à définir.
nMots clés : transplantation hépatique, cirrhose alcoolique, rechute de la maladie
alcoolique, cancers de novo, hépatite alcoolique aiguë
Abstract
Liver transplantation is the accepted treatment of severe alcoholic cirrho-
sis. Alcoholic cirrhosis, which represents 90% of the etiologies of cirrhosis
in France, is sometimes considered as a self-inflicted disease. Patients
with alcoholic cirrhosis are less frequently referred to transplant centers.
However, the results of liver transplantation for alcoholic cirrhosis are
compelling (74% survival at 5 years) and comparable to other indications.
The specificities of liver transplantation of the alcoholic cirrhotic patients
depend on the pre-transplant assessment of extra-hepatic complications
of alcoholism and on the post-trasnplant risk of relapsing and of develo-
ping de novo malignancies. The place of liver transplantation for severe
acute alcoholic hepatitis, resistant to conventional medical treatment,
remains to be defined.
nKey words: liver transplantation, alcoholic cirrhosis, relapse, de novo malignancies,
acute alcoholic hepatitis
En France, on estime qu’environ
deux millions de personnes sont
dépendantes de l’alcool et six millions
ont une consommation à risque.
La Haute Autorité de santé (HAS)
évalue à 15 % le nombre de buveurs
HEPATO
n
GASTRO
et Oncologie digestive
Tirés à part : S. Faure
282 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 n
o
4, juillet-août 2010
mini-revue
doi: 10.1684/hpg.2010.0448
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

excessifs d’alcool. En 2007, la cirrhose alcoolique représen-
tait la première cause de mortalité imputable à l’alcool en
France, responsable de 9 000 à 10 000 décès.
Selon l’Agence française de biomédecine, on dénombrait,
en 2008, 1 011 greffes hépatiques, dont 27 % pour
cirrhose alcoolique. C’est la première indication de trans-
plantation hépatique (TH) en France et la deuxième en
Europe et aux États-Unis.
“
En 2008, 1 011 greffes hépatiques
dont 27 % pour cirrhose alcoolique
”
Dès 1983, la TH a été reconnue par la conférence du NIH
(National Institutes of Health) comme une indication dans la
prise en charge des cirrhoses alcooliques, chez des patients
abstinents et présentant des critères cliniques péjoratifs.
Selon l’ELTR (registre européen de transplantation
hépatique), de 1988 à 2008, 33 % des TH pour cirrhose
et 21 % des TH toutes causes confondues avaient pour
indication principale la cirrhose alcoolique. Ces chiffres
révèlent l’évolution des mentalités, puisque la cirrhose
alcoolique représentait seulement 4,6 % des indications
en 1983. Cette évolution a été possible grâce aux résultats
probants de la TH pour cirrhose alcoolique.
Ainsi, la survie à 5 ans chez les patients atteints de cirrhose
alcoolique décompensée est supérieure à 70 % s’ils sont
transplantés, alors qu’elle est inférieure à 20 % en
l’absence de transplantation. Dès 1988, Starzl et al. [1]
ont montré que les survies à 1 et 3 ans des patients trans-
plantés pour cirrhose alcoolique du foie étaient compara-
bles à celle de patients transplantés pour cirrhose non
alcoolique. Ces résultats ont été confirmés à maintes
reprises et étendus à la survie à 5 ans qui demeurait
identique [2, 3]. Les taux de survie chez les patients trans-
plantés pour cirrhose alcoolique sont respectivement de
79 % à 3 ans, de 74 % à 5 ans, de 61 % à 8 ans et de
56 % à 10 ans. La Conférence de consensus française, qui
s’est tenue à Lyon en 2005, a d’ailleurs validé « la cirrhose
alcoolique comme une indication de la TH au même
titre que les autres cirrhoses. ». Malgré ces données, il
existe encore des réticences à proposer la TH pour cirrhose
alcoolique. Dans cette revue, quatre points majeurs seront
développés :
–les spécificités du bilan pré-TH chez le patient porteur
d’une cirrhose alcoolique ;
–la prévalence, les facteurs de risque et les conséquences
d’une rechute de la maladie alcoolique après TH ;
–l’émergence des cancers de novo après TH pour cirrhose
alcoolique ;
–la place que pourrait prendre la TH dans l’hépatite
alcoolique aiguë résistante au traitement conventionnel.
Spécificités du bilan
de prétransplantation hépatique
chez un patient cirrhotique alcoolique
Chez les patients atteints de cirrhose alcoolique, l’intoxica-
tion alcoolique chronique peut entraîner des atteintes
extrahépatiques, qui doivent être cherchées au cours
du bilan prégreffe. L’inscription de ces malades en liste
d’attente de TH est possible, comme spécifié par la confé-
rence de consensus de 2005, après « un bilan prégreffe
particulièrement attentif à la recherche des lésions liées
à une toxicité alcoolique, voire alcoolo-tabagique, extrahé-
patique, tels les cancers et états précancéreux ORL,
bronchiques, œsophagiens, une affection cardiovasculaire
et respiratoire ».
“
L’intoxication alcoolique chronique peut
entraîner des atteintes extra-hépatiques
”
Les autres organes ou systèmes que le foie pouvant être
affectés par une intoxication alcoolique chronique sont le
pancréas, les reins, le cœur et le système nerveux.
Une pancréatite chronique calcifiante évoluée entraîne
des douleurs abdominales chroniques, un diabète et une
dénutrition importante, qui devront être pris en compte en
pré-TH. De plus, il faut être particulièrement vigilant aux
séquelles possibles d’une poussée de pancréatite aiguë :
abcès, thrombose des vaisseaux splanchniques, adhérences
qui peuvent compliquer la procédure chirurgicale lors de la
TH. La prévalence de l’adénocarcinome du pancréas est
plus élevée chez les patients alcooliques, même si cela
est surtout lié à l’intoxication tabagique. L’exclusion avec
certitude d’un processus tumoral pancréatique nécessite
un bilan morphologique exhaustif en pré-TH.
Le système nerveux, central et périphérique peut être
également touché. L’encéphalopathie de Gayet Wernicke
et le syndrome de Korsakoff résultent d’une carence
en thiamine (vitamine B1). La consommation excessive
chronique d’alcool entraîne un déficit en thiamine, du fait
d’un manque d’apport, d’une diminution de l’absorption
digestive et d’une mauvaise intégration cellulaire de cette
vitamine. Le traitement consiste en une compensation
parentérale en thiamine, mais la récupération en cas de
syndrome de Korsakoff est minime voire nulle. Cette
démence alcoolique, touchant des sujets dès l’âge de
35-40 ans, contre-indique la TH. Ces troubles neurolo-
giques sont difficilement mis en évidence quand il existe
un état d’encéphalopathie hépatique chronique, fréquent
en cas d’hépatopathie au stade terminal. Une neuropathie
alcoolique périphérique se traduit par des crampes, des
douleurs, une faiblesse musculaire pouvant mener à une
impotence avec difficultés de la marche. Toutefois, elle ne
283
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 n
o
4, juillet-août 2010
Transplantation pour cirrhose alcoolique
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

constitue pas à elle seule une contre-indication à la TH. Une
régression de cette neuropathie toxique a même été décrite
après TH. Cependant, elle peut être aggravée du fait de la
toxicité neurologique des inhibiteurs de la calcineurine,
immunosuppresseurs utilisés après TH.
La consommation d’alcool peut être responsable de trois
maladies cardiovasculaires :l’hypertension artérielle,
les troubles du rythme cardiaque et les myocardiopathies
avec survenue d’une insuffisance cardiaque pouvant,
en fonction de la fraction d’éjection résiduelle, contre-
indiquer la TH. Une échographie cardiaque transthoracique
et un ECG font partie de tout bilan cardiologique en
pré-TH.
L’effet délétère de l’alcool sur le rein a été maintes fois
décrit. Un retentissement tubulaire rénal de l’alcool peut
être réversible grâce à l’abstinence. À l’inverse, une néphro-
pathie à IgA est responsable de lésions glomérulaires
irréversibles. Une double greffe foie-rein est alors nécessaire.
L’évolution d’une maladie alcoolique du foie vers une
cirrhose décompensée a un retentissement profond sur le
métabolisme hépatique et, ultérieurement, sur la masse
musculaire et le poids. Cela a pour conséquence une
perturbation de l’état nutritionnel, avec un amaigrissement
et une carence protéinique sévère. Un état nutritionnel
précaire est prédictif d’un allongement de durée de séjour
en soins intensifs et d’un risque infectieux plus important
en post-TH.
Par ailleurs, le tabagisme est plus fréquent chez les patients
atteints d’une cirrhose alcoolique [4]. L’effet synergique du
tabac et de l’alcool en terme de carcinogenèse est
reconnu. Il est impératif de réaliser un dépistage approfondi
en pré-TH chez ces patients alcoolo-tabagiques des
tumeurs bronchiques et des voies aérodigestives supé-
rieures qui sont une contre-indication absolue à la TH.
Les dommages psychiques de l’alcool, tels que l’anxiété
ou la dépression peuvent également se décompenser en
post-TH. Des symptômes dépressifs sont présents chez
plus de la moitié des malades avec cirrhose alcoolique et
l’anxiété généralisée en concerne plus d’un tiers.
La rechute
La singularité de la TH pour maladie alcoolique du foie est
liée au risque de reprise d’une consommation d’alcool
après la greffe, considérée à tort ou à raison comme
inacceptable. Les données de la littérature montrent des
taux de rechute de la consommation d’alcool après TH
très variés allant de 7 % à 95 % à trois ans. Il est cependant
très difficile de comparer ces études entre elles. En effet, la
définition de la rechute varie selon les études : la plupart
utilisent une définition absolutiste qui considère toute
consommation d’alcool après la greffe comme une
rechute, quelle que soit la fréquence ou la quantité [5-7].
D’autres utilisent une définition différenciée [8-12] qui
consiste à séparer ce qui relève de l’alcoolodépendance
telle qu’elle est définie dans le Diagnostic and Statistical
Manual (DSM) IV de la reprise d’une consommation
d’alcool caractérisée par sa fréquence et sa quantité.
Cette définition sépare ainsi trois situations cliniques
concernant la consommation d’alcool après la greffe :
l’abstinence, la rechute modérée, et la rechute sévère.
La rechute sévère concerne les patients présentant des cri-
tères d’alcoolodépendance, et/ou une consommation
d’alcool supérieure à 210 g par semaine pour les hommes
et 140 g par semaine pour les femmes (critères OMS), et/ou
une consommation d’alcool supérieure à 50 g les jours de
consommation. Certaines études ne considèrent que la
rechute excessive c’est-à-dire supérieure à 30 g/jour ou
40 g/jour selon les études [13-15]. Enfin, le « slip », qui est
une prise d’alcool isolée ou lors d’un événement avec
poursuite de l’abstinence, est un concept récent qui n’est
pas considéré comme une rechute dans la définition
différenciée. Il n’yad’ailleurs aucune différence de survie
significative dans la littérature entre les patients présentant
un épisode de « slip » après la TH et les abstinents [12].
Le diagnostic précoce de la rechute est difficile car toutes
les méthodes de détection de la rechute, analysées de
façon individuelle, sont imparfaites [16]. Certaines études
utilisent l’interrogatoire du patient et de son entourage
[5, 6, 8, 17], d’autres le questionnaire anonyme [9, 10],
d’autres l’interrogatoire téléphonique [7], avec parfois
corrélation aux tests biochimiques [7, 17]. Le diagnostic
de rechute est difficile tant en post- qu’en pré-TH, les
patients pouvant cacher leur consommation alcoolique
afin de ne pas être exclus de la liste [18]. Enfin, toutes les
études citées n’ont pas le même suivi moyen et plusieurs
études montrent que le taux de rechute augmente avec la
durée du suivi [19, 20].
“
La singularité de la transplantation
hépatique pour maladie alcoolique
du foie est liée au risque de reprise d’une
consommation d’alcool après la greffe
”
Au final, en tenant compte de toutes ces études, la rechute
alcoolique à cinq ans après TH est estimée entre 11 et 54 %
avec 7 à 26 % de récidive excessive [21].
En dehors du champ de la transplantation, il existe peu de
facteurs prédictifs de rechute chez les patients alcooliques.
La TH peut être ressentie comme une expérience trauma-
tique par certains patients et exercer une action préventive
sur la rechute. La culpabilité ressentie par certains patients
vis-à-vis du donneur peut exercer le même effet. Le facteur
prédictif de rechute en post-TH le plus souvent rapporté est
la durée d’abstinence avant l’inscription sur liste [10].
284 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 n
o
4, juillet-août 2010
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

En 1993, la conférence de consensus de Paris prônait une
durée d’abstinence avant l’inscription sur liste de greffe
de trois à six mois, voire plus. En 2005, la conférence
de consensus de Lyon stipulait que « la durée de 6 mois
d’abstinence avant la TH ne devait plus être une règle
intangible et ne devait pas être considérée comme une
condition à elle seule d’accès à la TH ». Le rationnel de
« la règle des six mois » est de permettre une récupération
de la fonction hépatocellulaire avec le sevrage, afin d’éviter
une transplantation inutile, de mettre en place une prise
en charge addictologique avec renforcement du sevrage
et d’instaurer une uniformité entre les différents centres
de greffe [2]. En 2005, aux États -Unis, 85 % des centres
de TH continuaient de suivre la règle des six mois [22].
Cependant, aucune étude n’a prouvé l’intérêt d’une
abstinence de six mois sur les complications pré-, péri- ou
post-opératoires précoces dans la TH [23].
Les autres variables identifiées comme facteurs prédictifs
de rechute sont le jeune âge, les antécédents familiaux
d’alcoolisme, les antécédents personnels de toxicomanie,
un contexte dépressif avec idées suicidaires et des
conditions sociales précaires. Dans notre expérience, les
antécédents familiaux d’alcoolisme et l’alcoolodépendance
étaient les principaux facteurs prédictifs de rechute [10].
Afin de faire la distinction entre abus d’alcool et alcoolodé-
pendance, l’un des outils les plus utilisés en milieu clinique
est le DSM IV, valide et reproductible et recommandé au
niveau international.
Dans la littérature, toutes les études sont concordantes sur
le fait que la survie du greffon et du patient à cinq ans ne
sont pas modifiées par la rechute alcoolique, même en
différenciant les rechuteurs excessifs des occasionnels
[8, 13, 17] (figure 1). En revanche, deux études ont montré
que la rechute excessive diminuait la survie au-delà de cinq
ans, avec une surmortalité imputable à l’apparition
de cancers de novo et à la survenue de complications
cardiovasculaires [12, 15].
“
La survie du greffon et du patient
àcinqansn’est pas modifiée
par la rechute alcoolique
”
Le fait qu’une rechute de la consommation d’alcool soit
possible après TH pour maladie alcoolique du foie peut
avoir un effet désastreux sur l’opinion publique, influencée
alors par des arguments d’ordre moral. La cirrhose
alcoolique du foie est parfois encore jugée comme une
maladie « auto-infligée ». Ceci peut avoir des conséquen-
ces néfastes sur le don d’organes, et aggraver la situation
de pénurie de greffon. Dans une étude anglaise ayant
interrogé 1 000 personnes dans la population générale
[24], l’opinion publique avait classé les patients cirrhotiques
alcooliques dans le groupe le moins prioritaire pour recevoir
un greffon hépatique, et ce quelle que soit la pertinence
de l’indication de TH.
En raison de leur mauvaise image dans la société, les
patients ayant une cirrhose alcoolique sont moins souvent
adressés aux centres de transplantation. Dans une étude
portant sur 199 candidats potentiels à une TH pour cirrhose
alcoolique décompensée, seulement 41 (21 %) ont été
adressés à un centre référent et seulement 15 (8 %) ont
eu une évaluation complète avec un bilan prégreffe finalisé
[25]. Une autre étude menée en 2008 aux États-Unis a
confirmé ces chiffres, avec un taux de patients atteints
de cirrhose alcoolique décompensée confiés à un centre
référent pour bilan prétransplantation variant entre 5 et
10 % [21]. De plus, sur l’association de critères médicaux,
Mois
Consommateurs
excessifs
Abstinents
Consommateurs
occasionnels
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
02040
60 80 100 120
Taux de survie après transplantation hépatique
140
Figure 1. Taux de survie après transplantation hépatique : comparaison entre abstinents, consommateurs occasionnels ou excessifs.
(D’après [17]).
285
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 n
o
4, juillet-août 2010
Transplantation pour cirrhose alcoolique
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

chirurgicaux et psychiatriques, certains programment
récusent plus de 50 % des cirrhotiques alcooliques adres-
sés pour TH [14]. Au final, seule une petite proportion,
estimée à 6 %, des malades susceptibles de décéder
d’une cirrhose alcoolique sont transplantés [26].
Les cancers de novo
La survenue de cancers de novo est une des complications
émergentes à long terme après TH, en particulier chez les
patients greffés pour cirrhose alcoolique. Un risque majoré
de cancer de novo, notamment des tumeurs des voies
aérodigestives supérieures après TH pour cirrhose alcoo-
lique a été démontré [27]. Jain et al. [3] ont trouvé un risque
relatif multiplié par 25,4 de développer un carcinome de
l’oropharynx chez les patients greffés pour cirrhose alcoo-
lique. La survenue d’un cancer de novo diminuait de
manière significative la survie à long terme avec un risque
de décès multiplié par 3,5 dans la série publiée en 2007 par
Dumortier et al. [13] (figure 2).Ils’agissait majoritairement
de tumeurs ORL et du tractus digestif. Les facteurs de risque
de développer un cancer de novo étaient le sexe masculin
et le tabac. Un risque accru de développer un cancer du
poumon chez les patients transplantés pour maladie alcoo-
lique du foie a été mis en évidence sur le suivi à long terme
[3]. Dans une autre étude publiée en 2007 [4], le taux
de cancers du poumon chez les patients transplantés pour
cirrhose alcoolique était de 4,3 % versus 0,7 % chez les
patients transplantés pour maladie non alcoolique du foie.
DiMartini et al. [28] se sont intéressés à l’intoxication
tabagique post-TH des transplantés hépatiques pour
cirrhose alcoolique ; plus de 40 % des patients étaient
fumeurs en post-TH avec, en général, du fait de la nicotino-
dépendance, une majoration de leur consommation taba-
gique au fil du temps. La poursuite d’une intoxication
tabagique était trouvée chez tous les patients rechuteurs
excessifs [15].
“
La survenue de cancers de novo
est l’une des complications émergentes
à long terme après transplantation
hépatique
”
Cette susceptibilité aux cancers en post-TH, du fait de
l’immunosuppression induite, doit faire peser chaque
indication de TH. Elle ne doit être proposée qu’aux patients
avec cirrhose alcoolique décompensée. En effet, en cas de
TH chez ces patients cirrhotiques Child B, un risque accru de
cancer de novo post-TH, hors carcinome hépato cellulaire,
a été constaté [29].
Le bénéfice de la TH doit être évalué face au risque de déve-
lopper un cancer de novo en post-TH pour un patient
cirrhotique alcoolique.
Situation particulière :
l’hépatite alcoolique aiguë
Les formes sévères d’hépatite alcoolique aiguë sont définies
par un score de Maddrey supérieur à 32. En l’absence de
traitement, plus de 50 % des patients atteints d’hépatite
1
8
6
4
2
0
0246810121416
kc
Années
Taux de survie
o
Figure 2. Courbes de survie en fonction de la survenue d’un cancer de novo (Kc).
D’après [13].
286 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 n
o
4, juillet-août 2010
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%