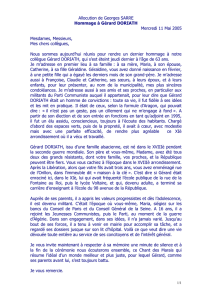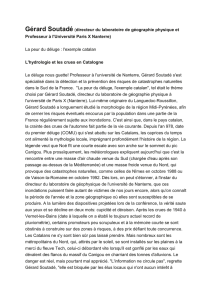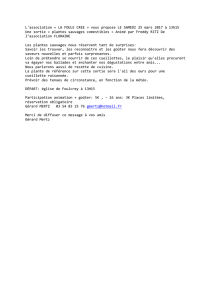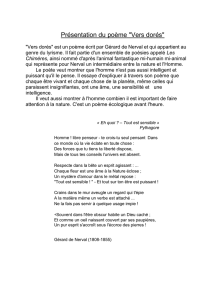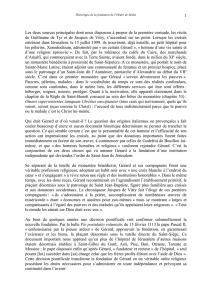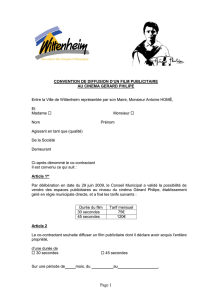Les Cahiers de la Maison Jean Vilar

Les Cahiers de la Maison Jean Vilar
N° 108 - JUILLET 2009
Gérard Philipe 50 ans après...
108

SOMMAIRE
Gérard Philipe : récit d’une vie
par Rodolphe Fouano 2
Gérard Philipe vu par... 38
Gérard Philipe, le symbole de l’après-guerre
par Claude Choublier 48
La création du personnage
par Georges Sadoul 50
Un mythe ou un homme ?
par Philippe Tesson 56
Petit récit d’apprentissage
par Jacques Lassalle 60
Une histoire sans fi n
par Jacques Téphany et Rodolphe Fouano 68
Tout sur Gérard Philipe
à la Maison Jean Vilar 70
Vilar aujourd’hui 72
Maurice Jarre 74
Jean Leuvrais 77
Roger Planchon 78
Gérard Philipe et Jean Vilar. Tournée TNP en Pologne, octobre 1954.
Photo Kyszard Kowalczyk. Collection Association Jean Vilar /
Fonds famille Gérard Philipe.
Page 81 : Répétition, Avignon 1958. Photo Mario Atzinger.

1
“ ).
”
éditorial
Jacques Téphany
ÉÉ
É
É
É
DD
D
D
II
T
T
T
O
O
O
O
O
R
R
R
R
R
II
I
I
I
AA
A
A
A
L
LL
L
L
L
pa
pa
pa
pa
pa
r
r
r
r
r
Ja
JaJa
Ja
Ja
cqcq
cq
ue
ue
ue
ue
ue
e
e
e
s
s s
s
s
TéTé
Té
Té
Té
phphphph
h
p
a
an
an
an
an
n
yy
y
y
y
IlIlIl
Il
Il
I
é
é
é
é
é
ta
ta
ta
ta
ta
itititit
it
u u u
u
u
u
n
n
n
n
n
n
n
n
prpr
pr
pr
pr
p
p
in
in
in
in
in
ce
ce
ce
ce
e
ce
e
e e
e
e
e
e
n n
n
n
n
n
AvAvAvAvAv
A
igigig
ig
ig
g
nono
no
no
no
nn
n
n
n
e
e
e
e
e
e
st
st
stst
st
t
u
u
u
u
u
nenene
ne
ne
n
b b b b
b
b
ieieie
ie
ie
ie
n n
n
n
n
jo
jo
jo
jojo
jo
lilili
li
li
l
e e e e
e
e
ch
ch
chch
ch
h
an
anan
an
an
soso
so
so
so
n
n
n
n
n
ququ
qu
qu
qu
qu
u
u
’o
’o
’o’o
’o
o
n
n
n
n
n
n’n’
n’
n’
n
n
n’
n
en
en
e
enen
en
n
e
tete
te
te
te
te
nd
nd
nd
nd
nd
d
p
p p
p
p
p
lululu
lu
lu
l
s
s
s
s
s
sososo
so
o
s
uvuvuv
uv
uv
u
en
en
enen
en
en
t t t
t
t
t
su
su
su
su
su
s
r r
r
r
r
no
nonono
no
o
o
s
s
s s
s
on
on
on
on
on
n
o
o
n
n
n
de
de
de
de
de
e
d
d
s.s.
s.
s
s.
El
El
El
El
le
le
le
e
a
a
a
a
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ou
ou
o
ou
o
ou
ou
ou
ou
ou
o
rt
rt
rt
rt
rt
r
r
t
ananan
anan
an
t
t t t
t
t
bebe
be
be
be
e
e
be
rcrc
rc
rc
rc
é é é
é
é
é
la
lalala
la
la
n n n
n
n
n
ososos
os
os
os
tatata
ta
ta
a
lglglg
lg
lg
lg
ie
ie
ie
ie
i
ie
e
d d
dd
d
d
e e e
e
e
e
ce
ce
cece
ce
uxux
ux
ux
ux
u
q q
q
q q
q
ui
ui
uiui
ui
ui
a
a
a
a
a
a
v
v
va
a
a
a
a
v
va
a
a
v
v
v
v
ie
ie
ie
ie
ie
ie
e
e
ntnt
nt
nt
nt
nt
nt
t
coco
co
co
co
c
c
nnnnnn
nn
nn
u
u u
u
u
u
et
et
et
et
et
e
et
e
e
e
et
e
d
d
d
d
d
d
e
e e
e
e
ce
ce
ce
cece
c
uxux
ux
u
ux
x
x
x
x
q q
q
q
q
q
q
uiui
ui
uiui
u
u
n
n
n
n
n
n
’a
’a
’a
’a
’a
va
vava
vava
a
ie
ieieie
ie
e
e
e
nt
nt
nt
nt
nt
n
p p p
p
p
p
p
asasasas
as
a
as
a
c
c
c
c
c
c
onon
on
on
on
on
n
n
nunu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
l l
l
l
l
l
l
e e e
e
e
e
e
héhé
hé
hé
hé
hé
ro
ro
ro
ro
ro
o
o
ro
o
o
o
o
r
r
sss
s
s
s
s
s
dedede
de
de
de
e
s s
s
s
s
s
anan
an
an
n
an
an
né
né
né
né
n
n
é
né
é
n
né
é
n
é
n
n
eses
es
es
es
s
e
d d
d
d
d
d
d
d
e e
e
e
e
e
e
lé
lé
l
é
lé
é
é
é
gege
ge
ge
ge
ge
g
ge
g
ndnd
nd
nd
nd
d
n
n
e e
e
e
e
du
du
dududu
F
F
F
F
F
F
eseses
es
es
es
s
ti
titi
ti
ti
ti
ti
t
vava
va
va
va
va
va
a
v
l l
l
l
l
l
d’d’
d
d’
d’
d’
AvAv
Av
A
Av
Av
v
Av
igig
ig
ig
ig
ig
ig
g
nono
no
no
no
no
no
n.n.
n
n.
n
n
n
Po
Po
Po
Po
Po
P
o
Po
ur
u
ur
ur
ur
ur
ur
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
utut
ut
ut
ut
u
t
t
u
u
t
u
u
u
u
anan
an
an
an
n
an
an
an
t,t,
t,
t,
t,
t,
t,
t
i i
i
i
l
l l
l
l
l
l
l
ne
ne
ne
ne
ne
ne
n
p p
p
p
p
p
p
p
ouou
o
ou
o
ou
ou
vava
va
va
va
va
va
itit
it
it
it
s s
s
s
s
s
s
s
’a’a
’a
’a
’a
’a
’a
gi
g
gi
g
g
gi
gi
g
r r
r
r
r
r
da
da
da
da
da
da
d
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
c c
c
c
c
c
c
e
e
e
e
e
e
e
nunu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
u
mémé
mé
mé
mé
mé
mé
é
m
r
ro
ro
ro
o
o
o
ro
r
r
r
o
spsp
sp
sp
sp
s
p
sp
sp
éc
éc
éc
éc
éc
éc
éc
éc
ia
ia
ia
iaia
a
i
ia
ia
ia
i
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
co
co
co
c
co
co
c
o
c
c
c
c
ns
ns
ns
ns
ns
ns
n
ns
ac
ac
ac
ac
ac
ré
réré
ré
ré
ré
à
à
à
à
à
à
à
à
G G
G
G
G
G
G
G
ér
ér
ér
ér
ér
ér
é
arar
ar
ar
ar
ar
r
d
d
d
d
d
d
d
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
h
il
il
il
il
il
i
il
l
l
ip
ip
ip
ip
ip
p
ip
p
e
e
e e
e
e
ci
ci
c
ci
ci
ci
ci
nqnq
nq
n
nq
nq
q
nq
uaua
uaua
ua
ua
ua
a
u
ntnt
nt
nt
nt
nt
nt
n
n
e e
e
e
e
e
e
e
an
an
an
an
an
an
n
an
a
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
apapap
ap
p
ap
ap
a
a
rè
rè
rè
rè
rè
rè
rè
è
s
s s s
s
s
sa
sa
sa
sa
sa
sa
sa
sa
s
sa
sa
s
sa
sa
sa
sa
s
d
d
d
d
d
d
is
is
is
s
i
i
is
s
s
papapa
pa
pa
p
p
riri
ri
ri
ri
ri
titititi
ti
ti
i
on
o
on
on
on
o
on
n
p p
p
p
p
p
p
ré
ré
ré
ré
ré
ré
ré
ré
mama
ma
ma
ma
m
ma
a
m
tu
tu
tu
tu
tu
t
u
u
réréré
ré
ré
é
e,
e,
e,
e,
e,
e,
d d
d
d
d
d
d
d
’i
’i
’i
’i
i
’i
do
do
do
do
do
do
d
d
lâ
lâlâ
lâ
lâ
â
trtr
tr
r
tr
r
tr
er
er
er
er
er
er
r
e
u u
u
u
u
u
u
u
u
n
n
n
ne
ne
e
e
e
ee
e
n
dededede
de
e
s
s
s
s
s
icic
ic
ic
ic
ic
ô
ônôn
ôn
ôn
ôn
ôn
ôn
ô
ô
ôn
ôn
ôn
ô
ô
e
es
es
es
es
es
e
e
l
l
l l
l
l
es
es
eses
es
es
s
p
p p p
p
p
lulululu
lu
lu
lu
l
s s s
s
s
émém
é
émém
ém
m
ou
ou
ououou
vavavava
va
nt
ntntntnt
n
n
eses
es
es
es
s
d d d d
d
d
e e
e
e
e
e
nono
no
no
no
no
trtrtr
tr
tr
tr
tr
r
e e
e
e
e
e
mé
mé
mé
mé
mé
mé
mo
mo
mo
mo
mo
o
m
irir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
r
e e
e
e
e
e
e
e
e
cocococo
co
o
llllll
ll
ll
l
ec
ec
ec
ec
ec
ec
ec
e
e
t
t
ti
ti
ti
ti
ti
t
t
ti
t
t
veve
ve
ve
ve
ve
v
v
.
.
.
.
.
NoNo
No
No
No
No
N
o
usus
us
us
us
s
u
s
us
a
a
a
a
a
a
vovo
vo
vo
vo
vo
nsns
ns
ns
ns
s
t t
t
t
t
t
t
en
en
en
en
en
en
e
té
té
té
té
té
té
t
d d
d
d
d
d
e
e
e
e
e
e
e
fafa
fa
fa
fa
f
irir
ir
ir
i
ir
e
ee
e
e
e
re
rerere
re
re
vi
vi
vivivi
v
vrvrvrvr
vr
vr
e e
e
e
e
un
un
unun
u
un
e e
e
e
e
ex
ex
exex
ex
ex
e
ex
ex
e
is
isis
s
is
s
i
s
s
s
te
te
te
te
te
e
e
te
te
e
nc
n
n
n
nc
c
nc
c
n
c
n
n
n
e
e
e
e
e
e
e
trtr
tr
tr
tr
tr
t
opop
op
op
op
p
op
op
p
o
p
p
b b
b
b
b
b
b
b
b
rè
rè
rè
rè
rè
è
r
ve
ve
ve
ve
ve
e
e
e
ve
ve
e
e
e
e
e
e
e
e
e
t
t t
t
t
t
t
t
si
si
si
si
si
si
si
si
si
r
r
r
r
r
r
r
r
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
on
onon
on
on
on
n
n
na
na
na
na
na
n
a
n
nt
nt
nt
nt
nt
t
n
nt
n
n
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
!
!
!
!
!
!
!
NoNoNoNo
No
No
u
u
us
us
us
s
s
u
u
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
om
omom
omom
o
om
o
om
m
me
m
m
m
me
me
me
me
e
me
e
s s
s
s
s
s
s
s
s
papapa
pa
pa
a
pa
p
a
pa
pa
rtrtrt
t
rt
rt
rt
isis
s
is
is
s
is
s
s
à à
à
à
à
à
à
à
à
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
re
re
rere
re
re
r
r
re
r
r
c
ch
c
ch
c
chch
ch
c
h
c
er
er
e
e
ch
h
h
h
e
e
dede
de
d
d
de
de
de
de
d
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
ér
ér
ér
ér
ér
ér
ér
r
ér
ér
ér
r
r
ér
r
r
r
é
é
é
r
a
a
a
a
a
a
a
ar
ar
ar
ar
a
a
ar
ar
r
a
a
r
d d
d
d
d
quququ
qu
qu
qu
u
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
n
n
n
no
no
nono
no
no
no
o
no
no
no
no
no
u
us
u
u
us
us
us
u
u
u
us
u
s
a
a
a a
a
a
a
a
ur
urur
ur
ur
ur
ur
r
a a
a
a
a
a
a
susususu
su
su
s
rprprprp
rp
rp
riririri
ri
i
s s s s
s
s
plplpl
pl
pl
pl
usususus
us
us
u
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
’u
’u
’u
’u
’u
u
u
u
’
u
nene
ne
ne
ne
ne
f
f
f f
f
f
oioioi
oi
oi
oi
s s
s
s
s
s
s
s
s
:
:
:
:
:
:
a
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
u
au
a
a
u
u
u
-d
-d
d
-d
-d
-d
-d
-d
-d
-d
d
-d
d
-d
-d
d
d
d
d
-
d
d
d
e
e
el
elelelel
e
el
e
e
el
e
àà
à
à
à
à
de
de
de
dede
de
de
de
de
de
de
de
de
de
d
e
e
e
s
s
s
s
s
s
s
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
im
im
im
im
im
m
m
im
im
im
im
i
im
m
i
i
m
ag
a
ag
ag
ag
g
g
a
a
a
a
eseses
es
es
e
a a a
a
a
a
a
u u u
u
u
no
nononono
n
o
iririr
ir
ir
r
e
e e
e
e
e
t t
t
t
t
t
blblblbl
bl
l
ananan
an
an
n
c
c
c
c
c
c
d’d’d’
d’
d’
d’
d’
d’
’
’
d’
d’
d’
’
’
d
d
ét
ét
ét
ét
ét
é
é
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
étét
ét
er
er
ererer
er
er
er
er
er
er
r
r
er
er
er
e
ni
ni
ni
i
ni
ni
i
ni
ni
ni
ni
n
ni
n
ni
ni
i
té
té
té
é
té
té
té
té
té
té
té
té
té
té
té
té
é
( ( ( (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Ro
RoRo
Ro
Ro
Ro
Ro
R
Ro
Ro
Ro
Ro
Ro
Ro
R
Ro
Ro
R
Ro
o
R
d
d
d
d
dr
dr
drdr
dr
d
d
d
d
d
dr
d
d
dr
igigig
i
ig
g
ig
g
ueue
ue
ue
u
ue
u
ue
,
,
,
,
Ho
Ho
HoHo
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
H
Ho
Ho
Ho
o
H
mb
mb
mbmb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
m
m
m
m
b
ou
o
ou
ou
ou
ou
ou
u
ou
ou
o
o
o
u
rgrg
rg
rg
rg
r
rg
rg
rg
rg
g
, ,
,
,
,
Fa
FaFaFa
Fa
Fa
a
nfnf
n
nfnf
nf
anan
an
an
an
a
, , ,
,
,
,
FaFa
Fa
FaFa
Fa
brbrbrbr
br
br
icic
ic
ic
ic
ic
e e e
e
e
e
e
dede
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
d
e
e
d
d
l l
l
l
l
l
l
l
DoDoDo
Do
D
D
Do
Do
Do
Do
Do
o
Do
Do
o
o
Do
o
o
o
ng
ngng
g
g
ng
ng
ng
ng
n
ng
ng
n
n
n
g
n
n
n
o
o,
o,
o,
o,
o,
o,
,
o,
o,
o
o,
o
o
o,
,
R
R
R R R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
uy
uy
uy
uy
uy
y
uy
uy
uy
uy
uy
u
uy
u
u
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
la
la
lalala
la
la
la
l
l
l
s,
s,
s,
s
,
s
s
,
MoMoMo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
M
Mo
M
o
o
M
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
s
ns
s
ns
n
s
s
ns
ns
ie
ie
ie
ie
ie
ie
ie
e
ie
ie
i
ie
e
ie
i
i
ur
u
ur
ur
ur
ur
ur
u
R R R
R
R
R
R
ipipip
ip
ip
p
p
p
oi
oioi
oi
oi
oi
s…
s…
s…
s…
s…
s…
s
…
),
),
),),
),
),
),
)
)
n n
n
n
n
n
n
ou
ou
ou
ou
ou
o
ou
u
u
u
u
u
u
u
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
a
a
a
a
a
av
av
av
av
av
v
v
a
a
v
a
av
a
a
av
a
a
o
o
o
o
o
on
on
n
n
o
n
n
n
n
n
o
n
on
n
s
s
s s
s
s
s
s
s
apap
ap
ap
ap
ap
ap
p
p
ap
ap
ap
a
p
pr
pr
pr
pr
p
pr
pr
pr
pr
r
r
pr
r
pr
pr
r
r
is
is
is
is
is
is
is
i
is
is
i
s
s
à
à à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
onon
on
n
n
on
n
n
on
o
nana
na
na
n
a
na
na
ît
ît
ît
ît
ît
ît
ît
rerere
re
re
r
re
lelele
le
le
le
le
le
e
le
le
le
le
e
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
hihi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
h
i
h
hi
h
hi
i
h
hi
en
en
en
en
en
en
en
n
e
e
en
e
e
en
en
e
n
n
e
f f
f
f
f
f
ou
ou
ou
ou
ou
ou
o
o
u
d d
d
d
d
d
d
d
u u
u
u
u
u
u
Co
Co
Co
Co
Co
o
Co
Co
o
Co
ns
ns
nsnsnsns
ns
ns
s
e
e
e
e
e
er
er
erer
er
er
er
er
e
r
e
er
er
e
er
r
r
r
va
va
va
va
va
va
va
v
va
va
v
v
va
va
v
va
v
v
t
t
to
t
to
to
to
to
o
to
t
to
o
o
ir
ir
ir
ir
ir
e
e,
e,
e
e,
e,
,
,
l
l
l
l
l
l
l
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
co
co
co
co
co
o
co
co
co
co
co
c
co
co
co
co
c
c
co
c
c
c
c
c
c
o
m
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
m
mb
b
mb
mb
mb
mb
at
a
at
at
at
at
a
a
a
a
t
a
tatata
ta
ta
ta
a
a
t
a
a
nt
n
n
nt
nt
nt
t
t
t
t
t
d
d
d
d
d
d
d
d
e
e
e
e
e
e
e
la
la
la
la
la
la
la
la
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
Ré
é
Ré
Ré
Ré
é
é
é
s
s
s
s
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
s
s
si
s
s
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
an
an
an
anan
an
an
an
an
an
an
a
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
c
ce
ce
ce
c
,
,
,
,
,
,
,
,
,
le
le
le
lele
e
m m m
m
m
m
m
il
il
i
il
il
il
l
itititit
it
t
it
it
t
t
t
t
t
t
an
an
an
anan
an
an
an
an
an
a
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
dede
de
de
de
de
d
l
l l
l
l
l
l
a
a
a a
a
a
PaPaPa
Pa
Pa
a
a
ixix
ixix
x
ix
ix
x
x
,
,
,
,
,
l’
l’
l’
l’
l’
l’
l’
l’
l
l’
l’
l’
l’
l’
’
l’
l
l’
l’
l
l
a
a
am
amam
am
am
amam
am
a
i i
i
i
i
i
i
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
dè
dè
dè
dè
dè
dè
le
le
lele
l
le
l
l
l
e
e
, ,
,
,
,
,
,
le
le
le
le
le
le
e
e
dididi
di
d
d
d
i
di
di
d
d
d
d
scsc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
s
s
sc
sc
s
s
c
sc
sc
sc
sc
c
ipip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
p
p
p
p
ip
p
p
p
le
le
le
le
le
le
le
lele
le
le
l
é é é é
é
é
é
é
é
é
é
vi
vi
vivivivi
vi
vi
v
v
de
de
de
de
d
de
de
de
d
d
d
de
d
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
n
n
e
e
e
e
e
e
e
e
t t t
t
t
t
popo
p
po
po
po
p
p
ur
ur
ur
ur
ur
ur
u
tatatata
ta
ntntntnt
nt
t
t
t
t
i
i
i
i
i
nd
nd
nd
nd
nd
d
oc
o
o
o
o
oc
oc
c
c
c
cc
c
oc
c
c
c
oc
c
il
i
i
il
i
il
il
il
il
l
i
l
l
l
il
i
i
l
l
i
l
i
l
l
il
l
i
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
d
d
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
e
de
e
e
d
Je
Je
JeJe
Je
e
J
e
e
Je
J
e
J
J
an
an
an
an
an
an
an
an
an
n
n
n
an
a
an
a
n
a
a
a
V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
ilililil
il
il
i
il
i
il
arar
ar
ar
arar
ar
r
,
,
,
,
,
,
,
,
le
lele
le
le
le
s s
s
s
s
ymym
ym
ym
ym
ym
m
ym
ym
ym
ym
y
bo
bo
bo
bo
bo
b
o
o
b
o
o
lele
e
lele
l
d
d
d
d
d
d
d
’u
’u’u’u
’u
nenenene
ne
e
e
e
g
g
g
g
g
g
g
g
én
én
én
én
én
é
é
é
ér
ér
ér
r
r
r
r
r
r
r
é
r
r
é
a
a
a
a
a
a
at
at
at
at
t
a
at
a
at
a
a
a
a
io
io
io
io
io
io
io
io
io
n
n
n n
n
n
n
d’
d
d
d’
d’
d’
d
’
d’
d
ap
ap
ap
ap
ap
ap
ap
ap
p
p
r
r
r
r
rè
rè
rè
rè
r
rè
è
è
è
è
è
è
è
s-
s-s-
s-
s-
s-
s-
s-
s-
s
g
gugugu
u
gu
u
gu
gu
g
u
gu
g
gu
gu
u
erer
er
er
er
er
er
e
e
er
er
er
e
er
er
e
er
e
re
re
re
re
re
re
re
e
re
re
e
re
re
r
re
e
r
e
e
e
e
e
e
e
e
e
xa
xa
xa
xa
a
a
xa
x
a
a
x
x
lt
l
lt
lt
t
lt
t
l
t
éeée
ée
ée
ée
ée
ée
p p
p
p
p
p
p
arar
ar
ar
ar
a
ar
a
ar
a
a
l l
l
l
l
l
l
l
e e
e
e
e
e
sese
se
se
se
se
s
e
ntnt
nt
nt
nt
n
imimimim
m
im
m
m
m
m
im
m
m
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
e
e
n
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
de
d
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
d
de
de
d
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a a
a
a
a
a
lilili
li
li
li
be
b
be
be
be
be
b
be
e
be
be
e
rt
rt
t
rt
rt
rt
rt
é
é
é
é
é
é
re
re
r
re
re
r
re
re
r
r
e
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
t
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
u
u
ou
o
u
o
v
v
v
v
vé
vé
vé
vé
vé
v
v
v
v
vé
é
é
é
e,
e,
e,
e,
e,
,
e,
e
,
l
l
l
l
l
l
l
’h’h
’h
’h
’h
’h
h
h
h
omom
om
om
om
om
om
om
o
om
m
om
meme
me
me
me
me
me
m
m
m
m
d
d
d
d
d
d
’u’u
’u
’u
’u
’u
u
u
ne
ne
ne
ne
ne
ne
n
s
s
s
s
s
s
eueu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
u
eu
eu
eu
u
u
u
l
l
l
l
le
l
le
l
l
l
le
le
le
le
e
e
e
m
m
m
m
m
m
us
us
us
usus
us
us
s
q
iqiqiq
iq
iq
ue
ue
ue
ue
ue
u
–
–
–
c
c
c
c
c
el
el
el
el
l
el
l
l
e
ll
l
le
l
le
le
le
le
e
l
le
l
le
le
e
e
e
e
e
d’d’d’
d’
d’d’
d’
d’
d’
d
d’
’
d’
d’
d’
d’
d
d
AnAn
An
An
An
An
An
An
An
A
An
A
n
An
An
n
n
A
An
A
A
ne
ne
ne
n
ne
ne
ne
ne
e
e
e
n
ne
ne
ne
e
e
n
n
e
n
, , ,
,
,
so
so
so
s
so
so
so
o
o
n
n
n
n
n
n
n
épép
ép
ép
ép
ép
ép
ép
p
p
é
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
o
ou
ou
u
u
se
se
se
e
se
s
se
e e
e
e
e
e
e
t t t
t
t
t
lala
la
la
la
la
m m
m
m
m
m
èr
èrèr
è
èr
èr
è
èr
r
r
è
r
r
r
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
de
de
de
d
de
de
de
e
s
s
s
s
s
s
s
s
es
es
es
es
es
es
e
d
d
d d
d
eueu
eu
e
eu
x x
x
x
x
en
en
en
en
en
en
en
en
e
en
e
n
a
a
fa
fa
fa
fa
a
a
a
a
fa
a
fa
fa
f
f
a
a
f
nt
nt
nt
nt
nt
nt
t
nt
nt
nt
t
t
n
nt
t
n
n
nt
n
t
s s
s
s
s
s
s
–
–
–
–
–
–
–
–
,
,
,
,
,
,
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
e
e
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
yn
yn
yn
yn
yn
yn
n
yn
yn
yn
n
y
yn
yn
n
n
n
y
y
y
n
y
y
di
di
d
di
di
d
di
d
d
d
d
i
ca
ca
ca
caca
ca
lilili
li
li
i
l
i
ststst
st
st
st
st
s
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
vi
vi
vi
v
vi
i
v
v
vi
ru
ru
r
ru
ru
u
u
r
r
r
u
u
u
u
le
le
le
le
le
le
nt
nt
nt
nt
t
t
t
t
t
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
l
le
le
le
le
l
le
le
le
le
le
le
le
e
e
e
e
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
it
it
it
it
it
it
it
it
it
t
it
it
it
it
it
i
it
it
i
t
it
it
it
it
it
it
it
t
t
oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy
o
o
oy
o
o
o
oy
o
o
o
o
o
o
o
y
o
y
y
y
y
en
en
e
en
en
n
n
n
e
n
en
en
en
en
n
n
e
n
en
n
memememe
me
me
me
e
me
me
e
e
tt
t
tt
tt
tt
t
tt
tt
tt
t
tt
t
t
a
a
an
an
a
a
an
an
an
a
n
n
n
an
n
a
a
a
a
a
t
t
t t
t
t
t
t
sasa
sa
sasa
sa
n n
n
n
n
n
n
n
n
otot
ot
ot
ot
t
t
t
t
ot
ot
ot
t
or
o
o
o
ororor
o
or
r
o
or
or
or
o
ié
ié
ié
ié
ié
ié
é
é
tété
té
té
té
é
a a
a
a
a
u u
u
u
u
u
se
se
s
s
se
se
e
e
e
e
se
e
s
e
e
r
rvrvrv
rv
r
rv
rv
rv
rvrv
rv
r
r
rv
ic
ic
ic
ic
ic
c
ic
ic
ic
i
ic
ic
ic
ic
c
ic
i
e
e
e
e
e
e
e
e
de
de
de
de
de
e
e
e
e
e
e
j j
j
j
j
j
j
j
j
us
us
us
us
us
us
us
us
s
us
us
us
us
s
s
us
s
us
s
s
s
u
te
te
te
te
te
te
e
e
t
t
te
e
e
e
e
e
e
e
e
e
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
ca
ca
ca
ca
ca
a
a
a
ca
ca
ca
a
a
c
c
ususus
us
us
us
us
us
u
us
u
s
u
s
es
eseses
es
es
es
es
es
es
e
es
e
e
es
e
,
,
, ,
,
,
,
,
lala
la
la
la
la
la
la
la
la
l
l
l
l
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
eded
ed
ed
ed
ed
d
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
d
ed
d
d
e
d
e
d
etetet
et
et
et
et
e
t
t
t
t
te
te
te
t
te
te
te
te
te
te
te
te
e
e
te
e
e
l l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ucuc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
u
uc
uc
uc
u
uc
u
u
i
i
id
id
id
i
id
idid
id
d
i
d
i
i
d
i
d
d
i
e
e
e
e
e
e,
e,
e,
e
e
e,
e
e
e,
e,
e
e
e
e
e,
l l l
l
l
’a
’a
’a
’a
a
a
’a
a
a
a
a
rt
r
r
rt
rt
t
t
rt
rt
rt
isis
is
is
is
is
s
s
i
i
te
te
tete
t
t
t
r
r
r
r
r
éiéi
éi
i
éi
i
éi
éi
i
i
éi
éi
éi
n
n
n
nv
n
n
nv
nv
nvnv
n
n
n
n
n
v
en
en
en
e
en
en
en
en
en
t
t
tt
te
tetete
te
te
te
t
te
t
t
te
te
e
t
ur
u
ur
ururur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
r
u
u
u
d d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
es
es
es
es
es
es
s
es
es
es
es
eses
e
es
es
es
e
es
es
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
érér
ér
é
ér
ér
ér
ér
é
é
é
ér
r
é
é
é
é
r
r
os
os
os
os
os
os
os
os
s
os
os
o
s
o
dududu
du
d
du
u
du
du
d
u
u
u
d
u
u
R
R R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
o
o
o
o
o
o
om
omom
m
o
o
om
o
o
o
o
an
an
an
an
an
a
an
ti
ti
ti
ti
ti
t
ti
t
t
ti
sm
sm
sm
sm
sm
sm
s
sm
m
m
sm
m
m
m
m
m
m
m
m
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
etetetet
et
t
p p
p
p
p
p
ou
ou
ou
ou
ou
ou
o
rt
rt
rt
rt
rt
rt
t
anan
an
a
an
an
a
t
t
t
t
t
t
s
s
s
so
so
so
o
o
o
s
s
s
o
s
s
s
o
o
o
o
o
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
c
ie
ieie
ie
ie
ie
ie
ie
ie
e
i
uxux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
ux
x
ux
x
u
d d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
’é
’
’é
’é
’é
é
é
é
’
é
’é
’é
é
’
é
é
é
cr
cr
cr
cr
cr
rr
r
cr
r
r
r
c
r
cr
r
r
r
it
itit
it
it
it
it
t
it
it
t
t
i
i
ururur
ur
r
ur
ur
u
u
r
u
u
u
ur
u
e
e
ee
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
co
co
coco
co
c
co
co
co
c
co
c
c
c
c
c
c
c
co
c
nt
nt
nt
nt
n
nt
t
t
nt
nt
nt
nt
nt
nt
t
t
t
t
t
nt
t
n
t
e
e
e
em
em
em
em
e
e
em
e
e
popopo
po
po
p
po
rara
r
ra
ra
ra
ra
a
a
in
in
i
i
in
in
n
n
n
i
n
n
n
n
n
n
e
e
e
e,
e,
e,
e,
e
e
e,
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n
n
onon
on
on
on
on
p p
p
p
p
p
asas
as
as
as
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
se
se
se
se
e
e
se
se
s
uu
u
ul
ul
ulul
ul
ul
u
u
u
u
u
ul
l
ul
u
u
u
u
,
,
,
,
,
,
,
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
a
a
a
ma
ma
ma
a
ma
ma
m
m
m
ma
a
m
is
is
is
s
s
is
s
is
is
is
s
is
s
s
is
i
l
l l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
’u
’u
’u
’u
’u
’u
’u’u
u
’
’u
’u
’u
u
u
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
de
d
de
dede
de
de
d
e
e
d
d
d
d
d
d
d
d
e
d
e
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
s
s
s
ul
ulul
ul
ul
ul
ul
ul
ul
u
u
u
u
l
s s s
s s
s
s
s
s
s
s
s
se
se
se
sese
se
se
se
se
se
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
se
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
o
lo
o
o
l
o
lo
l
lo
o
n
n
n
n
n
n
ViVi
Vi
Vi
Vi
lalalala
la
l
a
a
a
r r r
r
r
à à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
av
a
a
a
aa
av
av
v
v
av
a
a
a
a
oi
oioi
oi
oi
o
r
r
r
r
r
r
coco
co
co
co
co
mpmp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
riri
ri
ri
r
i
s s
s
s
s
lelele
le
le
l
l
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
pr
pr
pr
pr
r
pr
pr
pr
r
r
p
r
r
r
p
ob
ob
ob
ob
b
b
b
b
b
b
ob
b
ob
b
b
b
o
b
o
b
lèlè
lè
lè
lè
lè
lè
l
lè
è
è
lè
lè
lè
è
è
me
me
meme
me
me
me
me
me
me
me
e
me
p p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
opopop
op
op
op
o
op
op
o
o
p
op
ul
ulul
ul
ul
ul
ul
ul
l
u
l
u
u
u
aiai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
i
rererere
re
re
re
re
e
»»»
»
»»
pa
papa
pa
pa
pa
pa
a
pa
a
p
p
a
a
p
pa
p
r
rc
r
r
r
r
rc
rc
rc
rc
rc
r
r
rc
r
c
c
r
r
e
e
e
e
e
e
e
ququ
qu
ququ
qu
q
q
q
q
q
q
q
q
’i
’i
’i
’i
’
i
l
l
l
l
l
l
en
en
en
n
n
n
en
en
e
n
n
e
en
a a
a
a
a
a
a
va
va
v
va
va
v
va
a
itit
it
it
t
i
t
u
u
u
u
ne
ne
ne
e
ne
e
a a
a
a
a
a
pppppp
pp
pp
pp
ro
ro
o
oo
o
o
o
o
o
o
o
r
ro
ro
o
o
ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
c
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
s
se
se
se
e
e
e
e
e
e
e
s
s
se
se
e
e
e
s
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
t
t
t
imimimim
im
im
im
im
im
m
im
im
m
m
en
e
en
en
en
en
en
en
n
e
n
n
en
en
n
n
n
n
n
ta
ta
ta
ta
ta
ta
ta
ta
ta
a
a
ta
le
lelele
le
le
le
le
le
le
l
le
le
e
e
e
l
l
.
.
.
.
.
C
C’
C’
C’
C’
C’
C
’
C
’
C
C
es
es
es
es
es
es
es
es
s
s
es
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
cecece
ce
ce
c
e
e
e
tttttt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
t
tt
tt
tt
t
tt
e e e e
e
e
e
imim
m
m
m
m
m
m
m
m
m
im
im
im
m
i
meme
me
me
me
me
me
e
e
e
e
m
ns
ns
ns
ns
ns
s
e
e
e
e
e
e
se
se
se
se
se
s
e
nsns
ns
ns
ns
ns
ibib
ib
b
ib
b
b
b
b
il
i
il
i
il
il
il
l
l
il
i
l
il
l
l
l
l
l
l
i
it
it
it
it
i
i
it
i
i
i
é
é
é
é
é
é
ve
ve
ve
ve
ve
e
ve
e
n
na
n
na
na
na
na
na
na
a
na
n
n
a
na
n
na
a
n
a
ntnt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
n
n
nt
nt
t
n
n
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
pepe
pe
pe
pe
pe
e
pe
pe
e
e
e
p
p
p
p
up
up
upup
up
up
up
up
up
up
p
p
u
u
p
p
p
lelelele
le
le
le
le
le
e
e
e
e
e
l
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
al
al
al
al
al
l
l
a
al
a
al
a
l
lala
la
la
la
la
la
la
la
la
la
a
la
a
a
a
n
n
n
nt
nt
nt
nt
n
n
nt
nt
nt
n
n
t
à
à à
à
à
à
à
à
à
à
l l l
l
l
uiuiui
ui
ui
ui
ui
ui
ui
u
u
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
u
u
ue
ue
ue
u
u
u
ue
u
u
e
n n
n
n
n
ou
ou
ou
o
u
s
s
s
s
s
vo
vo
vo
vo
vo
v
o
v
us
us
us
us
us
s
i i
i
i
n
n
n
n
n
n
nv
nv
v
v
n
n
nv
n
n
n
v
n
v
n
it
it
it
t
t
on
on
on
on
on
on
n
o
s s s
s
s
s
s
s
s
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
(r
(r(r(r
(
(r
(r
(r
(r
(r
(r
r
r
r
(
e)e)
e)
e)
)
e)
e)e)
e)
)
e
e)
e
e
e
e
c
c
co
co
co
c
c
co
c
o
nnnn
nn
nn
nn
aîaî
aî
aî
aî
î
î
trtr
tr
tr
r
tr
e
e
e
e
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e
e.
e.
e.
e
e
J.J.J.
J
J.
J.
J.
J
J
J
J.
J.
T T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
..
.
.
.
.
.

LES CAHIERS DE LA MAISON JEAN VILAR – N° 108
2
1922
(4 décembre) : naissance de Gérard Albert Philip, à
Cannes, dans la villa « Les Cynanthes », 14 rue Venizelos,
qu’habitent ses parents : Marcel Marie Honoré Philip
(né à Cannes le 27 janvier 1893), avocat, et Marie Elisa
Joséphine Jeanne Villette, surnommée «Minou» (née le
23 juin 1894 à Chartres). Ils se sont mariés à Menton
le 4 septembre 1920 et ont eu un premier enfant, en
septembre 1921 : Jean Marie Clair Honoré. Gérard est
surnommé «Gégé» par ses parents : «[…] un enfant
sage et beau […], attentif, qui observait les êtres et les
choses, [et qui] se décida relativement tard - dix-huit
mois - à parler et à marcher», dira sa mère.
1928
Gérard est, avec son frère aîné Jean, interne au
collège Stanislas de Cannes que tiennent les pères
marianistes. Sa première vocation : médecin colonial.
A la récréation de quatre heures, Madame Philip rend
visite à ses deux fi ls auxquels elle voue une profonde
affection. En 1932, les deux frères font leur communion
solennelle.
1939
La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à
l’Allemagne (3 septembre).
Gérard est reçu à la première partie du baccalauréat
en septembre, après avoir échoué à la session de juin
et passé son été à bachoter à l’Institut Montaigne, à
Vence. En octobre, il intègre l’établissement, en qualité
d’interne, en classe de philosophie.
1940
Gérard souffre d’une pleurésie. Il devient externe et
sera reçu bachelier fi n juillet. La famille Philip quitte
Cannes et s’installe à Grasse où le père de Gérard est
administrateur gérant du Parc Palace Hôtel. Lors d’une
fête de charité de la Croix-Rouge, Gérard dit Le poisson
Avec trente longs métrages, neuf courts
métrages ou documentaires, et vingt rôles
au théâtre – 605 représentations, dont
199 du Cid et 120 du Prince de Hombourg
– Gérard Philipe incarne la génération
d’après-guerre, assoiffée de lumière et de
liberté.
Cette carrière fulgurante de 17 ans ne l’a
pas empêché d’être un citoyen engagé au
service des causes de la paix et de la justice
sociale.
Il était encore un fi ls, un mari et un père
étroitement attaché à sa famille.
Trop courte mais si belle vie…
Gérard Philipe : récit d'une vie
par Rodolphe Fouano
Photo Jean Rouvet. Collection Association Jean Vilar
V

3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
1
/
84
100%