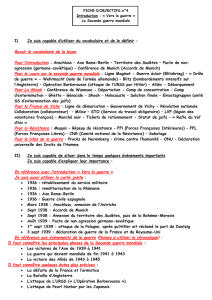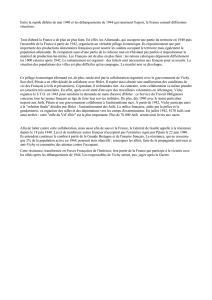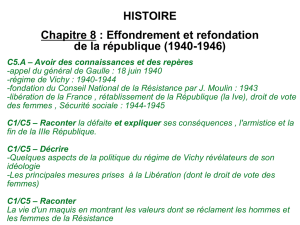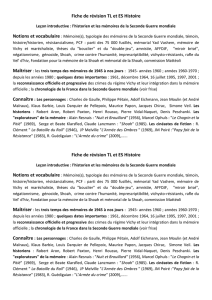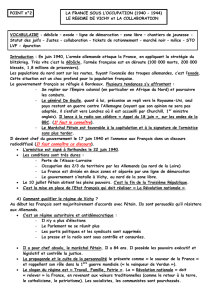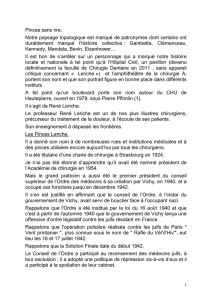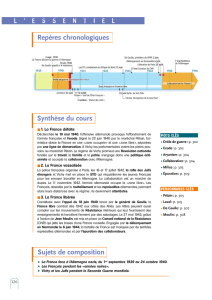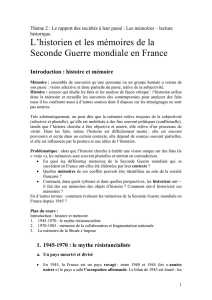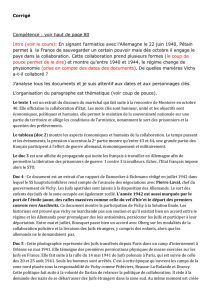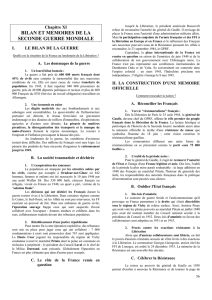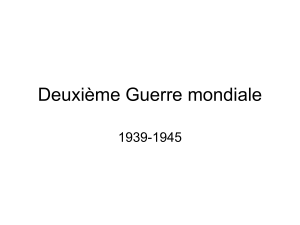Le génocide des Juifs et le

COMPTE‐RENDUDELACONFERENCE
«LEGENOCIDEDESJUIFSENFRANCEETENEUROPE:
ENTREHISTOIREETMEMOIRE»
Compte‐renduréalisépar:M.Haddak,CollègeVoltaireSarcelles95200
L’InspectionpédagogiquerégionaleetleGrouped'ExpérimentationPédagogique(GEP)
d'histoire‐géographieontorganisélemercredi21octobre2009,aulycéeLaBruyèreà
Versaillesuneconférencesur«legénocidedesJuifsenFranceetenEurope:entrehistoire
etmémoire».
Laconférenceavaitpourobjectifd’approfondirlesconnaissanceshistoriographiqueset
épistémologiquesd’unsujetenseignéauxélèvesdusecondaireetquifaitencorel’objetde
nombreusescontroversesd’oùl’intérêtdefairerencontrerenseignantsetchercheurspour
endébattre.
Leprogrammedelademi‐journéeétaitlesuivant:
14h00–14h20:Présentationdesproblématiquesetdesinterventions,parLaurentLE
MERCIER,IA‐IPRd'histoire‐géographie.
14h20–15h35:UnehistoiredugénocidedesJuifs;Desétapesdela«Solutionfinale»aux
enjeuxdemémoire,parGeorgesBENSOUSSAN,historien,rédacteurenchefdelaRevue
d’histoiredelaShoah.
15h35–16h50:LerégimedeVichy,parHenryROUSSO,historienàl’IHTP,directeurde
rechercheauCNRS.
16h50‐17h00:Conclusion:enjeuxetperspectivespourlaclasse.LesmembresduGEP.

INTRODUCTION
14h00–14h20:Présentationdesproblématiquesetdesinterventions,parLaurentLE
MERCIER,IA‐IPRd'histoire‐géographie.
EnseignerlaShoah,c’estfairecomprendreauxélèvesquelabarbarienazies’estdéveloppée
suruncontinent,l’Europe,assimilédanslesreprésentationsàunmodèledecivilisation;
c’estégalementrechercherlacomplicitédel’Etatetdel’administrationdelaFranceavec
l’Occupantetrestituerlescausalitésenchevêtrées(crises,nationalisme…);c’estenfin
replacerlapolitiquenaziedansleprocessusglobaldutemps,desdécisionsetdes
techniques.
Lesujetinviteàréfléchiràl’oppositionde«l’histoire»etdela«mémoire»(deux
constructionsdupassé,lapremières’appuyantsurlaraison,lasecondesurl’émotion)età
débattredesimplicationsetdeslimitesdu«devoird’histoire»et«devoirdemémoire».
Dansledialoguecontemporaindesmémoires,l’histoiretientuneplaceprivilégiéeparson
soucidu«devoirdevérité».
LesujetdugénocidedesjuifsenFranceetenEuropes’inscritdansunehistoiredutemps
présent.L’utilisationdestémoignagesdoitêtreaccompagnéeparuntravailrigoureuxsurles
sourcesetnécessiteune«miseenperspectivehistorique»carlesentretiensreconstruisent
unpassédansuncontexteparticulier.
Leprofesseurd’histoireoccupeenconséquenceunepositionsingulière.Sonmétiermeten
rapportl’historienetl’enseignant‐fonctionnaire.Ilestprisenétauentrelesambitions
critiquesd’unedisciplineetlesexigencesdel’administrationelle‐mêmesollicitéepar
l’opinionsurle«devoirdemémoire».

14h20–15h35:UnehistoiredugénocidedesJuifs;Desétapesdela«Solutionfinale»aux
enjeuxdemémoire,parGeorgesBENSOUSSAN,historien,rédacteurenchefdelaRevue
d’histoiredelaShoah.
Introduction:
Lemot«Shoah»(enhébreu,«catastrophe»)s’estimposédepuisvingtansenFrance
(populariséen1985parledocumentairedeClaudeLanzmann).Ilétaitprécédépar
«holocauste»plusconnotéreligieusement(sacrificerituel).LetermedeShoahestofficiel
enIsraël.Onutiliseparfoislanotionde«judéocide».
PourGeorgesBensoussan,laShoahquiestun«génocide»(dujuristeRaphaëlLemkinen
1944)doitêtrehistoriciséepouréviterdelabanaliser.Qu’est‐cequifaitl’unicitédu
génocidejuif?
L’exterminationdemassedesJuifsd’Europeestundesthèmeslesplusétudiésenhistoireet
lespluspubliésenFrance.Ilestmarquéparune«centralité»d’unphénomènequi
interrogetouslesdomaines(politique,mémoire,sciences…)etquin’estpasexempt
d’instrumentalisations.
LaShoahnes’expliquepasqueparl’antisémitisme.Ilestnécessaireparexemplederecourir
aumouvementdesanti‐LumièresouauxconséquencesdelaGrandeGuerre.
L’historienénumèreplusieurspointsquidoiventameneràapprofondirlaconnaissancede
l’histoiredugénocidejuif.
1°LemythedelapassivitédesJuifs
Dansl’opinion,l’idéed’une«passivité»desJuifsestbienancrée.Cetteinterrogationest
parfoissoulevéeparlesélèvesenclassesurprisparl’ampleurdela«Solutionfinale».Ilfaut
répondrequ’ilyaeuunerésistance«juive»enFranceouenEuropedel’Est.Ilfaudrait
parlerde«faiblesse»consécutiveàlamiseenœuvretrèsrapidedelaShoah,entreledébut
del’année1942etl’été1943.DansleGhettodeVarsovie,lesfatiguespsychologiqueet
physiologiqueexpliquent,malgrélessoulèvements,l’anéantissementdelamajoritédeses

habitants.Pourfinir,refusantsouventd’afficherleurscroyances,lesisraélitessont
surreprésentésdanslesmouvementsderésistanceeuropéens.
2°Lefascisme,une«modernitéréactionnaire»
Onaparléd’unSonderwegallemand,d’unehistoireparticulièredel’Allemagne.
En1914,lapatriedeGuillaumeIIétaitlapremièrepuissanceindustriellematérialiséeparla
multiplicationdesprixNobeldepuislesannées1910.MaispourGeorgesBensoussan,cette
avancetechniqueetscientifiques’appuyaitsurunearriérationdesstructuresintellectuelles,
éducativesetdémocratiquesassezsuperficielles.
Lefascismen’estpasqueréactionnaire.C’estaussiun«mouvementrévolutionnaireet
jeune».Lefascismecroitauprogrès:c’estunemodernitéréactionnaire.C’estle
«modernismesanslarévolutiondusujetissuduXVIIesiècle».Ilyaeuunrejetdes
Lumièresdepuislesguerresnapoléoniennes.Ainsi,en1918,onpeutdirequeWeimarest
«unerépubliquesansrépublicains».
Laculturen’estpasunantidotecontrelabarbarie.Desintellectuelsontparticipéà
l’exterminationdesJuifsetTziganes.Ainsi,surlesquinzeparticipantsdelaConférencede
Wannsee,àBerlin,le20janvier1942,quiorganisel’appareild’Etatallemandpour
l’exterminationrapidedesJuifsdel’Europeoccupée,neufsontdesdocteursd’université.
3°LaGrandeGuerre,matricedesviolencesgénocidaires
LedéveloppementdelaGuerretotaleentre1914et1918,déjàinitiélorsdesGuerres
balkaniques(solutiondesproblèmesethniquesparlesdéplacementsforcésetlesmassacres
decivils,premièresexterminationsdemasse),permetaussidemieuxrendrecomptedes
processusquiontaboutiàlabarbarienazie.Lesespritsontétéhabituésàundegréde
violenceextrême.Uncorpssurdeuxn’apasétéretrouvédanslestranchées,ceque
symboliselatombedusoldatinconnu.
L’héritagedespèrescombattantsdelaGrandeguerreestdéterminantdanslaréactivation
demythessurlesresponsabilitésdesjuifsetdelajeuneRépubliquedeWeimar:c’estle
thèmedu«coupdupoignarddansledos».Le9novembre1918(jourdel’abdicationde
GuillaumeIIetdeladéfaiteannoncéeofficiellement,deuxjoursplustard,parl’armistice)
entraîneuneobsessionallemandeautourdecettedatequin’adecessedepuislorsdese
répéter:9novembre1923,échecduputschdupartinaziàMunich;le9novembre1938,la

«NuitdeCristal»etsesviolencesantisémites;9novembre1941,dateprobabledela
décisiondela«Solutionfinale»...
4°Lesviolencescolonialesont‐ellespréparélesviolencesdelaGuerretotale?
Entre1914et1918,leregardallemandsurl’Estrappellelesystèmecolonialmisenplacepar
lesautresgrandespuissanceseuropéennes,notammentenAfrique.
SicommeOlivierleCourGrandmaison(Coloniser,exterminer.Surlaguerreetl’Étatcolonial,
Paris,Fayard,2005),GeorgesBensoussanacceptelapropositionquelesviolencesdela
SecondeGuerremondialesontàaussirechercherdanscellesdel’histoirecoloniale,ilrefuse
cependantleuréquivalence.L’antisémitisme,c’estd’aborduneaffaireeuropéenne.Deplus,
lescrimesdelacolonisationnesontpasprogrammés(àl’exceptiondesHererosen1904,
dansl’actuelleNamibie).
5°Lesracinesdel’antisémitismeetlerecoursautempslongdel’Europe
Sanstomberdansundéterminisme,l’antijudaïsmeeuropéenremonteauMoyenÂge,
périoded’élaborationd’uncodeculturelfaisantduJuiflafigureterrestredudiable.Dans
l’espritdesantisémites,leJuif,c’estl’enversdelasociété,l’impurquicontamineet
dégénèrecequ’iltouche.
Avant1945,lessociétéseuropéennessontglobalementantisémitesselonGeorges
Bensoussan.Ellesvéhiculentdescroyancesquiculpabilisentetsolutionnentlesproblèmesà
traversl’évocationparanoïaqueduJuif.L’historienparled’«antisémitismeexistentiel»qui
définiraitunefrontièreidentitaireentrelemensongeetl’honnêteté,lalâchetéetle
courage,lenomadeetlesédentaire,legoûtdel’oretl’attachementauxvaleursincarnés
respectivementparleJuifetlenon‐Juif.
ParcequelaShoahestun«événementsansprécédent»,ilfautrefuserpourGeorges
Bensoussanunecompétitiondesmémoiresetdesvictimesdesconflitsquirisqueraitde
banaliserl’exterminationdesJuifs.Sidansl’histoirelesévénementsnesontpasuniques,ils
sontenrevanchesinguliers.
LaShoahn’aétépossiblequeparlaconjonctionentrel’obsessionantisémited’AdolphHitler
etl’antisémitismedel’Europeancrédansun«millénarismepurificateur».LaShoahpossède
desspécificitésqu’onpeutetdoitcomparerpournepasbanalisercetévénement.
L’exterminationd’Auschwitz,c’estunefinensoi,un«crimecontrel’humanité»alors
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%