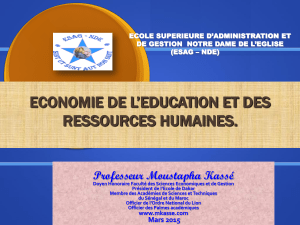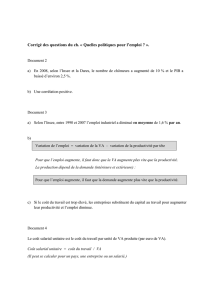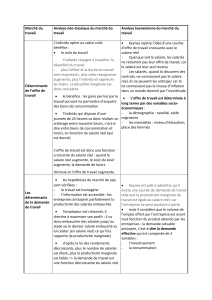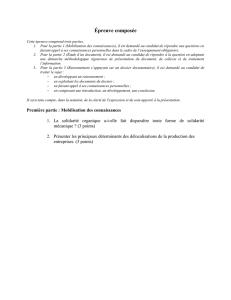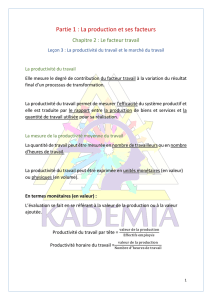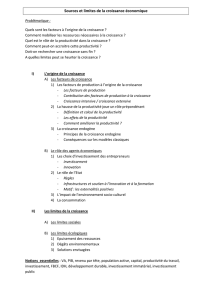economie de l`education et des ressources humaines

INTRODUCTION
1. L’analyse économique confère, aujourd’hui, une importance très grande aux
ressources humaines, dans ce sens deux phénomènes peuvent être observés d’abord
la théorie du capital humain, ensuite l’apport de l’éducation au développement tels
que révélés dans deux rapports l’un de l’OCDE et l’autre de la Banque mondiale.
2. Ces travaux s’appuient sur ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui l’économie de
l’éducation qui est un champ d’études que les économistes ont commencé à aborder
avec rigueur dans les années 60, à l’université des Chicago, lorsqu’un petit groupe de
chercheurs, notamment Schultz et Becker, posèrent les bases théoriques de cette
discipline. Tous deux deviendront des prix Nobel d’économie sur la base de leurs
travaux sur ce qu’il convient d’appeler le capital humain. D’autres auteurs
continueront ces recherches qui forment le corpus de l’Economie de l’Education.
3. Les travaux réalisés ont conduit à la formulation de la théorie du «capital humain», le
mot capital étant retenu par analogie au capital physique qui est le premier facteur de
production. De même qu’un investissement en capital physique permet de produire
des flux de biens ou de services pendant des périodes successives, et donc de créer
partant des revenus qui dépasseront le coût initial d’investissement, il peut en être de
même pour les êtres humains peuvent investir dans ce que les économistes classiques
appelés déjà le «learning by doing» afin de devenir plus productifs de façon
permanente au cours de leur vie active.
2

4.Cette théorie du capital humain a donné lieu à de nombreux
travaux empiriques visant à mesurer de façon plus précise le
niveau de la rentabilité de l’investissement : selon le type
d’études, selon la durée des études, selon le pays, selon
l’époque, selon l’origine sociale ou ethnique, selon les
conditions du marché, etc.
5.Pour conduire ces études, il faut d’une part connaître ce que
coûte chaque type d’éducation, et d’autre part quels sont les
revenus du travail aux différents âges de la vie active pour
chaque catégorie de cursus scolaire que l’on souhaite
étudier.
6. Ces divers travaux ont fini par établir les mécanismes par
lesquels l’éducation, au sens le plus large, influe sur la
croissance économique: ceux-ci sont multiples et assez bien
identifiés.
3

7. Le lien entre Education et croissance passe par la technologie, contrairement à ce que
suggèrait le modèle néo-classique (Solow et Mankiv); les travaux récents (Benhabib et
Spiegel) montrent un effet positif et significatif du niveau de capital humain (et non pas
du taux de croissance de ce niveau), mesuré par le nombre d’années d’études moyen
parmi la population active au début de la période considérée, sur le taux de croissance
moyen du PIB par tête.
8. Enfin des recherches plus récentes à partir d’importantes innovations méthodologiques
notamment les méthodes microéconométriques, ce qui a été souligné en 2000 par la
remise du Prix Nobel d’économique à James Heckman, ont entre autres mis en lumière
l’importance de tenir compte de l’hétérogénéité des individus et du caractère
dynamique des décisions dans l’analyse des choix d’investissement en capital humain.
9. Ces deux considérations entraîne l’économie de l’éducation a cherché à étudier deux
grands ensembles de phénomènes
–au niveau microéconomique, les économistes cherchent à comprendre le processus
décisionnel des individus en matière d’investissement en capital humain, de même
que les nombreux facteurs qui peuvent influer sur ce processus.
–au niveau macroéconomique, les économistes de l’éducation sont préoccupés par
les impacts de ces choix individuels sur les tendances du marché du travail et la
croissance économique, ce qui la rend particulièrement pertinente du point de vue
de la politique économique.
4

Si l’Éducation devient un facteur aussi productif, il faut alors répondre à trois
interrogations:
–comment les États le pensent-ils?
–Comment l’organisent-ils?
–Et comment le financent-ils l’offre éducative et pour quels résultats ?
10.Dès lors, deux analyses de l’économie de l’éducation seront faites dans ce
cours : la première concernera les caractéristiques intrinsèques de
l’investissement en capital humain pour un individu et la seconde la
corrélation éducation et croissance. Elles seront complétées par deux
développements complémentaires sur le marché du travail et sur les
politiques éducatives en Afrique.
Cela indique la structure du Plan de travail que nous allons adopter:
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%