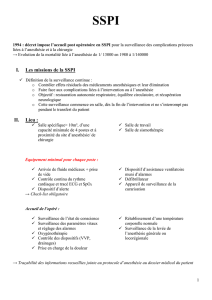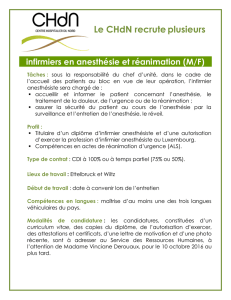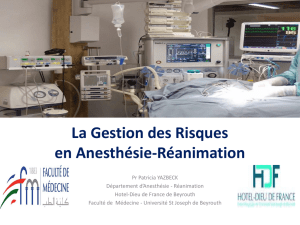rapport sur la sécurité anesthésique

Haut Comité de la Santé Publique
RAPPORT SUR
LA SÉCURITÉ ANESTHÉSIQUE
Novembre 1993
1994
ÉDITIONS ÉCOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

© 1994, Haut Comité de la Santé Publique

SOMMAIRE
Saisine du Haut Comité de la Santé Publique .................................. 9
1. Introduction ..................................................................................... 17
1.1. L’activité anesthésique en France .......................................... 23
1.2. La fréquence des accidents liés à l’anesthésie....................... 27
1.3. Retentissements socio-économiques des accidents
liés à l’anesthésie................................................................... 9
1.4. Les bases de réflexion. Démographie de la discipline ;
standards d’anesthésie ........................................................... 10
1.5. En résumé .............................................................................. 12
2. Importance de la consultation pré-anesthésique ......................... 41
2.1. La situation de la consultation pré-anesthésique .................. 41
2.2. Les freins au développement .............................................................. 48
2.3. Les actions........................................................................... 52
3. Les facteurs humains ....................................................................... 59
3.1. Importance des facteurs humains dans les accidents
d’anesthésie............................................................................ 52
3.2. Analogie avec d’autre types d’accidents................................ 52
3.3. Cas particuliers ...................................................................... 52
3.4. Propositions d’amélioration................................................... 52
3.5. Les freins................................................................................ 52
3.6. En résumé .............................................................................. 52
4. Rôle du matériel au bloc opératoire ............................................. 65
4.1. Importance du problème........................................................ 52
4.2. L’équipement anesthésique nécessaire .................................. 52

4.3. Mesures proposées................................................................. 52
4.4. Les freins................................................................................ 52
5. Rôle de la salle de réveil ................................................................. 65
5.1. Nature et gravité des accidents de réveil................................ 65
5.2. Réglementation actuelle sur les Salles de Réveil................... 65
5.3. Les salles de réveil en France ................................................ 65
5.4. Analyse de la situation actuelle ............................................. 65
5.5. Objectifs et difficultés............................................................ 65
5.6. En résumé .............................................................................. 65
6. Rôle des IADE.................................................................................... 65
6.1. Données démographiques...................................................... 65
6.2. Place des IADE...................................................................... 65
6.3. Les salles de réveil................................................................. 65
6.4. Démographie, formation........................................................ 65
7. L'anesthésie du patient ambulatoire.............................................. 65
7.1. Définition............................................................................... 65
7.2. Les actes réalisables............................................................... 65
7.3. Les patients............................................................................ 65
7.4. L’anesthésie............................................................................ 65
7.5. La sortie ................................................................................. 65
7.6. Structures, organisation et fonctionnement............................ 65
8. Les structures. Environnement et sécurité en anesthésie............ 65
8.1. Les sites d’anesthésie............................................................. 65
8.2. Relation avec la sécurité ........................................................ 65
8.3. Conséquences......................................................................... 65
8.4. Les consultations.................................................................... 65
9. Propositions....................................................................................... 65
RÉFÉRENCES........................................................................................ 65
ANNEXES.............................................................................................. 65
8

OBJET : Saisine du Haut Comité de la Santé Publique.
Entre 1980 et 1983, l'INSERM a procédé à une importante enquête sur
les conditions de sécurité, notamment anesthésiques, dans lesquelles se
déroulaient les interventions chirurgicales en France. Les résultats de cette
enquête avaient conduit à la mise au point de plusieurs mesures normatives
portant sur les équipements de salles d'opération et de réveil, qui ont contri-
bué de manière sensible à l'accroissement de la sécurité chirurgicale dans
notre pays.
Depuis 1980, des nombreux changements techniques et organisationnels
se sont produits en matière de conditions d'anesthésie, de réanimation et
d'environnement chirurgical, de sorte que les exigences en matière de sécu-
rité se sont légitimement accrues. De nouvelles modalités d'intervention per-
mettent de réduire considérablement le séjour en milieu hospitalier, jusqu'à
une seule journée dans certaines conditions.
Je souhaiterai que ces dernières conditions fassent l'objet d'une étude sys-
tématisée, afin de s'assurer que la sécurité des interventions chirurgicales en
France soit au niveau le plus élevé possible, en tenant compte de tous les
aspects de la question (formation des différents intervenants, effectifs, équi-
pements, administration, contrôle…)
J'attacherai du prix à ce qu'un groupe d'étude soit constitué au sein du
Haut Comité de la Santé Publique sur ce sujet, et que des propositions
concrètes soient formulées dans les plus courts délais.
Bernard KOUCHNER
9
Le Ministre Paris, le 14 avril 1992
– NOTE –
pour Monsieur le Professeur Guy NICOLAS
Vice-Président du Haut Comité de la Santé Publique
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION HUMANITAIRE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%