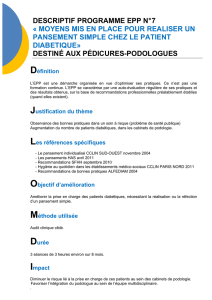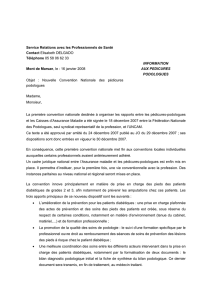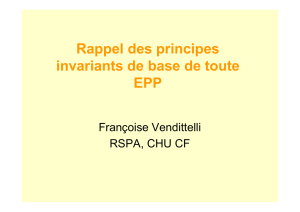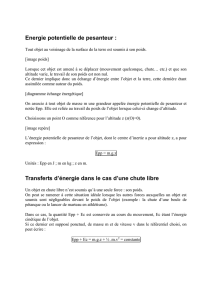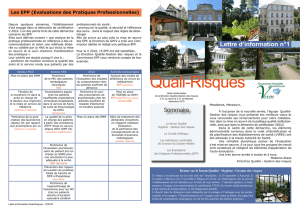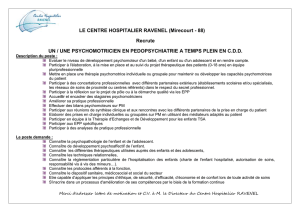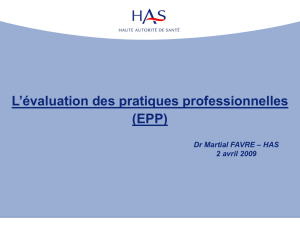Télécharger le numéro au format PDF

Reperes No04
AVRIL 2008
<
<
LE BULLETIN DE L’ORDRE DES PÉDICURES-PODOLOGUES
dossier
© Beside
<<<
Entre passé et présent :
petit rappel historique
En France, la profession de pédicure-
podologue est ancienne. D’abord exercée
par des barbiers, puis par la suite par des
barbiers-chirurgiens, ceux-ci étaient 200 à Paris
en 1292 et n’avaient pas
de formation spéciale, pratiquant le plus
souvent de père en fils. Les premiers traités
connus apparaissent au 18ème siècle, ainsi que
le premier enseignement, dispensé à l’Hôtel
des Invalides et créé par Laforest qui est alors
«Chirurgien Pédicure du Roi et de la famille
royale». La première école formant des
professionnels de la pédicurie et de la
podologie est créée en 1872 à Paris,
près de la place Vendôme.
Les évolutions s’accélèrent au 20ème siècle et
c’est au cours de la seconde guerre mondiale
que la profession, sa réglementation et son
enseignement, prennent progressivement
forme. En 1940, le Dr Huet et le Pr Leriche
créent le premier cycle d’enseignement de la
pédicurie, à l’Hôpital Léopold Bellan. En 1944,
les deux premières consultations de podologie
avec soins s’ouvrent à l’Hôpital du Val de Grâce
et à l’Hôpital Cochin. Les premiers diplômes
officiels datent également de 1944, sous la
forme d’un certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) de prothèse en podologie (arrêté du 16
mars 1944) et d’un CAP de pédicure (loi du 20
mars 1944), qui seront abrogés à la libération.
C’est donc la loi du 30 avril 1946 qui est
véritablement fondatrice puisque,
tout à la fois, SUITE P.5
DE LA FORMATION À L’EPP
DES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE
Formation initiale, formation continue et, bientôt, évaluation
des pratiques professionnelles : c’est toute notre formation
professionnelle qui va être rénovée, ce qui est non seulement
souhaitable mais nécessaire face aux évolutions tant de la
profession que de la société au sein de laquelle nous exerçons
et où le patient est devenu un usager des soins. L’Ordre national
des pédicures-podologues (ONPP) est impliqué sur ces trois gros
chantiers essentiels pour l’avenir de notre profession, en France
comme en Europe.
<
<
P.11
juridique
LA CESSION
DE CLIENTÈLE
Définition et modalités
<
P.2
informations
ordinales
ÉLECTIONS 2008
Rappel à candidatures
P.4
déCodage
CODE DE
DÉONTOLOGIE
Qui décide de quoi ?
P.3
missions
UNE CARTE DE
PROFESSIONNEL
DE SANTÉ
pour les pédicures-
podologues
<

actualités<
>La Direction de
l'hospitalisation
et de l'organisa-
tion des soins
sollicite l'avis
de l'Ordre sur
la transposition
en droit français
de la directive
européenne de
reconnaissance
des qualifications
professionnelles
(2005-36 du 7
septembre 2005).
La reconnaissance des
diplômes pour les pro-
fessions réglementées,
dont les professions
paramédicales, permet-
tant de garantir la libre
circulation des profes-
sionnels, est prévue
par les directives
du 27 juin 1977, du
21 décembre 1988
et du 18 juin 1992.
La directive 2005-36
du 7 septembre 2005
consolide ces trois
directives.
Elle complète et modi-
fie les dispositions sur
la liberté d’établisse-
ment et introduit des
dispositions sur la libre
prestation de service
pour les professions
paramédicales. Dans
ses observations,
l'Ordre a mis l'accent
sur la nécessaire équité
entre les ressortissants
étrangers et les profes-
sionnels nationaux, afin
qu'ils soient tous soumis
aux mêmes obligations.
Celles-ci concernent
notamment leur
inscription au Tableau
de l'Ordre, le niveau
et la qualité des forma-
tions qui se pratiquent
au sein des États
membres, la qualité
et la sécurité des soins
prodigués aux patients
et la limitation de
l'exercice temporaire
et occasionnel sur
le territoire français...
>Les professions
de rééducation
sont invitées par
la Direction de
l'hospitalisation
et de
l'organisation
des soins à
travailler sur
la réforme
des études dans le
cadre d'une démarche
concertée. Réunissant
les représentants des
organisations syndicales,
des associations
professionnelles,
des employeurs, des
instituts de formation,
du corps médical,
et des personnalités
qualifiées, les réunions
s'étaleront sur un
planning de janvier
à septembre 2008. Les
pédicures-podologues
se réunissent depuis
mars avec les
ergothérapeutes.
Les premiers travaux
portent sur l’élabo-
ration du référentiel
d’activités du métier
associé au diplôme:
thème sur lequel
travaille depuis
plusieurs mois la
Commission formation,
compétences et
évaluation des pratiques
professionnelles
au sein du Conseil
national de l'Ordre des
pédicures-podologues.
>HAS :
Coopération entre
professionnels
de santé -
Consultation
publique
La HAS (Haute Autorité
de santé) a organisé
une consultation
publique jusqu’au 31
janvier 2008 sur «les
Coopérations entre pro-
fessionnels de santé»
(également appelées
«transferts de compé-
tence»). Le ministère
de la Santé a demandé
à la HAS d’élaborer une
recommandation visant
à clarifier les conditions
de la coopération dans
le domaine de la santé
et d’identifier les
évolutions qui pourraient
la faciliter, afin de
préserver, voire
d’améliorer, la qualité
des soins pour les
patients.
Tous les acteurs de
santé impliqués ont pu
apporter leur contribu-
tion sur ce sujet.
>RAPPEL
L'Ordre national
des pédicures-
podologues
vous rappelle
que les élections
des conseillers
régionaux et
nationaux auront
lieu respective-
ment les 16 mai
et 20 juin
prochains.
Les candidats doivent
se déclarer (recom-
mandé avec accusé
de réception)
respectivement auprès
du Conseil régional
concerné pour les
premières et de
l’Ordre national pour
les secondes, 30 jours
au moins avant les
élections; soit le
16 avril 2008 pour les
régionales et le 20 mai
2008 pour les nationales.
La candidature peut
être accompagnée
d’une profession de
foi à l’attention des
électeurs, rédigée en
français sur une page
recto simple de
21x29,7 cm, noir et
blanc, avec éventuelle-
ment une photo.
Renseignements et
procédures sont
disponibles auprès de
vos Conseils régionaux
et du Conseil national.
missions<
2Repères AVRIL 2008
édito<
Dès la création de
notre Ordre et la mise
en place de ses
instances, nous avons
voulu collégialement
fixer les grands axes
de notre stratégie
d’actions. Parmi nos
priorités: la parution
du Code de
déontologie - c’est chose faite -
l’élaboration du référentiel métier
de notre profession, étape préalable
à l’évolution de la formation initiale,
l'intégration au système LMD (Licence-
Master-Doctorat), l'ouverture à la
recherche, le développement de la
formation continue et enfin l'évaluation.
La Commission formation, compétences
et évaluation des pratiques
professionnelles présentera au prochain
Conseil national le référentiel métier,
résultat d’une année de travail et de
consultations professionnelles. Dans
le même temps, nous signons avec la
Haute Autorité de santé une convention
pour la mise en œuvre d’une nouvelle
démarche pour la profession :
l’évaluation de sa pratique. Il relève
des missions syndicales de relancer
le processus de parution des décrets
d'application concernant la formation
continue.
L'une des missions fondamentales de
l’Ordre des pédicures-podologues n'est-
elle pas de veiller à la compétence des
professionnels? L’État a délégué à notre
Ordre un rôle central dans les dispositifs
de formation continue et d’évaluation
des pratiques professionnelles, deux
démarches convergentes. Ce devoir
d'entretien et de perfectionnement des
connaissances, la Commission éthique et
déontologie l’a inscrit dans l’article 38 du
Code de déontologie. Tant la formation
continue que l’évaluation des pratiques
professionnelles visent à améliorer les
pratiques, la qualité et la sécurité des
soins. À nous, pédicures-podologues,
de nous lancer dans des démarches
innovantes et valorisantes
pour la profession.
Cette évolution, nous la souhaitons et
nous la porterons, c'est aussi pourquoi
je vous invite à participer nombreux aux
prochaines élections de ce printemps !
Bernard BARBOTTIN
© S. Guarrigues / Beside
La plupart des professionnels
de santé encadrés par un Ordre
disposent aujourd’hui de deux
cartes professionnelles; une carte
ordinale, délivrée par leur Ordre, et une
carte de professionnel de santé (CPS)
délivrée par le GIP-CPS, après information
par les services de l’État (DDASS) et de
l’Assurance maladie. La CPS renferme
actuellement des données d’identification
du professionnel de santé ainsi qu’un
numéro d’inscription au fichier Adeli
et un numéro de Domaine d'Assurance
Maladie. À terme, l’objectif est de faire
converger ces deux cartes en une carte
unique, ordinale et professionnelle,
renfermant l’ensemble des informations
utiles et disposant d’un numéro unique
et pérenne, évitant les doublons dus à
des inscriptions auprès de différentes
caisses d’Assurance maladie (exercice
dans plusieurs départements) ou
de différentes DDASS ainsi qu'à
des radiations non effectuées.
Le Répertoire partagé des
professionnels de santé (RPPS)
Pour ce faire, un fichier unique et partagé
est en cours de mise en place au sein du
GIP-CPS: le RPPS. Ce fichier renfermera,
pour chaque professionnel de santé
répertorié, un ensemble d’informations
concernant sa formation et sa
qualification, ses titres et diplômes,
les restrictions éventuelles de son
exercice… Une fois ces informations
enregistrées directement par l’Ordre qui
représente le professionnel, un numéro
d’identification unique est généré par
le RPPS. L’avantage est que ce RPPS
constitue une base de données
centralisée et actualisable en
permanence, à laquelle les autres
organismes accèdent également
(DDASS, CPAM…). Il rend donc obsolète
la tenue de tout autre fichier.
Certifier la confidentialité
des échanges
Plus largement, le système CPS apporte des
garanties de sécurité concernant l’échange
et le partage d’informations entre profes -
sionnels (réseaux de soins…), procédures
qui se développeront considérablement
dans le futur, avec notamment l’arrivée
du Dossier médical partagé.
Où en est-on pour
les pédicures-podologues?
Le GIP-CPS travaille depuis plus de 4 ans
avec les Ordres des professions de santé
qui préexistaient: pharmaciens,médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes,
les professions «non-à-ordre» devant être
à l’étude dans un second temps.
L’Ordre national des pédicures-podologues
(ONPP), créé entre temps, s’est
rapproché du GIP-CPS et devrait l’intégrer
prochainement, afin de bénéficier des
mêmes dispositions que les autres ordres
«historiques». L’objectif est notamment
d’accéder, dès la première version de
la Carte de professionnel de santé,
au RPPS. L’ONPP a pour cela pris les
précautions techniques nécessaires afin
d’assurer la concordance entre le fichier
de gestion du Tableau et les contraintes
du RPPS. La Carte de professionnel
de santé unique pour les pédicures-
podologues devrait ainsi être mise
en place début 2009.
Article réalisé avec la participation de Patrick FORTUIT,
membre du bureau du Conseil national de l’Ordre
National des Pharmaciens, Vice-président du GIP-CPS,
Président du Comité de Pilotage du RPPS.
UNE CARTE DE PROFESSIONNEL
DE SANTÉ POUR LES
PÉDICURES-PODOLOGUES
Déjà très utilisée par certaines professions, la Carte de professionnel de santé,
régie par le Groupement d’intérêt public GIP-CPS, est en pleine mutation.
L’objectif est d’en faire la «carte d’identité professionnelle » unique, afin de
simplifier au maximum les démarches administratives des professionnels.
Une simplification qui fait une large place aux Ordres qui constitueront
les guichets uniques pour les professionnels et assureront l’interface
avec les services de l’État et les organismes sociaux.
D.R
Actuellement, environ 1800 pédicures-podologues disposent d’une carte de
professionnel de santé destinée essentiellement à l’échange d’information avec
l’Assurance maladie, notamment pour la prise en charge des orthèses plantaires.
le point sur…
AVRIL 2008 Repères 3
<
Site internet du GIP-CP: www.gip-cps.fr
Site internet de l'Ordre: www.onpp.fr
pour en savoir plus
© GIP-CPS
PAS D’EUROPE POUR
LES PÉDICURES-PODOLOGUES
La future CPS prévoit d’intégrer une “face européenne” permettant
d’accéder aux informations concernant le professionnel de santé
depuis l’ensemble des pays de l’Union européenne. Avantage: le contrôle
par l’autorité locale (diplôme, absence d’interdiction d’exercer…) est
grandement facilité et le professionnel n’a plus à effectuer de démarches
administratives fastidieuses pour exercer à l’étranger. Cette possibilité
n’est cependant offerte qu’aux professions bénéficiant de la
reconnaissance des diplômes délimitée par la Directive 2005/36/CE
qui ne concerne actuellement pas les pédicures-podologues.
<

<<<
4Repères AVRIL 2008
déCodage<dossier<
AVRIL 2008 Repères 5
*Direction régionale de l’action sanitaire et sociale
elle institue le diplôme d’État
(DE) de pédicure, réglemente la profession,
protège le titre ainsi créé et l’activité qui
en découle. Elle est suivie de la création d’un
nouveau CAP de prothèse en podologie et
orthopédie et d’un brevet professionnel (BP)
de prothèse en podologie et orthopédie (arrêté
du 14 février 1951), puis d’un brevet de
technicien pédicure orthopédiste et prothésiste
en podologie (arrêté du 15 juin 1959),
nécessitant un an d’étude après le DE.
En 1974, la formation à l’examen clinique
(étude de la statique et de la dynamique)
et aux orthèses plantaires est intégrée au
programme du DE, tandis que les autres CAP
et brevets sont supprimés : cette évolution
de l’enseignement précède ainsi la loi du
25 mai 1984 officialisant la transformation
du titre de pédicure en pédicure-podologue.
Ce processus est parachevé avec le décret
du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels
accomplis directement par les pédicures-
podologues, définissant ainsi leur champ de
compétences, puis par le décret du 2 octobre
1991 fixant à 3 ans les études préparatoires
aux épreuves du DE.
La formation initiale au présent
Actuellement, ces études sont dispensées
dans 10 instituts de formation spécialisés,
agréés par les préfets de région et répartis
sur l’ensemble du territoire: 8 d’entre eux sont
privés (dont 4 à Paris, un à Lille, Marseille,
Nantes, et Rennes) et 2 publics (à Toulouse et
Bordeaux). Ils sont accessibles, après réussite
aux épreuves d’admission, aux étudiants âgés
de 17 ans au moins et titulaires du baccalauréat
français, d’un titre équivalent reconnu par
la DRASS*, ou d’un diplôme d’accès à
l’université; les candidats non titulaires de ce
niveau d’études préalables doivent être inscrits
en classe de terminale (l'admission définitive
étant alors subordonnée à l'obtention du
baccalauréat), ou bien justifier d’une expérience
professionnelle ayant donné lieu à cinq années
de cotisations à la sécurité sociale.
Sur le plan administratif, les instituts de
formation dépendent des régions. Chacun est
autonome pour l'organisation de ses épreuves
d’admission (de fin mars à début mai) et le
choix des sujets (épreuve écrite de biologie
portant sur le programme de première et
terminale scientifiques).
Le recrutement de ces instituts de formation
étant de plus en plus sélectif, la plupart des
étudiants suivent une année préparatoire à
l’examen d’entrée. De plus, dans chaque région,
ce sont les DRASS qui organisent le DE.
L’ONPP ET LES CAPACITÉS D’ACCUEIL
DANS LES INSTITUTS DE FORMATION
Le nombre d'étudiants agréés en première année
pour 2006-2007 était de :
École d'Assas Massothérapie et Pédicurie Paris 60 Privé
EFOM Boris Dolto Paris 80 Privé
École Danhier Paris 60 Privé
Institut National de Podologie - INP Paris 80 Privé
Institut de formation en pédicurie-podologie Lille 60 Privé
Institut de formation en pédicurie-podologie Rennes 30 Privé
Institut de formation en pédicurie-podologie Nantes 40 Privé
Institut de formation en pédicurie-podologie Bordeaux 30 Public
Institut de formation en pédicurie-podologie Toulouse 25 Public
Institut de formation en pédicurie-podologie Marseille 30 Privé
495
Rappelons que l'Ordre a pris une position très nette concernant les projets d'ouverture
de nouveaux instituts de formation en pédicurie-podologie. Dans le cadre des agréments
techniques, l'Ordre national des pédicures-podologues s'est opposé à toute décision
allant dans le sens d'une augmentation globale, à l’échelon national, de la capacité
d’accueil des instituts de formation en pédicurie-podologie.
© S. Guarrigues / Beside
UNE PROFESSION DONT LES COMPÉTENCES
NE CESSENT D’ÉVOLUER
Depuis une trentaine d’années, des transformations spectaculaires sont
survenues, élargissant le rôle du podologue dans les pathologies
chroniques comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde ou les troubles
de l’équilibre en gériatrie, mais aussi vis-à-vis de patients plus jeunes
comme en podologie pédiatrique ou sportive. Par voie de conséquence,
nos compétences s’étendent et incluent désormais les soins et conseils
de prévention, l’éducation thérapeutique, dont l’importance est
désormais reconnue pour la prise en charge des pathologies chroniques
et que nous avons la chance de pouvoir réaliser en même temps que nos
soins ; la spécialisation, notamment dans le domaine sportif, est favorisée
par l’évolution technologique…
Ces évolutions vont se poursuivre, en parallèle à celles de notre société,
comme l’indique la fiche du portail des Métiers de la Santé et du Social:
elles doivent être prises en compte au niveau de la formation continue
pour les anciens diplômés, et de la formation initiale pour les futurs
pédicures-podologues. (voir page suivante)
En application du Code de déontologie, certaines autorisations ou dérogations sont délivrées à des niveaux de décision
différents. À qui s’adresser ? Parfois, votre Conseil régional (CROPP) est habilité à accorder la décision finale, d’autres fois,
celle-ci relève du Conseil national (CNOPP). En tout état de cause, votre Conseil régional reste votre interlocuteur privilégié
et c'est à lui seul que vous devez envoyer vos demandes. Le Conseil national travaille en étroite collaboration avec les
régions et s'attachera à vous répondre dans les meilleurs délais, encore une fois, par le biais de vos Conseils régionaux.
Toutefois, devant le caractère d'urgence des demandes, une exception est faite pour les dérogations d'insertions payantes
dans les pages jaunes : votre demande peut alors être adressée directement au Conseil national de l'Ordre.
PRÉSENTATIONS DU CODE DE
DÉONTOLOGIE PAR LES CROPP
Des réunions départementales de
présentation du Code de déontologie
se sont déroulées dans toute
la France depuis septembre dernier,
à l’initiative des Conseils régionaux de
l’Ordre des pédicures-podologues. Elles
ont également été, pour la plupart d’entre
elles, la première occasion de faire se
rencontrer professionnels et représentants
régionaux de l’Ordre.
Avec une fréquentation moyenne repré -
sentant la moitié des professionnels en
exercice, ces réunions ont permis de faire
le point sur les principales questions
que se posent les pédicures-podologues,
au regard des dispositions apportées
par le Code de déontologie, mais aussi
de manière générale, sur l’importance
de la représentation professionnelle
pour la défense des pédicures-podologues
(protection du titre, information…),
les missions des instances régionales
et nationales. En réponse aux inter-
rogations des professionnels qui s’étaient
déplacés, les responsables des Conseils
régionaux ont apporté des éclairages sur
des questions aussi diverses que les
différents modes d’exercice et leurs
implications (libéral, salariat, exercice en
maisons de retraite, remplacement,
collaboration…), des aspects juridiques
(conformité des projets professionnels,
SCI professionnelle, exercice en SEL),
des aspects pratiques (stérilisation,
élimination des déchets...) ainsi que des
sujets d’avenir tels que la formation
continue ou
l’évaluation des
pratiques
professionnelles.
Une mention particulière aux régions
Aquitaine, Bretagne, Limousin, Haute-
Normandie et Franche-Comté, qui ont fait
remonter au national les principales
interrogations des pédicures-podologues
qu’ils représentent. À noter également:
l’intérêt des étudiants qui ont, dans
plusieurs régions, assisté à ces réunions.
dernière minute
<
Le Conseil régional de l'Ordre des
pédicures-podologues de la région
Auvergne a procédé, samedi 19 janvier,
aux élections des membres de la
Chambre disciplinaire de 1ère instance.
Sont élus :
Yves METAYER TITULAIRE,
Cyril MARCHOU TITULAIRE,
Christian DE FRUTOS
SUPPLÉANT,
Brigitte BOREL-VERCESI
SUPPLÉANT.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AUTORISATIONS ET DES NIVEAUX
DE DÉCISION En application du Code de déontologie des pédicures-podologues
L'autorisation d'une insertion payante dans un annuaire à usage public
L'autorisation d'une signalisation intermédiaire
L'autorisation des annonces sans caractère publicitaire
L'autorisation du maintien d'un cabinet secondaire existant avant
le 28 octobre 2007 parution au JO du Code (après avis motivé du CROPP)
L'autorisation de création ou de renouvellement d’une dérogation
pour un cabinet secondaire à compter du 28 octobre 2007
L'autorisation de la mise en gérance d'un cabinet
(après avis du CROPP)
L'autorisation de prolonger la durée du contrat de remplacement (après avis du CROPP)
La création d'un poste d'assistant supplémentaire
L'autorisation de ne pas lier le remplaçant ou l'assistant à une clause
de non-concurrence en fonction des besoins de la santé publique
L'installation dans un local ou immeuble quitté
par un confrère pendant l'année qui suit son départ
La vérification des contrats d'association ou de société
L'autorisation d'assurer le fonctionnement d'un cabinet
en cas de décès d'un professionnel par un autre professionnel
La poursuite ou l'exécution d'un contrat de bail
commercial conclu antérieurement au 28 octobre 2007
R. 4322-74
R. 4322-75
R. 4322-79
R. 4322-86
R. 4322-87
R. 4322-88
R. 4322-89
R. 4322-90
R. 4322-72
Article 2
Dispositions transitoires I
R. 4322-82
R. 4322-85
Article 2
Dispositions transitoires II
© A. Kralik / Beside
CNOPPCROPP

dossier<
dossier
AVRIL 2008 Repères 7
<
L’ONPP ET LE RÉFÉRENTIEL MÉTIER
Ce référentiel, en cours d’élaboration, consiste à décrire, au regard des
usages de la pratique en 2008, l’ensemble des activités professionnelles
qui définissent l’exercice de notre métier ; une activité se définit comme
un premier niveau de regroupement cohérent et finalisé de tâches ou
d’opérations élémentaires visant un but déterminé.
Le référentiel métier doit ensuite servir de base au référentiel de
compétences, qui permettra lui-même de déterminer un référentiel de
formation pour l’obtention du Diplôme d’État. Le référentiel métier peut
également permettre d’élaborer des référentiels de pratiques pour l’EPP.
nationale? Les travaux préparatoires à cette
réforme LMD dans le secteur paramédical ont
imaginé la création d’une année ou d’un
semestre universitaire commun à toutes
les professions de santé, complété par un
apprentissage spécifique à chaque profession
de santé aboutissant à un diplôme d’exercice
de type licence professionnelle: or, cette
dernière risque de bloquer définitivement
les étudiants à ce niveau.
On le voit, la question de la refonte des études
de santé est un problème complexe et
constitue un véritable enjeu de santé publique.
À ce sujet, la position de l’ONPP est claire:
l’Ordre souhaite que la réforme en cours
intègre le dispositif LMD avec une licence
universitaire permettant l’accès au niveau
master et doctorat, c'est-à-dire l’accès
à l’enseignement et à la recherche.
Il revendique 3 années pleines pour la
formation spécifique, théorique, pratique et
comportementale des pédicures-podologues,
dont la formation clinique a lieu essentiel -
lement au sein des instituts de formation,
dans la mesure où, contrairement à d’autres
étudiants paramédicaux, ils n’ont pas beaucoup
d’heures de stages hospitaliers. Ces 3 ans
d’apprentissage sont donc indispensables
pour garantir une formation initiale de qualité
et maintenir notre niveau de qualification
professionnelle à l’échelon européen (le niveau
requis étant de type «bac + 4 ou 5 dont 1 ou
2 années de chirurgie» dans certains pays
proches, tels que la Grande-Bretagne,
l’Espagne et le Portugal).
De la formation continue à l’EPP
Nécessaire et indispensable en raison des
évolutions majeures de notre profession,
la formation continue (FC) des pédicures-
podologues est également devenue
obligatoire depuis la loi n° 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (article L4382-1 du Code de la santé
publique). Cependant, les décrets d’application
relatifs à cette formation continue sont toujours
en attente, et il n’est pas de la compétence
de l’Ordre de les activer: cela rentre dans
les missions des syndicats. En revanche,
il appartiendra à l’Ordre d’organiser la mise
en place et la validation de cette formation
continue, en fonction des règles édictées dans
ces décrets et en lien avec la Haute Autorité
de santé (HAS). Cette validation se fera sous
la forme de crédits d’enseignement (il s’agit
d’une norme européenne), et en fonction du
nombre de crédits obtenus chaque année,
comme c’est déjà l’usage pour d’autres
professions de santé.
En attendant que tout cela se mette
effectivement en place, l’Ordre tient à rappeler
que notre nouveau Code de déontologie prévoit
que «Tout pédicure-podologue doit entretenir
et perfectionner ses connaissances notamment
en participant à des actions de formation
continue et à des actions d'évaluation des
compétences et pratiques professionnelles
telles que prévues à l'article L. 4382-1»
(art.R. 4322-38). L’ONPP recommande
donc à tous les pédicures-podologues
de s’investir - si ce n’est déjà fait - dans
leur formation continue et de constituer
dès maintenant un dossier réunissant les
justificatifs des formations suivies (factures
d’abonnement aux revues spécialisées,
certificats de présence à des congrès ou
séminaires de formation continue). Il est très
important de conserver et d’archiver dès à
présent toutes ces «preuves» de formation.
À travers cette obligation de formation
continue, les pédicures-podologues sont
également impliqués dans la mise en place
de la «fameuse» évaluation des pratiques
professionnelles ou EPP. Même si cette
dernière n’est pas, pour eux, obligatoire,
elle est aujourd'hui une opportunité: en effet,
pour mieux préparer les futurs praticiens aux
réalités professionnelles contemporaines. Le
programme officiel des études date en effet de
1991 et, même si les instituts de formation ont
adapté son contenu, il ne correspond plus à
l’exercice quotidien, à la diversité des approches
cliniques actuelles et des techniques utilisées,
en particulier dans le domaine des orthèses.
La formation initiale doit donc être rénovée
pour s’adapter aux évolutions internes de la
profession; elle doit également intégrer les
modifications externes du système sanitaire
et social français.
Ces nécessités de réforme des études dépassent
le cadre de la pédicurie-podologie et concernent
toutes les professions de santé non médicales:
les réflexions et travaux menés à ce sujet
s’inscrivent dans la démarche globale de
réingénierie des diplômes du secteur sanitaire
débutée en 2007 par le ministère de la Santé.
Alors qu’actuellement, le diplôme est défini par
un programme de formation, cette démarche
de réingénierie est fondée sur un principe
sensiblement différent: le diplôme garantira
que le futur professionnel maîtrise les
compétences nécessaires pour répondre à
l’exigence de qualité des soins et de sécurité
du patient. Ce principe implique que la
formation dispensée et le diplôme qui la
sanctionnera doivent avoir pour base l’exercice
professionnel et les compétences à acquérir
pour y accéder. Il faut donc envisager cette
réforme à partir des trois référentiels:
métier, compétences et formation, sur
lesquels travaille la Commission ordinale
«formation, compétences et évaluation
des pratiques professionnelles».
Une question reste en suspens: comment
cette réingénierie des diplômes du secteur
sanitaire va-t-elle s’articuler avec la mise
en place du dispositif européen LMD
(licence, master, doctorat), prévue en 2010
par les accords de Bologne, et sous la
responsabilité du ministère de l’Éducation
<<<En ce qui concerne le programme
des études, la formation au DE est encadrée
par le décret de 1991: elle comprend 3430
heures d’enseignements obligatoires, répartis
sur 3ans, dont 1735 heures de cours
théoriques et 1695 heures de cours pratiques
et stages, ce qui représente environ 50 heures
de travail par semaine (y compris le travail
personnel). Les deux premières années sont
validées par deux examens de passage. Le
diplôme d’État, en fin de troisième année,
comporte trois épreuves:
>une épreuve orale de contrôle
des connaissances;
>deux épreuves de mise en situation
professionnelle comprenant un examen
clinique, la conception et la réalisation d’un
appareillage plantaire pour l’une, un soin
de pédicurie avec réalisation d’appareillage
d’ongles d’orteil pour l’autre.
De la réingénièrie
du diplôme à la réforme LMD
Des changements s’avèrent indispensables
Les manifestations
professionnelles annuelles:
>Les Entretiens de podologie de la
Fédération nationale des
podologues.
>Le congrès de la Société française
de podologie (SOFPOD).
>Les 2 congrès de la Société française
de médecine et de chirurgie du pied,
ouverts aux podologues.
>La Journée de podologie des
Entretiens de Bichat (ou Semaines
médicales de Paris).
>La Journée de podologie organisée
à Montpellier.
>Les 8 conférences-débats organisées
par les Ateliers de développement
de la podologie (ADP) à Toulouse
et Marseille.
>Les journées régionales, ou
rencontres à thèmes, organisées
par des syndicats locaux.
>Le congrès annuel de l'API
(Association de Posturologie
Internationale) ...
Les diplômes universitaires
(DU ou DIU) et formations
diplômantes:
>Certains DU des facultés de
médecine sont ouverts aux
pédicures-podologues.
>Des formations courtes sont
également organisées par certains
services hospitaliers.
Les formations aux gestes
et soins d’urgence
L’EPP:
Toute démarche d'évaluation de
ses compétences et pratiques
professionnelles permet de satisfaire
à l’obligation de formation continue.
LES MOYENS DE LA FORMATION CONTINUE
Conséquences majeures sur l’évolution
des activités et des compétences
Actualisation des connaissances
dans ce domaine
Nécessité de se perfectionner en diabétologie
et d’intégrer des réseaux des soins
Renforcement des opérations de traçabilité des soins
Intégrer des diplômes d’université de podologie du sport
Nécessité de s’adapter aux pathologies de la précarisation
Les facteurs clés à moyen terme
Évolution des matériaux et des techniques
de fabrication et de soins
Développement du diabète II et risques
de «pied diabétique»
Modification de la demande du patient et exigences juridiques
Développement des pathologies du pied liées au sport
Renforcement de la précarisation de certaines populations
6Repères AVRIL 2008
© Beside
© S. Guarrigues / Beside
TENDANCES D’ÉVOLUTION DU MÉTIER DE PÉDICURE-PODOLOGUE
d’après la fiche métier 1A506 : www.metiers.santesolidarites.gouv.fr

dossier<
dossier<
8Repères AVRIL 2008
<
interview
Docteur Michel VARROUD-VIAL,
diabétologue à Montgeron (91),
fondateur et président du réseau
diabète REVESDIAB, secrétaire
général de l’ANCRED (Association
Nationale de Coordination des
Réseaux Diabète)
«En 2006, l’ANCRED a été agréée pour
l’EPP sur le programme de bilan annuel de
prise en charge des diabétiques de type
2, issu de l’activité des réseaux et ciblé sur
les 3 principaux risques des diabétiques,
dont le risque podologique. J’ai participé
et je participe toujours, dans le cadre
du réseau REVESDIAB, à ce programme
principalement orienté vers l’évaluation
des pratiques des médecins généralistes.
D’après cette expérience, je tire trois
constats essentiels:
1- L’EPP est faisable puisque, aujourd’hui,
plus de 700 médecins sont engagés dans
cette expérience à travers la France, dont
environ 90 dans notre réseau. Je dirais
même que, dans le cadre d’une activité
en réseau, c’est assez facile de faire de
l’EPP, et de l’incorporer à sa pratique.
2- L’EPP permet une réelle amélioration
des pratiques. On arrive ainsi, dans notre
réseau, à une gradation du risque de
lésions des pieds pour 90% des patients
diabétique; résultat objectif encore plus
intéressant, les soins podologiques sont
maintenant prescrits par les médecins
généralistes dans 100% des cas chez les
patients gradés à haut risque, alors qu’au
début de la démarche, il y a deux ans,
moins de 50% des médecins envoyaient
ces patients chez le pédicure-podologue!
3- Les réseaux donnent une dimension
particulière à l’EPP en l’ouvrant à la coo-
pération multi-professionnelle. Les résul-
tats obtenus sont liés à cette approche
pluridisciplinaire de notre démarche : les
podologues sont en effet invités à participer
à nos réunions d’échanges des pratiques,
au cours desquelles sont analysés les
résultats. Ces échanges pluridisciplinaires
permettent d’améliorer les relations entres
les différents acteurs de la prise en charge
des patients diabétiques, de renforcer la
coopération. Ce décloisonnement des
pratiques est l’une des raisons essentielles
du travail en réseau, mais c’est aussi un
objectif majeur de l’EPP, à mon avis. Et
c’est probablement encore plus important
pour les podologues que pour les méde-
cins, parce que leur reconnaissance en
tant que professionnels de santé est
beaucoup plus récente!
Il me semble donc que, pour les pédi-
cures-podologues, l’EPP est une occa-
sion majeure d’améliorer leurs relations
avec les autres acteurs de soins que sont,
dans le cadre du diabète, les médecins et
les infirmières: je parle des relations fonc-
tionnelles au service des patients, dans la
chaîne des soins. C’est pourquoi, à mon
avis, il ne faut pas faire une EPP centrée
sur sa propre pratique : au contraire, il
faut élargir son EPP aux autres professions
concernées sous la forme, par exemple,
de Groupes Qualité pluridisciplinaires
autour du diabète, ou de la polyarthrite
rhumatoïde…
La démarche EPP est devenue fonda-
mentale pour tous les professionnels de
santé. On ne peut plus maintenant se
reposer sur la formation initiale, et la
formation continue ne suffit pas: il est
démontré que, souvent, elle échoue à
améliorer les pratiques, justement parce
qu’elle n’est pas reliée aux pratiques.
L’EPP, au contraire, est une démarche
réflexive, qui part des pratiques, prend en
compte la coopération avec les autres
acteurs des soins, pour agir sur ces pra-
tiques; c’est probablement la meilleure
façon d’améliorer la qualité de ses pra-
tiques et il est souhaitable que les podo-
logues s’y engagent, non seulement pour
eux, mais pour l’ensemble des parties
intéressées. C’est d’ailleurs une démarche
assez simple, très concrète, qui s’adapte
à chacun, en fonction de ses besoins, de
ses pratiques propres.
J’ajoute qu’aujourd’hui, la prise en charge
d’une maladie chronique, comme le dia-
bète, ne peut se satisfaire de la seule
relation soignant-soigné; elle nécessite
le partage et la coopération de diverses
compétences. C’est une condition indis-
pensable pour améliorer la prise en
charge de ces pathologies chroniques et,
notamment, la prévention des lésions du
pied diabétique.»
L’EPP et la FC ont donc la même finalité, tout
en empruntant des voies complémentaires :
>la FC privilégie une approche davantage
pédagogique, fondée sur l'acquisition de
nouvelles connaissances/compétences;
>l'EPP privilégie une approche davantage
clinique et professionnelle, fondée sur
l'analyse des données de l'activité.
Si les approches sont différentes, l’EPP et la FC se
rejoignent sur le fond, à savoir leur même finalité,
mais aussi leur dimension formative. En effet,
l’EPP est inspirée du «formative assessment»
des anglo-saxons, ou «évaluation formative».
propose maintenant le terme de «développe-
ment professionnel continu». C’est dans cet
esprit qu’il faut comprendre l’EPP.
Il est d’ailleurs probable que des podologues font
déjà de l’EPP sans le savoir: en effet, tout mode
d’organisation de l’exercice favorisant la mise
en œuvre d’une activité protocolée et analy-
sée – comme c’est le cas de toute approche
pluriprofessionnelle, notamment dans les
réseaux de soins – est une démarche d’EPP.
L’ONPP, la HAS et le chantier de l’EPP
Conformément à la loi du 9 août 2004, chaque
Conseil régional de l’Ordre des pédicures-podo-
logues doit organiser des actions d’évaluation
des pratiques en liaison avec le CNOPP et la
HAS. Pour ce faire, l’Ordre national et la HAS
mettent sur pied une convention de collabo-
ration portant sur la mise en œuvre de l’EPP
des pédicures-podologues, notamment la
définition de référentiels, et sur le partage et
la diffusion d’informations à ce sujet.
«L’EPP est une aide pour que les professionnels de santé entrent
dans un processus de formation continue. La démarche consiste
d’abord à observer sa pratique, puis à mesurer l’écart entre celle-ci
et ce qui devrait être fait afin, pour finir, de définir les mesures permet-
tant de réduire cet écart, donc d’améliorer sa pratique. Dans son
essence, cette démarche est habituelle pour les professions de
santé puisqu’il s’agit en quelque sorte d’établir un diagnostic et un
traitement, en prenant du recul par rapport à sa pratique, en devenant
observateur de sa pratique qui est l’objet de l’analyse. Elle est,
de plus, naturelle aux professions de rééducation, comme la
pédicurie-podologie, qui ne comportent pas de procédure sté-
réotypée. Ainsi, face à un problème fonctionnel, le pédicure-
podologue met en place l’un des moyens thérapeutiques à sa
disposition, et il évalue l’impact de son geste : il va par exemple
vérifier que l’orthèse prescrite a bien permis de modifier les
appuis, il contrôle le résultat obtenu avec des plateformes sen-
sibles : il fait une analyse réfléchie de l’effet de son traitement et
modifie son protocole en fonction du résultat obtenu. C’est le
même cheminement logique dans la démarche d’EPP!
L’EPP est aussi une démarche très concrète, pragmatique, comme
le montrent les 8 domaines identifiés comme composants évaluables
de la pratique de la pédicurie-podologie, et parmi lesquels chaque
professionnel pourra choisir celui qu’il souhaite évaluer:
1- le comportement professionnel;
2- la communication avec le patient, c’est-à-dire le transfert des
informations au patient concernant sa maladie (ce qui se rapproche
de l’éducation à la santé);
3- le bilan et l’examen cliniques, à partir desquels sont prises les
décisions thérapeutiques;
4- le raisonnement clinique qui aboutit à la prise de la décision thé-
rapeutique (évaluable sous la forme de cas cliniques);
5- l’organisation du plan de traitement (nombre de séances pro-
grammées, organisation du suivi…);
6- les interventions thérapeutiques (fiabilité des techniques utilisées,
palette de techniques proposées…);
7- l’EBP (ou « Evidence Based Practice »), c’est-à-dire la pratique
basée sur des preuves ou pratique factuelle. Il y a encore peu de
référentiels de ce type en pédicurie-podologie, parce qu’il s’agit
d’une activité manuelle avec des gestes techniques: la culture de
l’écrit doit se développer, comme en Australie ou au Canada;
8- la gestion des risques, la sécurité du patient (hygiène, événements
indésirables au cours des soins…).
La démarche qualité, qui sous-tend l’EPP, doit permettre aux pro-
fessionnels de mieux structurer, coordonner et organiser leurs
besoins de formation; elle a un effet facilitateur et accélérateur,
avec une hiérarchisation des priorités, permettant effectivement
d’améliorer sa pratique. Elle se conçoit dans la continuité, dans la
perspective d’un développement professionnel continu.
En ce qui concerne la mise en place de l’EPP des pédicures-podo-
logues, la HAS travaille avec l’Ordre, en particulier au niveau régional,
comme l’a prévu le législateur. Les rapports entre les deux institutions
font l’objet d’une convention de partenariat, en cours de signature.
Parmi les professions paramédicales, les pédicures-podologues,
comme les masseurs-kinésithérapeutes, sont en première ligne sur
l’EPP; les conventions de partenariat entre leurs Ordres et la HAS
seront les premières signées ! Ensuite, nous réfléchirons aux possibi-
lités de valorisation de cette démarche qualité. »
interview
D.R.
AVRIL 2008 Repères 9
<
D.R.
D’expérience, l’EPP permet objectivement
d’améliorer les pratiques
Le cheminement de l’EPP:
une démarche naturelle pour
les professions de rééducation
Pierre TRUDELLE
Chef de projet EPP à la HAS,
référent pour les pédicures-
podologues et les masseurs-
kinésithérapeutes
comme le précisent les textes «l'obligation
de formation est satisfaite notamment
par tout moyen permettant d'évaluer
les compétences et les pratiques
professionnelles ».
Qu'est ce que l’EPP?
C’est une démarche personnelle, volontaire et
organisée, consistant à analyser ses pratiques et
les résultats obtenus pour les comparer (avec ou
sans ses pairs) aux référentiels et recommanda-
tions professionnels existants. De cette compa-
raison doit résulter une amélioration des pra-
tiques, au bénéfice du patient.
Elle n’a pas pour but d’être normative ni d'établir
un état des lieux ou un contrôle, à un temps
donné, statique. Au contraire, l'évaluation for-
mative est un processus dynamique, condui-
sant à l'amélioration continue, ce qu’on
appelle aussi "la démarche qualité". C'est
l'évaluation formative que les professionnels de
santé vont mettre en œuvre au travers de l’EPP.
Et n’est-il pas plus pertinent et motivant
d'orienter l’amélioration d’une pratique à par-
tir des questions que (se) posent les profes-
sionnels qui l’exercent?
EPP ou développement
professionnel continu
Le terme même d’«évaluation des pratiques pro-
fessionnelles» ne doit pas désorienter ou faire
peur: il ne s’agit absolument pas d’un contrôle
normatif, mais d’une démarche personnelle et
formative, d'amélioration de la qualité, inté-
grée à l'exercice quotidien, donc pérenne.
C’est pourquoi la Haute Autorité de santé (HAS),
chargée de la mise en œuvre du dispositif d’EPP,
© S. Guarrigues / Beside
 6
6
 7
7
1
/
7
100%