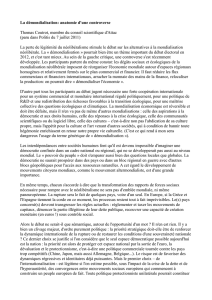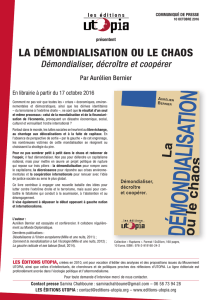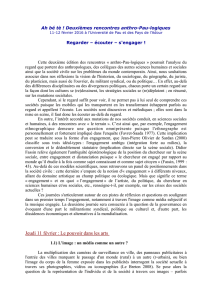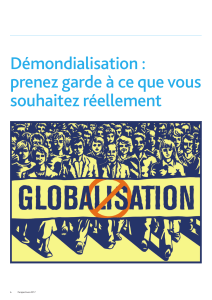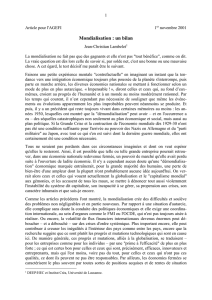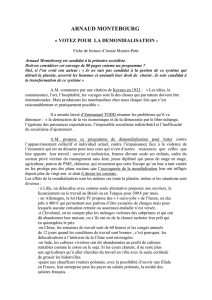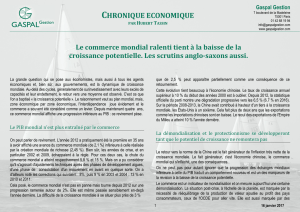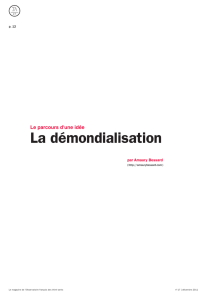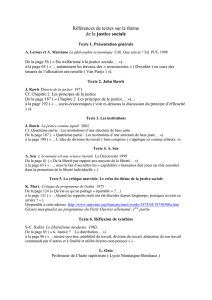La démondialisation: Un défi à la justice globale

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
CHAIRE HOOVER D’ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
La démondialisation
Un défi à la justice globale
ETES 2004 : Travail de synthèse personnel
Pr. Philippe Van Parijs
Pierre-Etienne Vandamme Année académique 2011-2012

1
Introduction
Tandis que l’Union européenne est secouée par une crise aux multiples visages – financière,
démocratique, sociale, idéologique –, crise dont certains intellectuels affirment qu’elle est
nécessaire, qu’elle est un passage naturel sur la voie lente mais sûre de la jeune construction
européenne1, un nouveau concept a fait son apparition dans la campagne présidentielle
française, sans pour le moment trouver un écho très large dans le reste de l’opinion publique
internationale, c’est celui de la « démondialisation »2. De façon a priori désarçonnante, il a
mis d’accord aussi bien l’extrême droite (Marine Le Pen) que l’extrême gauche (Jean-Luc
Mélenchon) et la gauche modérée (Arnaud Montebourg, qui en avait fait son slogan de
campagne)3. À gauche, chez le candidat malheureux aux primaires socialistes, Arnaud
Montebourg, on défend un protectionnisme européen – dans l’intérêt du Nord comme du Sud,
affirme-t-on –, un protectionnisme « altruiste et solidaire »4.
Au-delà de ces programmes politiques particuliers, il convient d’interroger ce nouveau
concept et ses enjeux, en ciblant les problèmes auxquels ses partisans prétendent apporter une
réponse et en évaluant cette réponse à l’aune de critères de justice. Le propos de ce travail ne
consistera pas à recenser la liste exhaustive des problèmes politiques, économiques, sociaux,
environnementaux et culturels que pose la mondialisation, mais d’en cibler quelques-uns des
principaux – nous avons choisi 1/ le délitement des États providence, qui concerne les
démocraties libérales occidentales essentiellement ; 2/ l’homogénéisation culturelle, politique
et économique, ou « occidentalisation du monde », qui inquiète notamment les pays en voie
de développement ; 3/ la perte d’autonomie démocratique des États-nations, qui est constatée
par tous et fait le lien entre les deux premiers problèmes. C’est donc sur ces points que nous
allons successivement nous pencher, au moyen d’apports théoriques divers, qui ne se
cantonnent pas aux écrits explicitement « démondialistes »5, mais qui sont de nature à soutenir
ou remettre en cause ce projet.
En toile de fond, c’est bien entendu la crise écologique qui constitue le problème majeur
engendré par la mondialisation des échanges et la dérégulation des marchés. Ce problème est
trop évident que pour être rappelé et analysé spécifiquement ici, mais il est bien entendu que
toute solution aux autres problèmes soulevés devra apporter en premier lieu une réponse
crédible à cette crise aux conséquences potentiellement désastreuses pour les générations
futures.
1 Cf. VAN MIDDELAAR Luuk, Le passage à l’Europe. Histoire d’un commencement, Paris, Gallimard, 2012.
2 En anglais : deglobalization. En français on utilise également « déglobalisation ». La démondialisation n’est
pas identique à l’altermondialisme ; elle implique, dans ses différentes variantes, une certaine dynamique de
repli, de retour à des formes plus locales d’autonomie et d’économie.
3 Cela paraît moins étonnant si l’on tient compte du fait que Marine Le Pen semble avoir déplacé le
positionnement politique du Front National de l’extrême droite au « socialisme ethnique », pour reprendre
l’expression du politologue Dominique Reynié. Tandis que son père, Jean-Marie, prônait « moins d’État », elle
centre son programme sur une préservation des avantages de l’État social…pour les Français uniquement. Cf.
REYNIÉ Dominique, Populisme : la pente fatale, Paris, Plon, 2011, cité dans MORA Miguel, « Du AAA pour Le
Pen », dans Courrier international n° 1107, 19-25 janvier 2012, p. 9.
4 MONTEBOURG Arnaud, Votez pour la démondialisation. La République plus forte que la mondialisation, Paris,
Flammarion, 2011, p. 52.
5 Nous n’en avons identifié que deux, outre le manifeste de Montebourg : La démondialisation. Idées pour une
nouvelle économie mondiale, du sociologue philippin Walden Bello, fondateur et directeur de l’ONG Focus on
the Global South, initialement paru en 2002 chez Zed Books, ainsi que La démondialisation de l’économiste
français Jacques Sapir, paru l’an dernier aux éditions du Seuil. L’idée d’un protectionnisme européen est
défendue notamment par Emmanuel Todd dans Après l’Empire, Paris, Gallimard, 2003.

2
1. La fin de l’État providence ?
Le principe de l’État providence est simple : assurer à tous les citoyens un ensemble de droits
fondamentaux qui, au contraire du paradigme du droit libéral, ne se contentent pas d’être des
droits formels, mais également économiques et sociaux (droit à une aide aux soins de santé, à
une protection sociale en cas de perte d’emploi, à une pension de retraite, etc.). Pour financer
cette redistribution, un impôt de solidarité proportionnel est prélevé sur l’ensemble des
citoyens et sur les entreprises. On peut considérer cela comme le grand acquis (et le grand
compromis apaisant la lutte des classes) des démocraties libérales occidentales dans l’après-
guerre, bien qu’une révision des fondements éthiques de l’État providence soit encore
envisageable, voire souhaitable1. Cependant, ce n’est pas tant cette révision potentielle à la
hausse qui inquiète nos contemporains, mais plutôt le démantèlement, entamé depuis quelques
années déjà, de ces acquis sociaux obtenus de longue lutte.
La menace vient, outre de la crise économique, plus fondamentalement du contexte
mondialisé dans lequel se jouent désormais l’ensemble des relations économiques. Ce
contexte se caractérise très simplement par la concurrence, qui consiste en ceci que les
niveaux de vie et les législations étant extrêmement variables d’un pays et d’un continent à
l’autre, le coût du travail varie en conséquence énormément. Dès lors, l’enjeu pour les
entreprises est de produire dans les meilleures conditions, ces dernières se définissant en
fonction 1/ du coût local du travail, 2/ de la réglementation concernant ce travail, et 3/ des
charges fiscales. C’est ce phénomène d’une simplicité désarçonnante qui engendre celui des
délocalisations multiples, qui façonnent désormais le quotidien des travailleurs du monde
entier2.
Cette logique compétitrice, dans laquelle s’inscrivent naturellement les entreprises n’ayant
d’autre objectif que le profit maximal, a des répercussions évidentes sur le comportement des
États, obligés d’eux-mêmes se muer en entreprises3. En effet, leur capacité à réaliser leurs
fonctions redistributive et régulatrice dépend des recettes fiscales, menacées par la possibilité
permanente de la délocalisation, tant au niveau des individus (c’est facile, il suffit de se
domicilier sous des cieux plus cléments) que des entreprises (plus ardu, mais plus évident, car
aucun théoricien n’a jamais supposé à celles-ci un sens de la justice ou de la solidarité).
Comme l’illustre la courbe dite de Laffer, il existe un point de tangence à partir duquel les
recettes de l’État diminuent en fonction de l’augmentation du taux d’imposition. Or, plus la
circulation est aisée entre des zones de taxation différenciée, plus le taux optimal d’imposition
diminue. Dès lors, la configuration actuelle d’économie mondialisée (et de marché commun
en Europe), tandis que le pouvoir de taxation demeure la prérogative des États nations,
contribue évidemment à limiter drastiquement la marge de manœuvre de ces derniers en
matière redistributive. « Tous les diagnostics finissent en effet par admettre que les
gouvernements nationaux sont contraints de s’engager dans un jeu à somme nulle dans lequel
les valeurs nominales, exigées par l’économie, ne peuvent être atteintes qu’au détriment des
objectifs sociaux et politiques. »4
1 Cf. VAN PARIJS Philippe, « Assurance, solidarité, équité. Les fondements éthiques de l’État-Providence », dans
Cahiers de l’École de sciences philosophiques et religieuses, n° 12, 1992, p. 49-72.
2 D’après Jacques Sapir, près de la moitié du chômage actuel en France serait causée par les pertes directes et
indirectes liées aux délocalisations. Cf. SAPIR Jacques, La démondialisation, Paris, Seuil, 2011, cité dans
MONTEBOURG Arnaud, op. cit., p. 31.
3 VAN PARIJS Philippe, Sauver la solidarité, Paris, Cerf, 1995, p. 65 sq.
4 HABERMAS Jürgen, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard, 2000, p. 30.

3
En contexte de crise, de surcroît, quand les dettes se rappellent à nos bons souvenirs, les États
se voient priés par des agences de notations indépendantes, du jugement desquelles dépendent
les crédits bancaires, d’instaurer des mesures d’austérité (réduction des dépenses, du nombre
de fonctionnaires, etc.), afin de redevenir compétitifs. Les victimes de cette situation sont
avant tout les chômeurs, considérés même par la gauche comme « inadaptés ». Il y aurait
évidemment lieu, dans un tel contexte, de repenser l’hypocrisie du droit au travail et la
transition vers un droit inconditionnel au revenu, mais la mode n’est ni aux dépenses ni à
l’innovation socio-économique. Au contraire, c’est un conservatisme néolibéral qui s’impose,
vraisemblablement oublieux des leçons du passé. Les autres victimes sont les immigrants
économiques, repoussés au prétexte qu’ils n’ont « pas de bonnes raisons » de vouloir quitter
leur misère pour une misère moindre (ou du moins offrant davantage de perspectives
d’amélioration). Par ailleurs, les budgets consacrés à la coopération au développement sont
gelés, comme si cette question n’était pas liée à la précédente. Bref, la solidarité se délite
autant à l’intérieur des États qui avaient le mieux réussi le « compromis historique » de l’État
social1 qu’entre le Nord et le Sud. Pire encore, les États d’Europe qui avaient pris le risque de
mutualiser leurs économies en adoptant une monnaie unique s’avèrent incapables de réagir à
la crise par des pactes de solidarité, préférant l’austérité chacun chez soi.
En conclusion, selon Arnaud Montebourg, « la mondialisation est désormais un système
perdant pour tous les travailleurs, classes laborieuses, populaires et moyennes du monde
entier ; les uns parce qu’ils perdent ce qu’ils ont chèrement acquis, les autres parce qu’ils ne
gagnent rien ou pas grand-chose »2.
2. Mondialisation et colonialité
Alors que nous venons de voir ce que la mondialisation coûte aux démocraties occidentales, il
convient dans ce deuxième point de décentrer quelque peu la pensée pour examiner la
situation d’un autre point de vue : celui des pays dits « en voie de développement »,
expression qui semble annoncer la promesse d’une « égalisation » à venir des niveaux de
développement. Et si le développement, pourtant, n’était qu’une idéologie ? D’après Paul
Ricœur, la fonction de l’idéologie est double : légitimer et occulter3. Ce qui est occulté,
refoulé par les consciences occidentales, c’est le coût que l’« émancipation » européenne fait
porter aux autres cultures, c’est la destruction et l’oppression qu’engendre son expansion. Le
développement, la défense de la démocratie et des droits de l’homme ne seraient-ils que des
outils permettant de légitimer l’ordre des relations socio-économiques mondiales en
dissimulant la réalité de l’exploitation et de la paupérisation de nombreuses populations du
Sud ?
C’est dans cette voie que s’inscrit Serge Latouche, notamment4. Mais mieux vaut sans doute
opérer ici un geste de « désobéissance épistémologique »5 et donner la parole à des voix non
occidentales. En effet, en Amérique du Sud, notamment, il existe un groupe de travail qui vise
une critique décoloniale des modes de pensée (occidentaux) dominants, enfermés dans ce
qu’ils définissent comme la « matrice coloniale de pouvoir ». Si la période de colonisation du
monde, au sens d’une entreprise politique expansionniste, est à peu près achevée, le processus
1 Cf. ibid., p. 25-27.
2 MONTEBOURG Arnaud, op. cit., p. 32.
3 Cf. RICŒUR Paul, « Science et idéologie », dans Revue philosophique de Louvain, 72, n°14, p. 328-356.
4 Cf. LATOUCHE Serge, L’occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de
l’uniformisation planétaire, Paris, La Découverte, 2005.
5 L’expression est de Walter Mignolo.

4
de mondialisation manifeste à l’évidence des relents de colonialité, c’est-à-dire une relation
de domination hiérarchique qui se joue autant sur les plans politique et socio-économique que
culturel et intellectuel1. L’ère qui s’est ouverte avec la naissance du capitalisme en Europe et
l’expansion vers le Nouveau Monde ne s’est pas refermée ; l’eurocentrisme (à entendre dans
un sens large) domine.
Intellectuellement, notre conception du monde est intimement liée à l’avènement de la
modernité. Or, à en croire les tenants de la critique décoloniale, l’histoire de la modernité
occidentale est l’histoire de la volonté de domination de l’Occident sur le monde. Et
l’avènement du capitalisme, qui a marqué de son sceau la modernité, était, dans son essence,
colonial. Comme le faisait remarquer Marx, en effet, « le marché mondial constitue la base du
capitalisme [et] c’est la nécessité pour celui-ci de produire à une échelle constamment élargie
qui l’incite à étendre continuellement le marché mondial »2.
D’emblée, « les Européens générèrent une nouvelle perspective temporelle de l’histoire et re-
situèrent les peuples colonisés, ainsi que leurs histoires et cultures respectives, dans le passé
sur une trajectoire historique dont l’aboutissement était l’Europe »3. Et cet aboutissement se
caractérise grossièrement par le libre marché, les droits de l’homme et la démocratie,
indissociés, du haut desquels l’Occident peut désormais contempler le monde et le juger.
Cependant, le projet moderne, considéré comme émancipatoire par les Occidentaux, serait
indissociable de son pendant négatif, hégémonique et destructeur. « Modernity as a discourse
and as a practice would not be possible without coloniality, and coloniality continues to be an
inevitable outcome of modern discourses. »4
Le caractère autocentré du projet moderne se fait plus évident encore si l’on songe au
paradoxe de la prétention à l’universalité du modèle occidental de développement. En effet, ce
que dissimule cette prétention, c’est le caractère non universalisable du modèle. Du point de
vue environnemental, c’est évident, et il semble presque d’une affligeante banalité de rappeler
qu’une généralisation mondiale de l’empreinte écologique moyenne des Occidentaux ne serait
absolument pas soutenable – d’où naît en Occident une forme de néo-malthusianisme
encourageant les pays émergents à veiller à leur croissance démographique. Du point de vue
socio-économique, par ailleurs, l’Occident se nourrit des inégalités mondiales permettant de
profiter de main-d’œuvre à moindre coût pour faire circuler et s’accroître les capitaux – et il
est fort probable qu’il lui soit préférable de maintenir cet écart de richesses.
Ce paradoxe de l’universalisme ethnocentré permet de mieux comprendre en quoi les
politiques occidentales de développement sont fondamentalement coloniales : c’est la défense
d’intérêts privés sous prétexte de civilisation. Ainsi, l’ancienne hiérarchie raciale demeure
encore dans les relations internationales, comme en témoignent la « division internationale du
travail »5 et ce que David Harvey, inspiré par Marx, a appelé « l’accumulation par
1 Voir le numéro des Cultural Studies consacré à la question (vol. 21, Nos 2-3, Mars-Mai 2007).
2 MARX Karl, « Le Capital, III », dans Œuvres, Paris, Gallimard, 1968, p. 1101.
3 QUIJANO Aníbal, « Colonialité du pouvoir, eurocentrisme et Amérique latine », http://www.decolonial
translation.com/francais/colonialite-du-pouvoir-eurocentrisme-et-amerique-latine.html, page consultée le 15
mars 2012.
4 MALDONADO-TORRES Nelson, « On the coloniality of being. Contribution to the development of a concept »,
dans Cultural studies, op. cit., p. 244.
5 GROSFOGUEL Ramón, « The espistemic decolonial turn. Beyond political-economy paradigms », dans Cultural
Studies, op. cit., p. 219.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%