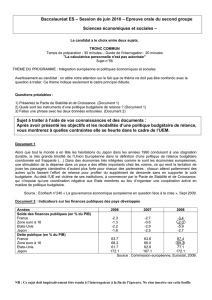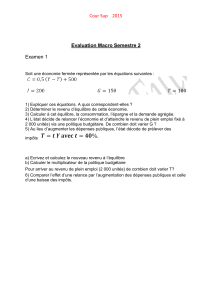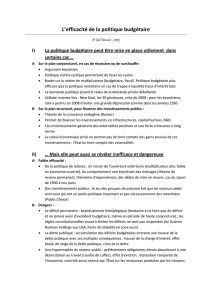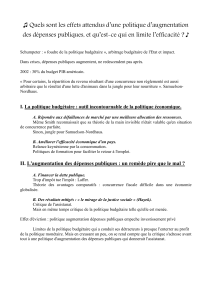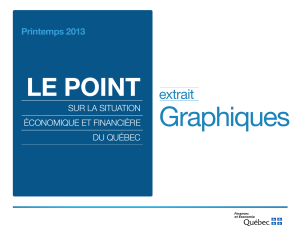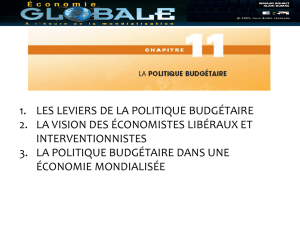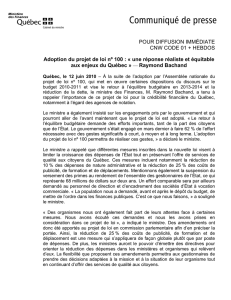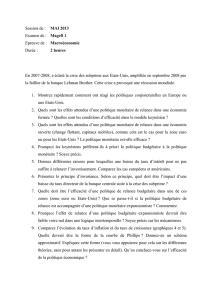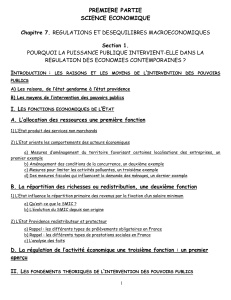C22/ La politique conjoncturelle budgétaire

1
C22/ La politique conjoncturelle budgétaire
A) Qu’est-ce que la politique budgétaire ?
Document 7, p. 62
1. Quels sont les objectifs de la politique budgétaire ?
La politique budgétaire vise le plein emploi, croissance, stabilité des prix, et équilibre extérieur.
2. Qu’appelle-t-on une politique budgétaire de relance ? une politique budgétaire de rigueur ?
a) La politique de relance
Objectif : stimuler la demande globale (consommation, investissement) pour lutter contre le chômage et accroître la
croissance économique.
Moyens : hausse des dépenses publiques et/ou une baisse des impôts.
b) La politique de rigueur ou d’austérité
Objectif : freiner la croissance de la demande pour réduire le déficit extérieur et limiter l’inflation.
Moyens : hausse des prélèvements obligatoires et une baisse des dépenses publiques.
Les politiques de relance menées par les États-Unis et les pays européens en 2009 pour faire face à la crise peuvent servir
d’exemples pour illustrer la notion de politique budgétaire de relance. De même, le plan d’austérité menée par la Grèce en 2010 peut
illustrer la notion de politique de rigueur.
3. Quels sont les 3 instruments de la politique budgétaire ?
Comme son nom l’indique, la politique budgétaire agit sur l’économie en utilisant le budget des administrations publiques.
Les 3 instruments sont donc :
La fiscalité (hausse ou baisse des impôts sur le revenu, sur les sociétés…) ;
Les dépenses publiques (prestations sociales, dépenses d’investissement…) ;
Le solde budgétaire (déficit public).
4. Comment une baisse des impôts peut stimuler la croissance.
5. En quoi les dépenses publiques peuvent-elles avoir des effets conjoncturels et structurels sur
l’économie ?
Les dépenses publiques = investissements publics dans certains secteurs économiques (projets de grand travaux sur les
lignes de TGV, investissements dans la recherche publique, aides à certaines entreprises « champions nationaux » comme
Alstom, plan d’aide à l’industrie automobile en 2009…).
Effets :
Conjoncturels, avec la relance du secteur économique concerné, la création d’emplois directs et indirects liés
à l’investissement… ;
Structurels, avec l’amélioration à long terme de la compétitivité du secteur économique concerné et donc de sa
croissance potentielle.
Baisse des
impôts
Hausse du
revenu
disponible
Hausse de la
consommation
Hausse de la
production
Hausse de
l’épargne
Croissance du
PIB

2
Document 8, p. 63
6. L’ « effet multiplicateur » ? (J. M. Keynes en 1939)
Une variation d’une des composantes de la demande (consommation, investissement, dépense publique) provoquera une
variation plus élevée de la demande.
Document 9, p. 63
7. Définissez la notion de stabilisateur automatique.
Mécanismes par lesquels le solde budgétaire joue un rôle de stabilisation de la conjoncture (action contracyclique) de
manière spontanée et automatique :
En période de récession, les dépenses et les recettes fiscales mécaniquement, d’où l’apparition d’un
déficit budgétaire. l’État va donc redistribuer davantage de revenus par l’intermédiaire des allocations chômage et
des prestations sociales, ce qui va jouer un rôle de soutien à la consommation.
En période de croissance, les recettes fiscales et les dépenses publiques (comme les allocations
chômage) mécaniquement.
L’instrument budgétaire permet de contrecarrer la contraction de l’activité. Les seules baisses d’impôt et l’augmentation
des dépenses publiques actives n’auraient pas suffi (effet de relance de 2,2 points de PIB contre une contraction prévue de
5 points de PIB pour l’Espagne).
B) Les limites de la politique budgétaire
1.1 Quels sont les coûts liés au financement de la politique budgétaire ?
Pour financer une politique budgétaire de relance, l’État peut recourir :
SOIT A L’EMPRUNT = une de la dette publique
SOIT A LA DES IMPOTS.
Ces deux sources de financement comportent des limites.
1. L’emprunt, source d’effet d’éviction
Le recours à l’emprunt peut entraîner un EFFET D’EVICTION, c’est-à-dire le rationnement de la demande de capitaux des
agents privés sur le marché financier du fait de la présence de l’État. L’éviction s’appuie sur 2 mécanismes :
Un effet QUANTITE : l’État est un acteur puissant qui offre des garanties. Il sera donc servi en priorité par les
prêteurs, ce qui réduit d’autant la quantité de capitaux disponibles pour les autres emprunteurs ;
Un effet PRIX : l’ de la demande de capitaux sur les marchés financiers (investisseurs privés + État) face à une
offre inchangée conduit à une du prix des capitaux, c’est-à-dire des taux d’intérêt = Les capitaux deviennent
ainsi plus coûteux pour les emprunteurs privés.
Cet effet d’éviction peut entraîner une BAISSE DE L’INVESTISSEMENT PRIVE ET FREINER L’EFFET DE RELANCE
impulsé par la politique budgétaire.
2. L’impôt, source de désincitation au travail
Pour éviter cet effet d’éviction, l’État peut financer augmenter les impôts. Cependant, ce choix n’est pas sans conséquence.
L’économiste américain A. Laffer a montré, à travers sa fameuse « courbe en cloche », QU’AU-DELA D’UN CERTAIN
SEUIL D’IMPOSITION, LES INDIVIDUS SONT INCITES A REDUIRE LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE.
Cela a 2 effets majeurs :
Un frein pour la croissance économique, puisque l’activité se ralentit ;
Une baisse des recettes de l’État (d’où l’expression « trop d’impôt tue l’impôt »).

3
Certaines mesures fiscales récentes prises en France (loi TEPA du 21 août 2007 pour la défiscalisation des heures
supplémentaires et le plafonnement du taux d’imposition sur le revenu à 50 %) s’appuient sur cette théorie.
1.2 Quelles contraintes pèsent sur la politique budgétaire ? = problème à long terme de soutenabilité des
finances publiques
La dette publique correspond à l’ensemble des EMPRUNTS PUBLICS CONTRACTES PAR TOUTES LES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. Le service (ou charge) de la dette est le montant à rembourser chaque année, qui
comprend une part de CAPITAL + INTERETS.
Lorsque la dette publique s’accroît fortement, cela pose 2 problèmes :
Les MARGES DE MANŒUVRE BUDGETAIRES pour financer des politiques économiques, une grande part
des dépenses étant affectées au paiement du service de la dette (15,6 % en 2009 pour la France, par exemple) ;
L’État peut se retrouver dans une SITUATION D’INSOLVABILITE, c’est-à-dire d’incapacité à faire face au
remboursement de la dette sans recourir à des ajustements budgétaires importants. La situation de la Grèce en
2010 caractérise cet état d’insolvabilité.
Ce problème de soutenabilité peut se poser d’autant plus si un effet « boule de neige » (d’autoalimentation de la dette) se
met en place. LORSQUE LE TAUX DE CROISSANCE EST AUX TAUX D’INTERET, LES RECETTES FISCALES
(stabilisateur automatique), TANDIS QUE LES CHARGES D’INTERETS, qui font partie des dépenses publiques, =
creusement du déficit budgétaire. L’accroissement du déficit doit être financé par un nouvel endettement : c’est l’effet
« boule de neige ».
1.3 Quelles sont les limites à l’efficacité des politiques budgétaires ?
1. Les anticipations des agents
Les anticipations des agents économiques jouent un rôle central dans la réussite d’une politique économique.
Une politique budgétaire de relance sera d’autant plus efficace que les individus croient en la reprise. Cela évitera
les comportements attentistes et favorisera les actes de consommation et d’investissement. Ainsi, des anticipations
optimistes peuvent jouer comme un amplificateur pour une politique de relance.
Les anticipations peuvent aussi limiter fortement l’efficacité d’une politique budgétaire. Dans le cas d’une politique de
relance financée par l’emprunt, la théorie de l’équivalence ricardienne (Ricardo-Barro) énonce que les agents
économiques anticipant une hausse future des impôts pour rembourser vont épargner davantage, réduisant de ce
fait l’effet multiplicateur.
Enfin, selon le courant des anticipations rationnelles, les agents économiques connaissent l’ensemble des effets induits
par les politiques économiques mises en place, notamment l’inflation. Ils ne seraient alors pas dupes et
n’augmenteraient pas leurs dépenses, anticipant la dégradation de leur pouvoir d’achat.
L’ensemble de ces analyses démontre la nécessité de prendre en compte les anticipations des agents économiques lors
de la prise d’une mesure de politique économique. Le suivi des indicateurs tels que l’indice de climat des affaires ou le
moral des ménages (enquête mensuelle de conjoncture) par l’Insee va dans ce sens.
2. Les délais de mise en œuvre
Peuvent transformer une politique contracyclique en une politique procyclique.
Par exemple, une politique budgétaire de rigueur (baisse des dépenses publiques, hausse des impôts) décidée pour faire
face à une situation de forte croissance inflationniste peut, du fait des délais de mise en œuvre, produire ses effets, alors
que la situation économique a évolué et que la croissance est ralentie, voire négative. Dans ce cas, la politique de rigueur
risque d’aggraver la récession.

4
3. Les « fuites » dans une économie ouverte
Dans une économie ouverte, l’effet multiplicateur peut être affaibli par deux fuites principales : l’épargne, et la
consommation de produits importés.
L’effet multiplicateur (1 / 1 – c) est d’autant plus fort que la propension à consommer (c) est forte. Si la hausse des revenus
induite par la politique économique est affectée en grande partie à l’épargne, cela n’a pas d’effet d’entraînement positif sur
l’économie (pas de consommation, donc pas de production supplémentaire).
De même, si une grande partie des revenus distribués se porte sur la consommation de produits importés, cela va
entraîner une relance de la production des pays en question, mais n’aura aucun impact sur l’économie nationale.
1
/
4
100%