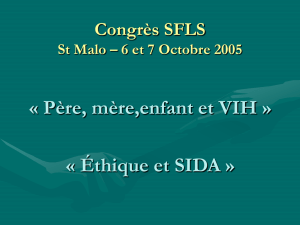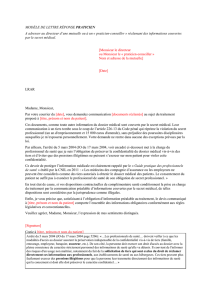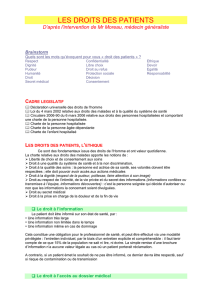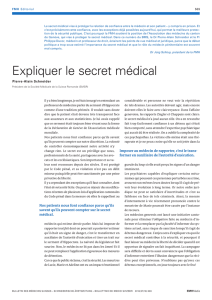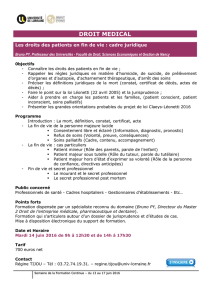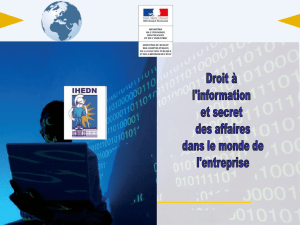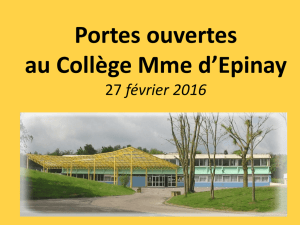confidentialité 1 - Cadredesante.com

www.cadredesante.com
"Toute reproduction part
ielle ou totale de la présente publication est interdite sans l'autorisation de l'auteur et de son éditeur"
Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
Législation
La confidentialité
1ère partie
: Le secret professionnel
-
Le secret médical
Philippe Kr
atz
, 7 septembre 2003
Descriptif :
Le fondement du secret professionnel repose sur la nécessité du respect de
la liberté et de la personne humaine.
Par secret on entend "ce qui doit être tenu caché des autres" (Dictionnaire Robert). Le
fondement du se
cret professionnel repose sur la nécessité du respect de la liberté et
de la personne humaine.
Le secret médical est une composante du secret professionnel, les médecins n'étant
pas les seuls professionnels de santé tenus au secret professionnel dans les
établissements de soins. Toutes les autres professions de santé sont également liées
par le secret
: les infirmiers, les sages-
femmes, les pharmaciens, les
kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les assistantes sociales, etc.
Par ailleurs,
le statut de la fonction publique hospitalière précise que les
fonctionnaires sont tenus au secret professionnel.
Définition et sanction
Bien que de nombreux textes réglementent le secret professionnel dans les
établissements de santé, il n'existe pa
s de définition légale du secret professionnel.
L'article 226
-
13 du Code pénal sanctionne la violation du secret professionnel mais ne
le définit pas
:
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par
état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporelle, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."
Les Codes de déontologie des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes,
des sages
-femmes, les règles pr
ofessionnelles des infirmiers font tous référence au
secret professionnel qui s'impose à ces professionnels de santé mais aucun n'en
donne une définition.

www.cadredesante.com
"Toute reproduction part
ielle ou totale de la présente publication est interdite sans l'autorisation de l'auteur et de son éditeur"
Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
Une construction jurisprudentielle
Portée
du
secret
professionnel
La portée du secret profes
sionnel relève d'une construction jurisprudentielle fondée
sur deux thèses.
Thèse
absolutiste
Selon la thèse absolutiste le secret a un caractère général et absolu
:
" Cette obligation établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certain
es
professions ou certaines fonctions s'impose aux médecins comme un devoir de leur
état, qu'elle est générale et absolue et qu'il n'appartient à personne de les en
affranchir."
(Cass., crim., 8 mai 1947, D 1948-
109). Ce qui implique que le délit de viola
tion du
secret professionnel est constitué même en l'absence d'intention de nuire
:
"Le délit existe dès lors que la révélation a été faite avec connaissance,
indépendamment de toute intention de nuire." (Cass., crim., 19 décembre 1885, DP
1886-
I. 347).
Thèse
relativiste
La thèse relativiste propose de retenir l'intérêt privé comme fondement du secret
:
"L'obligation de respecter le secret médical est édictée en la matière dans l'intérêt du
malade et elle ne saurait être opposée à celui
-
ci quand la déte
rmination de ses droits
dépend des renseignements recherchés." (Cass., soc., 1er mars 1972, Bull. V, 162).
Dans un arrêt du 12 avril 1957, le Conseil d'État a posé le principe que
:
"Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser à
leurs
clients, lorsqu'ils le requièrent, un certificat destiné à exprimer les constatations
médicales qu'ils ont faites sur leurs personnes." (Conseil d'État, 12 avril 1957, Dupont,
D 1957
-
336).
En conclusion, il ressort de la jurisprudence que le secret
n'est pas opposable au
malade dans l'intérêt duquel il est institué
; à l'égard des tiers, il a un caractère
général et absolu sous réserve des révélations imposées ou permises par la loi,
fondées sur l'intérêt collectif supérieur à l'intérêt individuel.

www.cadredesante.com
"Toute reproduction part
ielle ou totale de la présente publication est interdite sans l'autorisation de l'auteur et de son éditeur"
Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
Contenu du secret
C'est à l'occasion de la célèbre affaire Watelet que la Cour de cassation, en 1885, va
préciser la notion de secret.
Le docteur Watelet, appelé à donner des soins au peintre Bastien Lepage en 1883,
diagnostiqua une tumeur cancéreus
e du testicule gauche dont il l'opéra. Le peintre
décéda en 1885 à Alger où il était allé se reposer sur les conseils du médecin. Le
docteur Watelet fut accusé par la presse d'avoir envoyé le peintre en Algérie pour
dégager sa responsabilité. En réponse, l
e médecin fit publier dans la presse une lettre
dans laquelle il exposait la maladie du peintre et justifiait sa conduite. Poursuivi
pénalement pour violation du secret professionnel, le docteur Watelet soutenait pour
sa défense que les faits avaient été r
évélés par la presse. La Cour de cassation estima
que le secret avait été divulgué puisqu'il s'agissait "d'un ensemble de faits secrets par
leur nature dont il avait eu connaissance en raison de sa profession alors qu'il traitait
Bastien Lepage en qualité
de médecin."
(Cass., crim., 19 décembre 1885). Désormais, le secret couvre non seulement ce qui a
été confié par le patient mais également tout ce que le médecin a vu, entendu ou
compris.
Plus généralement, le secret couvre tout ce qui est parvenu à la c
onnaissance du
professionnel de santé. Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la
personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel des établissements ou organismes et de toute autre personne en relati
on,
de par ses activités, avec ces établissements ou organismes (article L. 1110
-
4 du CSP.
Le secret protégé par la loi vise les renseignements que "le confident recueille dans
l'exercice de ses fonctions, auxquels il n'aurait point eu accès hors l'exercic
e de celles
-
ci". Peu importe que l'information divulguée soit déjà connue
:
"Venant d'un professionnel autorisé, la confirmation transforme en un fait
indiscutable ce qui n'était encore que supposition."
(TGI Paris, 5 juillet 1996, Gubler). La Cour de ca
ssation a précisé que l'obligation du
respect du secret professionnel ne s'impose que dans les relations entre le
professionnel et son client. Le délit n'est pas constitué dès lors qu'il est établi que les
faits relatés dans un certificat rédigé par un méd
ecin concernent une personne qui
n'était pas le client du praticien en cause (Cass. crim., 23 janvier 1996).
Le secret partagé
Afin d'assurer la continuité des soins dispensés au patient ou de déterminer sa
meilleure prise en charge sanitaire, des pr
ofessionnels de santé peuvent être conduits

www.cadredesante.com
"Toute reproduction part
ielle ou totale de la présente publication est interdite sans l'autorisation de l'auteur et de son éditeur"
Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
à échanger des informations concernant ce malade. Ce partage d'informations n'est
possible qu'en l'absence d'opposition du patient (article L. 1110
-
4 du CSP).
Le secret professionnel tel que sa conception a été développée à partir du "colloque
singulier" (entre un professionnel, le médecin, et un non-
professionnel, le patient) ne
peut donc être analysé de la même manière au sein d'un établissement hospitalier.
Le particularisme de ce lieu de soins réside en effe
t dans la prise en charge du patient
par une équipe pluridisciplinaire, voire par plusieurs équipes dès lors que son état
pathologique l'exige.
Le malade n'est plus seul face à son médecin. Le secret, de fait, n'est plus confié à
celui
-
ci par le patient,
mais à un certain nombre de professionnels, lesquels ont un
lien thérapeutique avec le patient.
C'est pourquoi le législateur a précisé que lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la
concernant
sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe (article L. 1110-
4 du
CSP).
Or, si le secret partagé concerne la circulation de l'information entre les seuls
personnels qui concourent à soigner directement un patient, toutes les
informations
dont le médecin a eu connaissance ne sont pas systématiquement transmises à toute
l'équipe de soins
:
le partage du secret doit se justifier dans l'int
érêt du patient
;
le patient doit être informé que chaque professionnel qui intervient dans les soins
qui lui sont apportés, est soumis au secret de par son statut,
conformément aux textes
régissant les différentes professions ainsi qu'à la réglementation pénale
;
seules les informations portant sur les éléments indispensables
aux soins du
patient seront échangées.
Le secret, contrairement à l'idée qui circule communément au sein des établissements
de soins, ne se partage pas avec l'ensemble du personnel d'un même établissement
sous prétexte que tous les agents sont astreints
au secret professionnel.
On peut toutefois s'interroger sur la nécessité de donner une information à un
membre du personnel qui ne concourt pas aux soins mais qui cependant est amené à
avoir un rapport avec le patient d'une manière ou d'une autre.
Exe
mples
• Les agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) ou non (ASH) ne doivent pas
participer à la relève des équipes de soins. Dans la mesure où ils ne sont pas des

www.cadredesante.com
"Toute reproduction part
ielle ou totale de la présente publication est interdite sans l'autorisation de l'auteur et de son éditeur"
Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
personnels de soins, ne disposant d'aucune compétence juridique ni professionnell
e,
ils ne sont pas habilités à prendre part à des soins, ni à participer au staff de relève
des équipes de soins au cours duquel le cas de chaque patient est exposé.
• Un brancardier n'a pas à connaître la pathologie d'un patient pour le transporter. Il
s
era seulement nécessaire de l'informer des précautions à prendre pour effectuer le
transport de ce patient ou lui décrire la pathologie, sans pour autant lui donner accès
au dossier médical. Il en est de même pour les ambulanciers.
Pour chaque situation p
articulière il conviendra donc d'être vigilant quant à
l'information à délivrer au(x) destinataire(s) de cette information.
P.S.
Textes
de
référence
• Article L. 1110-
4 du Code de la santé publique.
• Article 226-
13 du Code pénal.
• Articles 4, 72 et
73 du décret no 95
-
1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale.
• Article R. 5015-
5 du Code de la santé publique.
• Article 5 du décret no 94-
500 du 15 juin 1994 portant Code de déontologie des chirurgiens dentistes.
• Article 3 du déc
ret no 91
-
779 du 8 août 1991 portant Code de déontologie des sages
-
femmes.
• Article 4 du décret no 93-
221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmières.
• Article 9 du Code civil.
1
/
5
100%