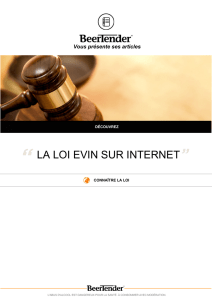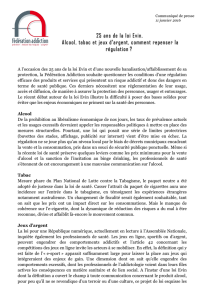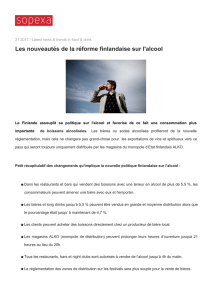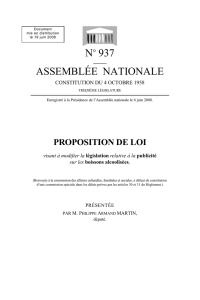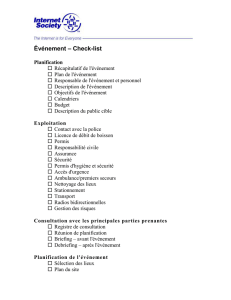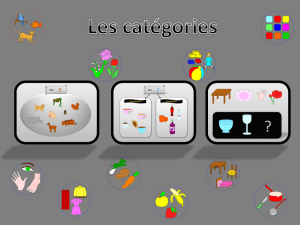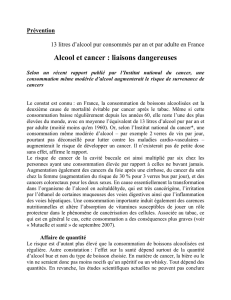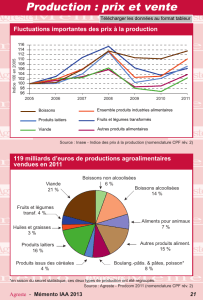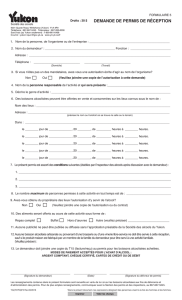sommaire - DoYouBuzz

150

SOMMAIRE
INTRODUCTION............................................................................................1
I. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, LUTTE
CONTRE UN PROBLEME DE SOCIETE, OU BIEN, FREIN ECONOMIQUE ? ............2
1. LA MUTATION D’UNE SOCIETE....................................................................................2
a. Poids et place du secteur alcool en France................................................................................. 2
b. Mouvements préventifs contre l’alcool et réglementation.......................................................... 3
c. Connaissances et perception des boissons alcoolisées............................................................... 4
2. L’IMPACT ECONOMIQUE SUR LE SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES.....................................5
a. Un secteur économique puissant et aussi responsable............................................................... 5
b. Un impact important sur le marché............................................................................................ 6
c. Le cas du marché de la bière...................................................................................................... 7
3. L’EVOLUTION FUTURE DU CADRE REGLEMENTAIRE .............................................................9
a. Une acceptation mitigée des consommateurs : une législation plus restrictive est-elle à
prévoir ?..................................................................................................................................... 9
b. L’alcool, interdit de publicité sur Internet : comment appréhender les évolutions
technologiques dans ce cadre réglementaire ?......................................................................... 10
c. Le lobbying des producteurs de boissons alcoolisées continue : la loi Evin peut-elle
perdurer ? ................................................................................................................................ 11
II. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, OUTIL
DE CENSURE, OU BIEN, VERITABLE DYNAMIQUE CREATIVE ?.......................12
1. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LA RELATION AGENCE-ANNONCEUR.............................12
a. Processus de décision lourd et prise de risques ....................................................................... 12
b. Interprétation de la loi Evin et confrontation des points de vue juridiques.............................. 13
2. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LA REFLEXION STRATEGIQUE DE L’AGENCE ....................14
a. Moyens limités et réduction des champs d’actions................................................................... 14
b. Recherche de nouvelles tactiques et marketing alternatif........................................................ 15
3. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LE PROCESSUS CREATIF .........................................17
a. Champs d’expressions limités et challenge créatif ................................................................... 17
b. Choc entre l’univers juridique et l’univers créatif..................................................................... 19
CONCLUSION .............................................................................................20
TABLE DES ANNEXES ..................................................................................21
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................22

1
INTRODUCTION
La France est le pays qui applique la réglementation la plus sévère en matière de
boissons alcoolisées en Europe. D’ailleurs, plusieurs pays européens, comme la Belgique,
commencent à suivre son exemple. La législation française restreint, entre autres, la vente
d’alcool aux mineurs et l’ouverture des débits de boissons. Les boissons alcoolisées sont
également fortement taxées par l’Etat. Les mesures les plus fortes émanent de la loi Evin de
1991 qui a pour principal objectif de restreindre la publicité en faveur de boissons
alcoolisées. Les aspects du cadre réglementaire de ce secteur sont multiples et surtout très
restrictifs. Pourtant la France est mondialement connue pour ces grands vins et l’alcool fait
partie de sa culture. Mais depuis une quarantaine d’années la consommation est à la baisse
et les comportements ont changé. Les risques et les dangers de l’alcool sont à présent
davantage connus. On voit bien que l’alcool est un produit paradoxal et que sa place en
France n’est plus tout à fait la même qu’il y a quelques années.
Alors, il est intéressant de se demander comment le cadre réglementaire du secteur
des boissons alcoolisées a-t-il pu métamorphoser ce marché ? Et, plus précisément,
comment a-t-il réussi à bousculer les pratiques du publicitaire sur celui-ci ?
De là émerge la question des raisons d’une législation aussi stricte et surtout celle de
ses conséquences. Nous essayerons dans un premier temps d’appréhender ce cadre
réglementaire dans le marché des boissons alcoolisées. La réglementation du secteur alcool
traduit-elle la lutte contre un problème de société, ou bien, représente-t-elle un frein
économique ? Nous aborderons alors la mutation de notre société, puis l’impact économique
de la législation sur le secteur des boissons alcoolisées et enfin les évolutions futures à
anticiper. Dans un deuxième temps, nous nous attarderons plus particulièrement sur la loi
Evin afin de mieux cerner ses conséquences sur le métier et les pratiques du communicant.
La réglementation du secteur alcool constitue-t-elle un outil de censure, ou bien, faut-il la
considérer comme une véritable dynamique créative. Nous verrons d’abord cette ambiguïté
au travers de la relation agence-annonceur, puis dans le cadre de la réflexion stratégique
des agences conseil en communication et enfin au sein du processus de création
publicitaire.

2
I. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, LUTTE
CONTRE UN PROBLEME DE SOCIETE, OU BIEN, FREIN ECONOMIQUE ?
Dans cette première partie, nous nous attacherons à observer et comprendre l’impact
du cadre réglementaire, c'est-à-dire la fiscalité, le code de la santé publique concernant la
vente de boissons alcoolisées et la loi Evin, sur différents aspects du marché de l’alcool en
France. Tout d’abord, nous nous pencherons sur l’évolution de notre société par rapport aux
produits alcoolisés, et ce, au travers du poids culturel et économique du secteur alcool, de
l’histoire de la prévention et de la réglementation contre l’alcool, et enfin, par rapport aux
perceptions actuelles de ces produits. Ensuite, nous nous intéresserons plus
particulièrement à l’impact économique direct et indirect de la réglementation sur ce
marché. Nous verrons en quoi ce secteur est primordial dans l’économie française, puis
l’influence d’une réglementation plus ferme sur la demande, l’offre et la distribution, et
enfin, nous ferons un zoom sur un cas précis : le marché de la bière. En dernier lieu, nous
nous questionnerons sur l’évolution de la réglementation du secteur alcool au regard de
plusieurs thèmes : la perception des mesures par le consommateur lui-même, les avancées
technologiques et les pressions du lobbying du vin.
1. LA MUTATION D’UNE SOCIETE
a. Poids et place du secteur alcool en France
La France est un pays où la place de l’alcool est importante. Poids culturel ou
économique, selon Sarah Howard au début du siècle dernier l’alcool était même associé à
l’identité nationale1.
Il est certain qu’hier et encore aujourd’hui l’alcool occupe une place de choix dans
notre gastronomie. Le vin est un emblème de l’art de vivre à la française. Il est considéré
comme un élément incontournable du repas, au point d’être assimilé à un aliment. Le vin
est un alcool noble et il est la raison d’être de certains métiers de prestige comme les
œnologues. Par ailleurs, tous les grands restaurants français ont leur sommelier, car qu’est-
ce que deviendrait la gastronomie française sans son vin. Au-delà, certains vont même
jusqu’à lui attribuer des effets bénéfiques sur la santé. Louis Pasteur, lui-même, ne disait-il
pas que le vin était « la plus hygiénique et la plus saine des boissons » ? De plus, il faut
noter que les comportements en matière de boissons alcoolisées font l’objet d’une
transmission familiale et culturelle. En effet, entre 15 et 65 ans, seulement 13% des
français signalent que leurs parents ont cherché à limiter leur consommation d’alcool ; alors
que 32% ont subi une interdiction de fumer2. D’ailleurs, le premier contact avec l’alcool a le
plus souvent lieu dans un contexte familial. Ainsi, la consommation de boissons alcoolisées
est fortement ancrée dans la culture française et bénéficie même, selon ces chiffres, de
représentations plutôt positives.
Ce fort poids culturel dans notre société transparait également par la place importante
que prend l’alcool dans l’économie française. Le marché total des boissons alcoolisées
représente, en France, un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros et plus de 500 000
emplois3. L'alcool est avec le tabac la substance psychoactive la plus consommée en France.
On estime à 42,4 millions les expérimentateurs (12-75 ans) de l'alcool en France. Les
usagers réguliers s’élèvent à 9,7 millions4. Autrement dit, le secteur des boissons
alcoolisées est incontournable dans l’analyse de notre économie. D’ailleurs, si l’on regarde la
production agricole, on remarque que la production vinicole, à elle seule, occupe la 2ème
position après la production laitière. Au regard de tous ces éléments, il est logique que les
boissons alcoolisées (surtout le vin) soient fortement associées à la France et à son identité.
Pourtant, nous allons voir que l’alcool est un produit ambivalent.
1 Les images de l’alcool en France, 1915-1942 – Sarah Howard – CNRS Editions – Février 2006
2 Représentations, perceptions et connaissances vis-à-vis de l’alcool – www.etatsgenerauxalcool.fr
3 Marché et réglementation – Entreprise et Prévention – www.ep-soifdevivre.com
4 Le niveau d’usage des drogues en France en 2005 – www.ofdt.fr

3
b. Mouvements préventifs contre l’alcool et réglementation
Si l’alcool est apprécié par les français pour son histoire et pour ce qu’il représente
dans notre gastronomie, c’est aussi un produit dont la consommation excessive est
dangereuse. Aussi, depuis le début du XXème siècle se succèdent les mouvements de
prévention. La priorité se porte sur les cibles les plus fragiles : les jeunes. Jusqu’en 1950,
l’Etat passe par le terrain de l’école et il a recours à une éducation intensive et un
vocabulaire dur : « l’alcool détruit le corps et l’âme ». Les pouvoirs publics jouent sur la
peur et la honte (violences, problèmes de santé, éclatement de la cellule familiale). A cette
époque, on diabolise plus que l’on informe. Après la Seconde Guerre Mondiale et jusque
dans les années 70, la stratégie adoptée est différente. Les autorités privilégient la
sensibilisation et la responsabilisation. On préfère glorifier la sobriété et les boissons sans
alcool. Dans les années 80 et jusqu’à aujourd’hui, l’Etat va prendre conscience que
l’alcoolisme n’est pas la cause mais plutôt la conséquence d’un malaise chez des personnes
qui sont dans une situation à problèmes. Ainsi, on bannit les messages trop sévères des
campagnes de prévention et on parle davantage des risques immédiats de l’alcool. Les
premiers spots télévisés ayant pour objet la prévention contre les produits alcoolisés
apparaissent en 19845 (bien que certains organismes comme l’ANPAA6 existent depuis près
d’un siècle déjà). Même si ces spots n’ont que peu d’effets sur les personnes déjà
dépendantes, ils permettent de les aider à en prendre conscience et surtout d’éviter à
d’autres de le devenir. Ainsi, les autorités préfèrent aujourd’hui prévenir et guérir. Toutes
ces actions et ces mouvements préventifs contre l’alcool se traduisent par une baisse de la
consommation d'alcool en France, depuis le début des années 1960. En effet, en quarante
ans, elle a été divisée par deux7. Cette forte diminution est à mettre en parallèle avec une
réelle prise de conscience des français des problèmes sanitaires et sociétaux liés à l’alcool.
La consommation d’alcool comme le vin reste régulière et fortement ancrée dans la culture
française, mais les quantités consommées ont baissé et les moments de consommation sont
davantage occasionnels (fêtes ou apéritifs et non plus consommation de table quotidienne).
Ainsi, les mouvements préventifs ont portés leurs fruits et le fameux « Consommer avec
modération » a bien été assimilé.
De cette prise de conscience de l’Etat et du grand public, les mouvements de
prévention sont à présent soutenus par une réglementation de plus en plus ferme. Il faut
savoir que la France est un pays qui possède l’une des législations les plus sévères au
monde concernant les boissons alcoolisées. L’Europe prend d’ailleurs en modèle la
législation française. Pourtant, malgré des campagnes de prévention incisives, on compte
encore soixante-trois morts par jour à cause de l’alcool. L’alcool demeure, avec le tabac, la
première cause de mortalité évitable en France. Ainsi, même s’il est clairement ancré dans
la culture de notre pays, il est aussi un véritable problème de société. Au-delà des actions
de prévention, le Ministère de la Santé se doit donc d’appliquer des mesures afin de limiter
les risques liés aux boissons alcoolisées. C’est là l’objectif majeur qui a motivé la création de
la loi Evin le 10 janvier 1991. Les fondements de la réglementation de ce secteur repose sur
le fait que toute incitation à la consommation de boissons alcoolisées apparaît, à priori, de
nature à augmenter la demande, et par conséquent, à détériorer la santé d’un nombre
croissant d’individus. Le droit français restreint donc la possibilité de diffuser une publicité
pour vanter les produits alcoolisés. La législation s’appuie sur un consensus large qui établit
une relation entre expression publicitaire et augmentation du niveau de consommation.
Toutefois, il est important de noter que selon l’OMS rien jusqu’aujourd’hui ne permet de
prouver formellement cette relation.
Au terme des dix premières années d’application de la loi Evin (qui a connu beaucoup
d’aménagements concernant l’alcool), le Ministère de la santé a dressé le bilan8. Il estime
que la loi Evin a marqué une « véritable rupture » dans les politiques publiques menées
jusque là. Cette législation plus ferme a permis à des millions de français de prendre
conscience des graves conséquences que représentait la consommation abusive d’alcool sur
la santé. D’autre part, cette loi représente une rupture dans le sens où elle ne cherche pas à
5 L’alcool : l’histoire d’une prévention – www.france5.fr
6 L’ANPAA est l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.
7 Consommation d’alcool – www.insee.fr
8 Bilan des 10 ans de la loi Evin – www.sante.gouv.fr
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%