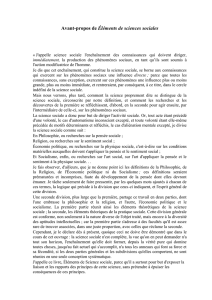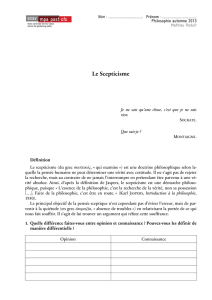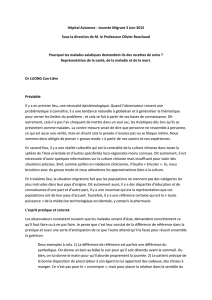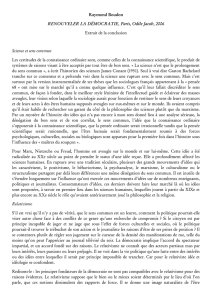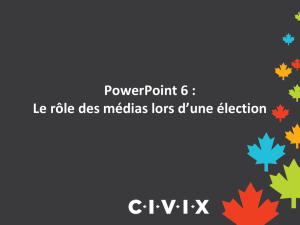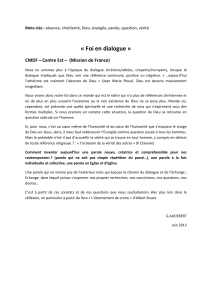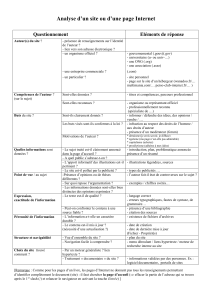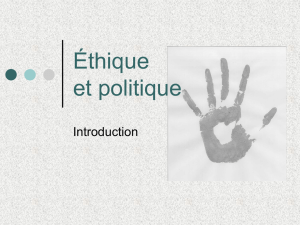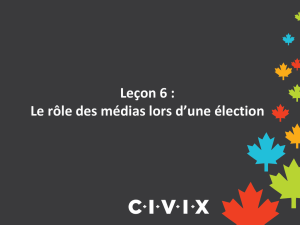Leçon n° 1

ILFM 2008-2009
Stéphane Carpentier
21 septembre 2008
Introduction générale à la philosophie (1)
Leçon n° 1 : le relativisme
Introduction
La recherche de la vérité n’a de sens qu’à la condition de supposer que celle-ci n’est pas une
simple question d’opinion. On ne recherche pas ce qu’on possède déjà, à quoi bon rechercher
la vérité si nous estimons que toutes les opinions sont vraies, que nous la possédons
immédiatement et sans effort. Dans la mesure où la philosophie - en tout cas celle qui se
reconnaît dans la tradition socratique - se définit comme recherche de la vérité, elle doit
commencer par démontrer que la vérité n’est pas une simple question d’opinion, que toutes
les opinions ne sont pas vraies. Mais ce n’est pas seulement l’identité et la crédibilité de la
conception socratique de la philosophie qui est ici en jeu, c’est également d’une manière
générale la possibilité et même la légitimité de l’enseignement. Enseigner, n’est-ce pas
transmettre une vérité à qui ne la connaît pas encore ? Mais si toutes les opinions sont vraies,
si la vérité n’est qu’une simple question d’opinion, à quoi bon enseigner puisque nous la
connaissons spontanément.
I- le relativisme
a- définition
On appelle relativisme toute doctrine suivant laquelle il n’existe pas de vérités
universelles et nécessaires (qui, à ce titre, ne relèvent pas de la simple convention) mais
seulement des vérités relatives aux individus ou aux communautés historiques d’individus.
Comme les individus ne cessent de changer, tout comme les cultures, le relativisme en
conclura qu’il n’existe pas de vérité absolue, mais seulement des vérités variables selon le lieu
et le temps, bref des vérités relatives.
b- les arguments relativistes
1°- la diversité des opinions : selon le relativisme, la simple constatation du fait
indéniable de la variabilité des opinions, tant à l’échelle individuelle qu’à celle des cultures,
est en soi un argument suffisant pour en déduire nécessairement la relativité de toute vérité.
2° -le mobilisme (argument héraclitéen) : si on observe attentivement la réalité
telle qu’elle s’offre à nous dans la sensation et la perception, on constatera que « tout coule »,

c’est-à-dire que rien n’est jamais identique à soi-même ni à autre chose. A bien y regarder,
« on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », tout est en perpétuel changement.
Ce qui nous donne l’impression qu’il existe une certaine stabilité dans le monde vient de
l’extrême lenteur, ou au contraire de l’extrême rapidité des métamorphoses. Et puisque la
vérité est un certain rapport de correspondance entre la pensée et la réalité, on en conclura
qu’il n’existe pas de vérité immuable puisqu’il n’existe pas de réalité immuable.
II- critique des arguments relativistes
a- critique de l’argument de la diversité des opinions.
Que prouve le fait (indéniable) de la diversité des opinions ? Rien, à proprement parler
car il s’agit d’un fait qui peut s’interpréter de deux manières diamétralement opposées, l’une
de ces manières étant justement l’interprétation relativiste, dont le tort tient à ceci qu’elle ne
se présente pas comme une interprétation, mais comme une démonstration. En effet, le
relativisme prétend que la simple constatation de la diversité des opinions suffit pour en
conclure que toute vérité est relative. Or le fait de la diversité des opinions peut s’interpréter
de deux manières possibles. En une première hypothèse, on peut supposer qu’elle est
engendrée par la raison en elle-même qui serait essentiellement variable selon les individus et
les cultures. C’est l’hypothèse relativiste. Par contre, on peut également supposer que la
diversité des opinions est engendrée, non par la raison en elle-même, mais par son mauvais
usage naturel en tant qu’elle est spontanément dominée par l’imagination. Dans cette
hypothèse, toute aussi plausible que la première, la raison est universelle, si bien que la vérité
l’est également. Quoiqu’il en soit on ne peut donc pas considérer que la diversité des opinions
est la preuve de la relativité de la vérité. Ce fait ne prouve rien, ce n’est pas parce que les
opinions sont diverses que l’on peut en conclure qu’il n’existe pas de vérité universelle, c’est
au contraire parce qu’elles sont diverses que l’on se demande s’il existe des vérités
universelles et nécessaires ou pas.
b- critique du mobilisme.
Platon nous invite à remarquer que la thèse d’Héraclite repose sur un présupposé. Elle
postule en effet que la totalité du réel se donne à nous dans la sensation et la perception. Et
pourtant ce n’est pas aussi évident qu’il y paraît ; l’existence des mathématiques comme
théorie des rapports numériques et géométriques semble nous indiquer qu’il existe toute une
dimension du réel qui est constituée par des rapports immuables, et dont la représentation
s’exprime donc dans des vérités universelles et nécessaires. Soit par exemple les êtres
géométriques, dont Euclide donne la définition dans ses Eléments. Un point est ce qui n’a ni
longueur, ni largeur, ni épaisseur. Une ligne est une pure longueur sans largeur, une surface a
elle une longueur et une largeur, mais pas d’épaisseur, etc…Si on considère attentivement ces
définitions, on admettra que les êtres géométriques élémentaires ont une essence qui ne se
manifeste que très imparfaitement dans leurs représentations sensibles. Par exemple, le point
que je trace sur le sable ou la ligne que dessine à la craie sur le tableau ont évidement une
longueur, une largeur et une épaisseur, comme toute chose sensible. Même les volumes
parfaits de la géométrie ne se trouvent jamais parfaitement réalisés dans leurs manifestations
sensibles. Il existe donc avec le monde des figures et des nombres toute une dimension du réel
qui n’apparaît pas très adéquatement dans la sensation et la perception. Bien plus, ce
« monde » est constitué par des rapports immuables, si bien que les mathématiques sont
capables d’énoncer des vérités universelles et nécessaires : quelque soit le triangle auquel
nous avons affaire, la somme de ses angles fera nécessairement 180°. Bien plus encore, les
rapports numériques et géométriques peuvent servir de modèle ou paradigme pour expliquer

ou agir sur certains types de rapports sensibles, c’est déjà le cas à l’époque de Platon pour
l’astronomie et l’architecture. Il y a donc une certaine participation du sensible à l’intelligible,
si bien que la réalité sensible n’est pas aussi chaotique qu’Héraclite veut bien nous la
présenter, celle-ci est certes sujette au changement, mais il y a de la régularité dans le
changement.
c- remarque : la critique des arguments relativistes ne permet pas cependant de venir à
bout du relativisme, puisqu’on peut toujours supposer qu’il existe d’autres arguments plus
solides, pour justifier le relativisme, même s’ils n’ont pas encore été découverts. D’où la
nécessité de ne pas se contenter de critiquer les arguments qui justifie la thèse, mais de réfuter
la thèse en elle-même.
II- réfutation du relativisme
a- réfutation par l’absurde.
1° définition : la réfutation par l’absurde est une forme de raisonnement bien
connue des mathématiciens et qui répond à la procédure suivante : 1- on suppose vraie la
thèse que l’on veut réfuter 2- on en déduit alors rigoureusement toute une série de
conséquences 3- on montre que la dernière de ces conséquences est en contradiction avec
l’hypothèse initiale, alors même qu’elle en est la déduction nécessaire 4- on en conclut alors
que l’hypothèse de départ est absurde.
2° application : supposons que toutes les opinions sont vraies. Si tel est le cas,
alors l’opinion du contradicteur suivant laquelle « toutes les opinions ne sont pas vraies » est
nécessairement vraie (sans quoi il y aurait contradiction), donc il est vrai que toutes les
opinions ne sont pas vraies, et donc il est faux que toutes les opinions sont vraies. Cette
dernière conséquence est en contradiction avec notre hypothèse de départ, et pourtant, elle en
est la déduction nécessaire. C’est donc que l’hypothèse de départ est absurde.
3° remarque : la limite de cette réfutation par l’absurde tient à ceci qu’elle n’est
pas une réponse pertinente à cette forme restreinte de relativisme qu’est le relativisme moral.
Le relativisme moral n’exclut pas en effet qu’il existe des vérités universelles et nécessaires, il
précise simplement que celles-ci ne concernent que le domaine des sciences « exactes » (les
mathématiques ainsi que les sciences mathématisées de la nature), si bien qu’il peut soutenir
sans contradiction que le bonheur n’est qu’une question d’opinion et la justice une simple
affaire de convention.
b- réfutation par le contre-exemple du relativisme moral.
1°- définition : la réfutation par le contre-exemple est une forme de
raisonnement également bien connue des mathématiciens. Elle répond à la procédure
suivante : 1- on suppose vraie la thèse que l’on veut réfuter. 2- on en déduit alors
rigoureusement une conséquence sous la forme d’une règle qui devrait pouvoir se vérifier
dans tous les cas. 3- or on montre qu’il existe au moins un cas particulier (le contre-exemple)
pour lequel la règle ne se vérifie pas. 4- on en conclut alors que l’hypothèse de départ est
fausse.
2°- application : supposons que toutes les représentations qu’un individu puisse
se faire du bonheur soient vraies. Si tel est le cas, alors tout individu qui règle son

comportement sur ses représentations du bonheur devrait être heureux, pour autant que les
circonstances lui soient favorables et qu’il puisse faire effectivement ce qu’il a envie de faire.
Autrement dit, si toutes les représentations du bonheur sont vraies, la seule forme
d’insatisfaction que devrait connaître un individu qui règle son comportement sur ses
représentations et parvient à faire effectivement ce qu’il a envie de faire est la frustration. Or
précisément, la frustration n’est pas la seule forme d’insatisfaction qu’un individu qui règle
son comportement sur ses désirs puisse connaître. Il y a aussi, il y a surtout l’ennui, c’est-à-
dire cette forme troublante d’insatisfaction qui se manifeste paradoxalement là ou l’on s’y
attend le moins, c’est-à-dire là ou nous avons fait ce que nous avions envie de faire sans pour
autant avoir obtenu la satisfaction imaginée. Par conséquent, l’expérience de l’ennui est le
contre exemple qui permet de réfuter la thèse suivant laquelle le bonheur n’est qu’une simple
question d’opinion.
Conclusion
La critique et surtout la réfutation des incohérences théoriques du relativisme
permettent de conclure qu’il existe nécessairement des vérités universelles et que celles-ci ne
concernent pas simplement le domaine des sciences « exactes ». Reste à déterminer en quoi
consistent ces vérités fondamentales, grâce auxquelles l’existence humaine a un sens, tout
particulièrement dans les domaines de la morale et de la politique.
1
/
4
100%