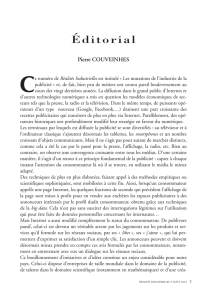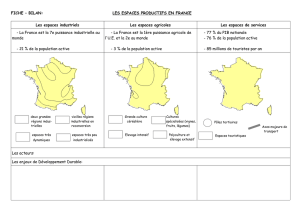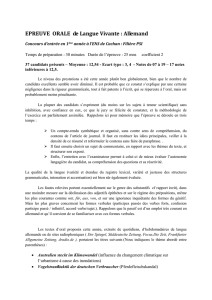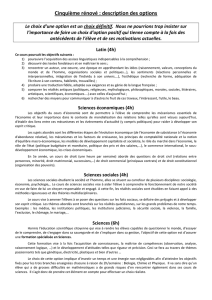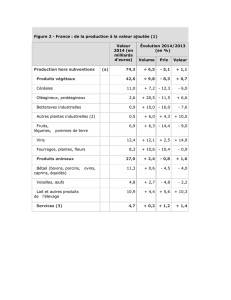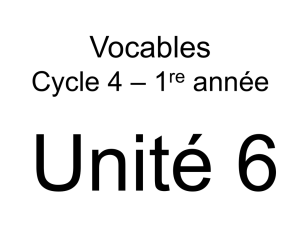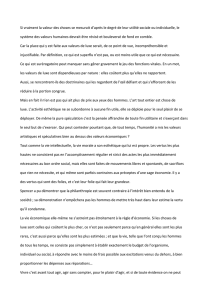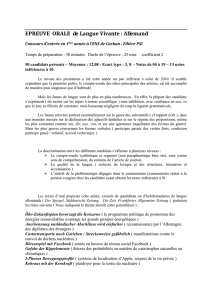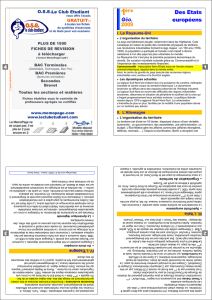R É A L I T É S - Les Annales des Mines

RÉALITÉS
INDUSTRIELLES
MAI 2010 • PRIX : 23 €
ANNALES DES MINES Des nanotechnologies à la biologie de synthèse MAI 2010
UNE SÉRIE DES
ANNALES
DES
MINES
FONDÉES EN 1794
Après la crise
financière :
un retour à
l’économie
réelle ?
ISSN 1148.7941
ISBN 978-2-7472-1682-1
Publiées avec le soutien
du ministère de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi
couverture 26/04/10 12:56 Page 1

1
RÉALITÉS INDUSTRIELLES • MAI 2010
Éditorial
Pierre Couveinhes
Près de deux ans après le krach de l’automne 2008, point d’orgue de ce qu’il est aujour-
d’hui convenu de nommer « la crise financière », les Annales des Mines consacrent à
celle-ci ce numéro de Réalités industrielles.
Il ne s’agit pas seulement d’en analyser les causes et le mécanisme, mais, surtout, de tirer les
conséquences de ce qu’elle a révélé, car, pour reprendre la formule du financier américain
Warren Buffett, « C’est à marée descendante que l’on découvre qui nageait sans maillot de
bain ».
S’agissant des origines de la crise, il semble bien que le péché originel ait été la suppression
des barrières interdisant aux banques commerciales d’accéder aux marchés financiers (qui
s’est traduite, aux Etats-Unis, par l’abrogation du Glass Steagall Act). Cette évolution a auto-
risé de facto les banques généralistes à spéculer avec les dépôts de leurs clients. L’appât du
gain a suscité une croissance exponentielle du nombre de transactions (payées à la com-
mission), qui a été facilitée par l’essor des technologies de l’information et de la communi-
cation, ainsi que par l’oubli des règles prudentielles les plus élémentaires, trop souvent argu-
menté par des théories mathématiques dévoyées.
Il en a résulté un gigantesque jeu de mistigri (ce jeu où les cartes circulent entre les joueurs
jusqu’à ce que l’un d’entre eux, le perdant, se retrouve avec le seul valet de pique, le « mis-
tigri », dont tous les joueurs cherchent à se débarrasser). Ceux qui participaient à ce jeu pla-
nétaire ne pouvaient se résoudre à s’en retirer, car chaque partie rapportait gros. Chacun
espérait être à même de passer, à temps, à un autre joueur un mistigri de plus en plus
pesant… Mais l’inévitable s’est produit : très vite, les épargnants ont découvert avec stupeur
que leurs banques avaient joué au casino avec leurs économies…
Qui a payé le mistigri, en définitive ? Certainement pas les banques, « too big to fail », mais,
pour l’essentiel, les Etats ! Dans une atmosphère de fin du monde, maints pays occidentaux
se sont alors rendu compte du fait qu’ils étaient nus et que, depuis des années, ils vivaient
à crédit, au-dessus de leurs moyens. Pendant que leurs élites (appelons-les ainsi) s’ingé-
niaient à faire tourner les mistigris tout en encaissant de somptueux bonus, leurs usines
avaient été délocalisées, leurs parts de marché s’étaient érodées et leur supériorité technolo-
gique avait disparu dans nombre de domaines-clés…, tandis que d’autres pays avaient
acquis des positions industrielles et commerciales de premier ordre : la Chine (bien sûr),
l’Inde, le Brésil, les Dragons d’Asie, mais aussi… l’Allemagne.
Et la France, dans tout cela ? Elle a bien mieux résisté à la crise financière que beaucoup ne
l’auraient pensé. Comme en d’autres périodes de son histoire, sa force semble avoir résidé
dans un solide ancrage territorial, auquel sont associées des sources de richesse que les sta-
001-002 edito 26/04/10 13:23 Page 1

tistiques ignorent dans une large mesure. Et si c’était précisément là que réside le meilleur
atout de notre pays dans la compétition internationale ?
Bien sûr, il ne s’agit en aucun cas de renoncer au progrès technique ou à l’économie de mar-
ché, ni de se replier frileusement sur un passé regretté, ni encore de différer une fois de plus
des réformes qui avaient été jugées indispensables bien avant la crise financière, mais de
mettre systématiquement en œuvre une « stratégie du luxe ».
Le luxe est un secteur où des entreprises françaises connaissent des succès remarquables à
l’échelle mondiale. Ainsi que le souligne dans son article Vincent Bastien, les stratégies
menées par les meilleures entreprises de ce secteur sont fondées sur des principes très sem-
blables à ceux qui président au développement durable : traçabilité (ce qui implique la sta-
bilité de la localisation de la production), intrication étroite entre produits et services, ceux-
ci étant apportés par des personnes connues, reconnues et qualifiées… Il y a certainement
là une voie de réflexion pour l’avenir, qui devra être explorée et exploitée.
2
RÉALITÉS INDUSTRIELLES • MAI 2010
001-002 edito 26/04/10 13:23 Page 2

Sommaire
APRÈS LA CRISE FINANCIÈRE : UN RETOUR
À L’ÉCONOMIE RÉELLE ?
1Éditorial
Pierre Couveinhes
5Avant-propos
Christian Stoffaës et Xavier Dalloz
I. Un diagnostic pour dépasser la crise
7Les causes véritables du chômage
Maurice Allais
9Retour aux fondamentaux
Marcel Boiteux
11 Pour des ingénieurs socio-économistes
Claude Martinand
13 Envie d’aventures
Francis Mer
II. Paroles d’économistes
15 Manifeste pour l’économie réelle. Les économistes ont-ils une responsabilité
dans la crise ?
Christian Stoffaës
30 Pour en finir avec l'hégémonie du lien économique
Michel Berry
III. Paroles d’entrepreneurs
38 La crise ! Quelle crise, ou plutôt : quelles crises ?
André Lamotte
MAI 2010 - 23,00 ISSN 1148-7941
RÉALITÉS
INDUSTRIELLES
UNE SÉRIE DES
ANNALES
DES
MINES
FONDÉES EN 1794
Rédaction
120, rue de Bercy - Télédoc 797
75572 Paris Cedex 12
Tél. : 01 53 18 52 68
Fax : 01 53 18 52 72
http://www.annales.org
Pierre Couveinhes, rédacteur en chef
Gérard Comby, secrétaire général de la série
«Réalités Industrielles »
Martine Huet, assistante de la rédaction
Marcel Charbonnier, lecteur
Comité de rédaction de la série
« Réalités industrielles » :
Michel Matheu, président,
Pierre Amouyel,
Grégoire Postel-Vinay,
Claude Trink,
Bruno Sauvalle
Jean-Pierre Dardayrol
Pierre Couveinhes
Maquette conçue par
Tribord Amure
Iconographe
Christine de Coninck - CLAM !
Fabrication : AGPA Editions
4, rue Camélinat
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 43 26 70
Fax : 04 77 41 85 04
e-mail : [email protected]
Abonnements et ventes
Editions ESKA
12, rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 73
Fax : 01 42 60 45 35
Directeur de la publication :
Serge Kebabtchieff
Editions ESKA SA
au capital de 40 000
Immatriculée au RC Paris
325 600 751 000 26
Un bulletin d’abonnement est encarté
à la fin de ce numéro.
Vente au numéro par correspondance
et disponible dans les librairies suivantes :
Presses Universitaires de France - PARIS ;
Guillaume - ROUEN ; Petit - LIMOGES ;
Marque-page - LE CREUSOT ;
Privat, Rive-gauche - PERPIGNAN ;
Transparence Ginestet - ALBI ;
Forum - RENNES ;
Mollat, Italique - BORDEAUX.
Publicité
J.-C. Michalon
directeur de la publicité
Espace Conseil et Communication
2, rue Pierre de Ronsard
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 33 93 57
Fax : 01 30 33 93 58
Table des annonceurs
Annales des Mines : 2e- 3eet 4ede couverture
Illustration de couverture :
Chute de la Bourse de Shanghai, juin 2008.
Retransmission des cours à Changchun,
province de Jilin.
Photo © Featurechina/ROPI-REA
003-004 som 27/04/10 13:09 Page 3

44 L’investissement de l’Etat dans les hautes technologies : une approche
keynésienne
Daniel Pichoud
51 Revenir à la dissociation historique des métiers financiers
Pierre-Henri Leroy
58 La stratégie du luxe : un point fort pour la France / une stratégie d’entreprise
pour le monde qui advient
Vincent Bastien
68 La crise, catalyseur du rétablissement de la primauté de l’économie réelle sur
l’économie virtuelle
Franck Biancheri
IV. Paroles de scientifiques
74 Crises et métrologie. A quoi sert la prospective ?
Thierry Gaudin
84 Reconstruire la compétitivité de la France et de l’Europe
André-Yves Portnoff et Xavier Dalloz
V. Paroles d’ingénieurs
93 L’économie numérique, un défi systémique
Jean-Pierre Corniou
101 Le rôle des Business Angels dans le financement de la croissance des PME
innovantes
Interview d’Eric Berthaud par Bernard Neumeister
105 La culture, une des clés du développement durable
Hervé Digne
109 Après la crise financière : un retour vers l’économie réelle ? ou : la France
dans l’économie mondialisée
Grégoire Postel-Vinay
117 Résumés étrangers
Ce numéro a été coordonné par Christian Stoffaës et Xavier Dalloz
003-004 som 27/04/10 13:09 Page 4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
1
/
125
100%