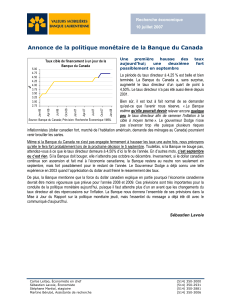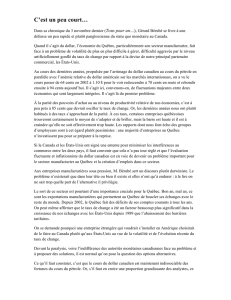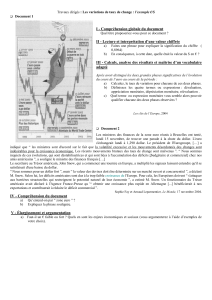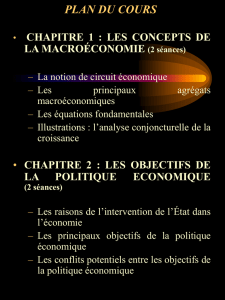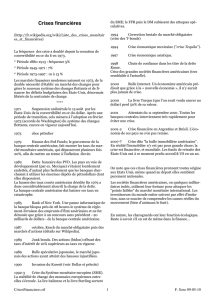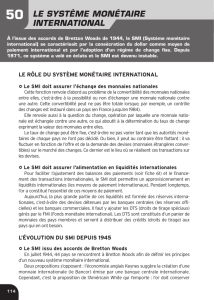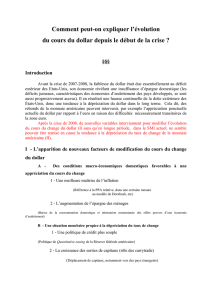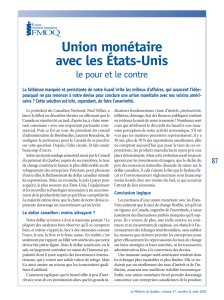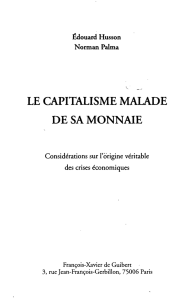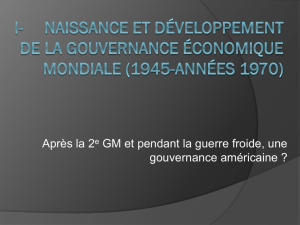LES VERTIGES DE LA FINANCE INTERNATIONALE

LES VERTIGES DE LA FINANCE INTERNATIONALE
Henri BOURGUINAT
Dans la longue introduction de son ouvrage (Economica, 1987, 296 p.), l'auteur rappelle les
principaux déséquilibres de l'économie mondiale : le chômage, la saturation des marchés,
l'internationalisation qui rétrécit la marge d'autonomie des États-Nations, le développement
des activités financières et la baisse de la profitabilité dans l'économie réelle. Une « révolution
financière » naît de la combinaison synergique de la mondialisation, des innovations
financières et de la déspécialisation bancaire ; elle déstabilise les taux de change. Les États-
Unis en sont les principaux bénéficiaires et leur responsabilité est engagée dans la
dégénérescence du Système monétaire international. Un autre déséquilibre est représenté par
les flux de capitaux issus du tiers monde au profit du Nord. Une réforme du SMI est donc
indispensable. L'ensemble de l'ouvrage approfondit l'analyse de ces déséquilibres.
1. LE DOLLAR EXERCE UN POUVOIR HÉGÉMONIQUE
A - LE DOLLAR DISPOSE DES ATTRIBUTS D'UNE MONNAIE INTERNATIONALE MAIS IL EN
EXERCE MAL TOUTES LES FONCTIONS
• Le dollar de 1944 est « le soleil autour duquel s'organisent les autre monnaies
satellites. » Une monnaie nationale est une bonne monnaie internationale à condition
d'associer les qualités d'« acceptabilité-liquidité », définies par l'aptitude à s'imposer
dans les échanges en dehors du pays émetteur et à satisfaire les besoins en monnaie de
l'économie mondiale, aux qualités de «stabilité-prédictibilité » des taux de change afin
d'inspirer confiance. En plus des fonctions traditionnelles (étalon de valeur, instrument
de transaction et de réserve), l'auteur lui accorde un rôle essentiel dans le « bouclage
du circuit international », ce qui attribue au pays émetteur une lourde responsabilité
dans la fonction d'intermédiation. Le dollar exerce ces fonctions après 1944 mais
bientôt sa position se dégrade et avec lui le système monétaire international de Bretton
Woods.
• Le dollar n'exerce plus les fonctions d'une bonne monnaie internationale depuis
les années soixante-dix. Il n'est plus un « étalon monétaire intangible » puisque son
cours, très bas à la fin des années soixante-dix (3,85 francs ou 1,74 DM) s'est
fortement apprécié jusqu'en 1985 (10,65 francs ou 3,45 DM) avant d'amorcer un net
repli. Sa fonction d'instrument de réserve lui est disputée par le DM, par le yen ou par
le franc suisse. Enfin, et c'est plus grave, les flux de capitaux entrant aux Etats-Unis
excèdent le flux des sorties. « Le pays émetteur de la monnaie véhiculaire ponctionne
le marché international au lieu de l'alimenter. »
Le dollar reste la monnaie internationale mais les États-Unis n'exercent plus leur
fonction de « prêteur en dernier ressort ». Ils n'assument plus les responsabilités liées
à leur suprématie économique. Bretton Woods a laissé la place à un « nonsystème ».
B - LA GESTION DES FLUCTUATIONS DU DOLLAR ECHAPPE PARTIELLEMENT AUX ETATS-UNIS
• L'appréciation du dollar n'est pas due à la consolidation des «
fondamentaux » aux États-Unis. L'auteur réfute l'explication du secrétaire au
Trésor de l'époque suivant laquelle « la force persistante du dollar reflète une
amélioration fondamentale de la politique économique américaine avec des
performances et des perspectives qu'on ne trouve nulle part ailleurs ». Cette
analyse ne tient pas compte du déficit commercial croissant des États-Unis.
L'auteur rejette également l'explication de la hausse du dollar par la hausse des
taux d'intérêt car ces derniers ont manifesté une forte tendance à converger
partout dans le monde après 1983. Enfin, il relativise l'influence de la confiance

inspirée par les États-Unis, présentés comme un « havre de sécurité » lors de la
crise mondiale de l'économie d'endettement qui s'estompe vers 1983.
• L'appréciation du dollar est due aux besoins du Trésor américain et à la
spéculation. Le déficit budgétaire est lié à la faiblesse insigne de l'épargne
intérieure et à la réduction de la pression fiscale de l'administration républicaine.
Il s'ensuit une entrée massive des capitaux aux États-Unis qui provoque
mécaniquement un renforcement du dollar. De plus, une « bulle spéculative » se
développe à cause des comportements moutonniers des spéculateurs, conformes
aux observations de J.M. Keynes. Comme ils anticipent tous une hausse du
dollar, ils adoptent tous la même position sur le marché et leurs anticipations
deviennent autoréalisatrices. Les « fondamentaux » (écarts des taux d'intérêt,
équilibre budgétaire, solde des comptes courants, endettement extérieur...) ne
justifient pas plus l'envol du dollar que son atterrissage en douceur.
• L'« atterrissage en catastrophe » du dollar surévalué ne s'est pas produit. En effet,
la conférence des Cinq (le « G5 ») à l'hôtel Plaza, à New York, en septembre
1985, montre la détermination des pays les plus puissants à s'opposer aux forces
du marché. Les spéculateurs sont impressionnés. Cette concertation
internationale est à l'origine de l'« atterrissage en douceur » du dollar qui se
déprécie de 40 à 60 % par rapport aux autres grandes monnaies entre 1985 et
1986. Les affirmations solennelles des autorités monétaires ont été également
autoréalisatrices. L'auteur souhaite à l'avenir un renforcement du dialogue
international afin que les États-Unis ne soient pas tentés, à l'avenir comme dans
les années trente, par « les facilités des dévaluations compétitives du dollar ». Il
déplore que tous les pays doivent s'aligner sur la politique monétaire restrictive
des États-Unis car la désinflation compétitive fait courir le risque de la déflation
dans toute l'économie occidentale.
2. LES DÉSÉQUILIBRES DE LA FINANCE INTERNATIONALE APPELLENT UN
APUREMENT DE LA DETTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET UNE
RÉFORME DU SMI
A - À L'ENDETTEMENT DES PVD S'AJOUTE L'ENDETTEMENT PARADOXAL DE L'ECONOMIE
DOMINANTE
• Le Nord doit restructurer ou annuler la dette du Sud. La dette des PVD
avoisine 1 000 milliards de dollars (en 1986). Les emprunteurs ont été
imprudents mais de leur côté, les banques commerciales se sont engagées comme
si « la probabilité de choc majeur susceptible d'affecter leur portefeuille
international était de zéro ». Cet endettement à taux variable est brutalement
alourdi par la hausse des taux d'intérêt, à partir de 1979, et par le contre-choc
pétrolier de 1985-1986 qui pénalise les exportateurs de pétrole. L'endettement
s'inscrit dans un cercle sans fin. Les créanciers sont amenés à consentir de
nouveaux prêts car « interrompre l'alimentation en crédits revient pour les
prêteurs à condamner l'économie que l'on a financé et à se priver de la seule
chance de récupérer sa mise »
À la suite des politiques drastiques imposées par le FMI, le remboursement de la
dette et la fuite des capitaux désertant les PVD représentent un flux financier
positif en faveur du Nord. Les plus riches sont financés par les plus pauvres.
Pour résorber ce déséquilibre, le Nord a intérêt à restructurer la dette, voire à
l'annuler au profit des pays les plus pauvres de la planète. Il créera ainsi des
débouchés pour sa propre production, comme les Etats-Unis avec le plan
Marshall.

• L'endettement des États-Unis est déstabilisant. Leur endettement équivaut à la
dette cumulée du Mexique et du Brésil, les deux PVD les plus endettés de la
planète. Cette situation a été facilitée par la déréglementation et par le
décloisonnement des marchés financiers, par la déspécialisation des
intermédiaires et par les progrès des technologies informatiques.
La logique irrationnelle de la création de nouveaux produits financiers dus « à
l'imagination débordante de nouveaux alchimistes de la finance aux techniques
de plus en plus sophistiquées » pousse à l'endettement malsain de la première
économie mondiale. Cette dernière bénéficie du privilège « seigneurial »
d'emprunter dans sa propre monnaie. Si elle la laisse se déprécier, la charge de la
dette se réduit d'autant. Le pays le plus riche du monde n'exerce plus la fonction
de « prêteur en dernier ressort » : il reçoit plus de capitaux qu'il n'en fournit à
ses partenaires. Ce paradoxe impose une réforme du SMI.
B - LA REFORME DU SMI EST IMPERATIVE MAIS DOIT ETRE PROGRESSIVE
• Le monopole monétaire des États-Unis n'est plus justifié. Une réforme
graduelle du SMI devrait permettre de cumuler l'avantage de la souplesse des
changes flottants et celui de la fiabilité des parités fixes. Cette réforme devrait
tenir compte que le monopole monétaire des Etats-Unis se délite au profit d'un
oligopole monétaire exercé avec les autres grandes monnaies. Dans une
économie multipolaire, « le dollar ne serait pas détrôné mais son rôle aura à être
progressivement ajusté, compte-tenu de la montée d'autres centres de pouvoir
économique ».
À la suite de J. Willamson et de R. McKinnon, l'auteur préconise un SMI qui
permette l'instauration d'un « taux de change d'équilibre réel susceptible de
maintenir l'activité économique au plus haut niveau possible » à l'intérieur de «
zones cibles ». Dans ces zones de référence, les parités monétaires évolueraient
avec souplesse dans les limites d'un « champ balisé » par le autorités monétaires
des pays participants. Il importe que les projets de réforme du SMI « passent
tous par un niveau de coopération internationale renouvelée et approfondie que
l'affaiblissement des variables de contrôle [des marchés] appelle impérieusement
».
• L'expérience de l'Europe peut être mise à _profit. Les participants de la
conférence de Séoul d'octobre 1985 ont envisagé de «faire un SME à l'échelle
mondiale ». L'auteur y est favorable car, dans une large mesure, l'îlot de stabilité
créé par le SME de 1979 répond à la définition d'une « zone cible » définie par J.
Willamson.
Il est en effet admis que le bilan du SME est positif en ce qui concerne la
convergence des taux d'intérêt et des taux de change ainsi que dans la lutte
contre l'inflation. Le « SME a exercé une fonction de rassemblement en tirant les
pays les moins vertueux vers un palier inférieur de hausse des prix ». A
contrario, le SME n'a pas nettement contribué à soutenir la croissance sur le
Vieux Continent ni à réduire les déséquilibres commerciaux entre les États-
membres.
Un des objectifs des promoteurs du SME de 1979 était de renforcer le processus
d'intégration régionale par la monnaie unique. L'avenir leur a donné raison car
l'Écu est de plus en plus utilisé comme instrument de facturation et d'émission
d'obligations internationales. Si « la monnaie européenne est seulement en train de se
faire », l'Écu sera « une monnaie européenne véritable », un des piliers d'un système
monétaire tripolaire (« dollar-yen-Écu »), dès qu'une banque centrale européenne
sera créée.

En conclusion de l'ouvrage, l'auteur insiste sur l'urgence de réformer le SMI car « la
reprise en main d'une économie mondiale de plus en plus à découvert passe sans
qu'on puisse en douter par une maîtrise retrouvée des taux de change ».
Henri Bourguinat réalise une synthèse magistrale de plus de cent vingt études
économiques consacrées à la dégradation du système financier international pendant une
époque clé de l'histoire de ce dernier demi-siècle. Le style de l'ouvrage est dense, la lecture
parfois tendue, tant le discours est riche en concepts et les références nombreuses. Mais la
récompense est grande pour le lecteur désireux de comprendre les mécanismes de la finance
internationale. Même si toutes les inquiétudes de l'auteur n'ont pas été confirmées par la suite,
les lignes de force de l'histoire monétaire des années postérieures ont été clairement perçues
dès 1987. Les grilles d'analyse ont prouvé leur pertinence, notamment en ce qui concerne la
nécessité d'une monnaie européenne et les craintes exprimées sur l'évolution erratique des
marchés financiers irrationnels (du krach de 1987 au krach de 1997).
SOURCE : 100 fiches de lectures, sous la dir. de M Montoussé, Bréal, 1998
1
/
4
100%