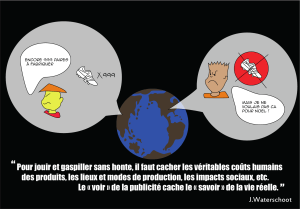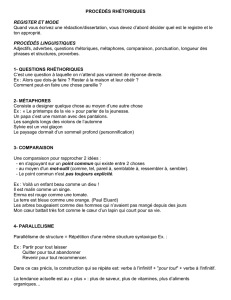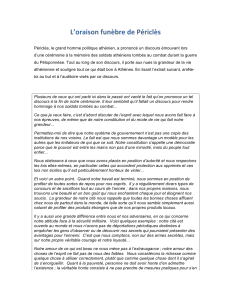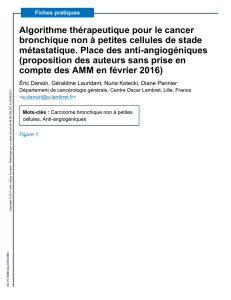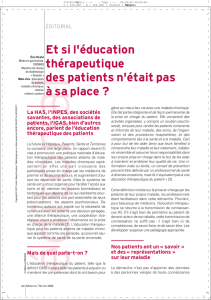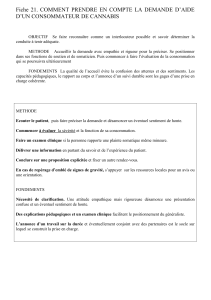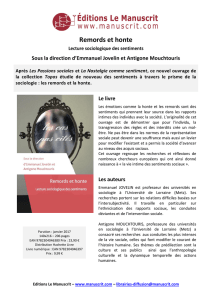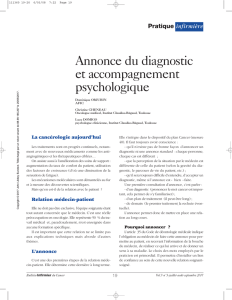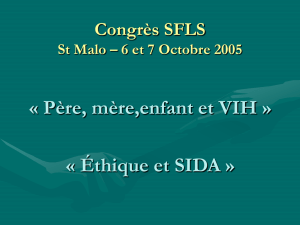l`accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DU SUJET MIGRANT
ALCOOLIQUE : COMMENT TRAITER ENCORE ET ENCORE LA
QUESTION DE LA HONTE ?
Laurent Valot
John Libbey Eurotext | « L'information psychiatrique »
2017/3 Volume 93 | pages 209 à 216
ISSN 0020-0204
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-3-page-209.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laurent Valot, « L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique :
comment traiter encore et encore la question de la honte ? », L'information
psychiatrique 2017/3 (Volume 93), p. 209-216.
DOI 10.1684/ipe.2017.1612
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour John Libbey Eurotext.
© John Libbey Eurotext. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm
Psychiatrie au futur
L’Information psychiatrique 2017 ; 93 (3) : 209-16
L’accompagnement psychologique
du sujet migrant alcoolique :
comment traiter encore
et encore la question de la honte ?
Laurent Valot
Centre d’alcoologie et unité d’hospitalisation
complète Sesame (Centre hospitalier Pinel),
464, rue Saint-Fuscien, Amiens, 80000
Centre de recherche en psychologie
(EA 7223), Université Picardie Jules Verne,
Chemin du Thil, 80025 Amiens
Résumé.À partir d’une revue non exhaustive de la littérature, et en nous appuyant sur
notre expérience clinique, notre réflexion porte sur l’abord de la honte chez les patients
migrants alcooliques, vus en cure de sevrage et après. Le développement de notre
communication se compose de quatre parties. Nous présentons tout d’abord de brèves
considérations psychopathologiques sur les problèmes d’alcoolisation chez les sujets
immigrés en France. Nous retrac¸ons ensuite les caractéristiques de la honte et celles
de la relation entre l’alcoolisme et la honte. Dans un troisième temps, nous exposons
quelques données sur l’accueil des sujets migrants dans le service d’alcoologie dans
lequel nous travaillons. Enfin, à partir d’exemples cliniques, nous avanc¸ons quelques
réflexions sur la honte et sur l’intérêt de reconnaître cet affect lors de l’accompagnement
psychologique.
Mots clés : migrant, alcool dépendant, alcoolisme, accompagnement, honte, entretien,
cas clinique
Abstract. Psychological monitoring of the alcoholic migrant: how to deal again and
again with the question of shame ?. From a non-exhaustive review of the literature
and based on clinical experience our analysis focuses on the scope of shame among
alcoholic migrant patients during and after withdrawal treatment. The development of
our communication consists of four parts. We first discuss about short psychopatholo-
gical considerations that refer to alcohol problems among the immigrant population in
France. We describe the characteristics of shame and its link with alcoholism. In a third
part we present some information about the way migrants are welcome in our alcoholic
care department. Finally, we put forward some thoughts about shame based on clini-
cal examples as well as the importance to acknowledge its impact during psychological
support.
Key words: migrant, alcohol, alcoholism, monitoring, shame, interview, clinical case
Resumen. El acompa ˜
namiento psicológico del sujeto migrante alcohólico: ¿cómo
tratar una vez más la cuestión de la vergüenza ?. Partiendo de un repaso no exhaustivo
de la literatura, y apoyándonos en nuestra experiencia clínica, nuestra reflexión se centra
en el enfoque de la vergüenza en los pacientes migrantes alcohólicos, atendidos durante
un período de desadicción y después. El desarrollo de nuestra comunicación consta de
cuatro partes. Presentamos de entrada unas rápidas consideraciones psicopatológicas
sobre los problemas de alcoholización entre los sujetos inmigrados en Francia. Recor-
damos luego las características de la vergüenza y las de la relación entre alcoholismo y
vergüenza. Como tercer punto, exponemos algunos datos sobre la acogida de los suje-
tos migrantes en el servicio de alcohología en el cual trabajamos. Por fin, partiendo de
ejemplos clínicos, adelantamos algunas consideraciones sobre la vergüenza y sobre el
interés que supone reconocer este afecto durante el acompa ˜
namiento psicológico.
Palabras claves: migrante, alcoholodependiente, alcoholismo, acompa˜
namiento,
vergüenza, entrevista, caso clínico
Introduction
Notre article1met l’accent sur la honte chez les patients
migrants2alcooliques, vus en cure de sevrage et après.
S’exprimer sur cette thématique nécessiterait comme préa-
1Cet article a fait l’objet d’une communication dans l’atelier intitulé «Psychiatrie et politique/ Psychiatrie
et société »aux 35es Journées de la Société de l’Information Psychiatrique, le vendredi 30 septembre 2016,
à Bruxelles.
2Le migrant correspond ici à une personne étrangère qui a quitté son pays pour des raisons diverses
(par exemple, économiques ou politiques).
lable d’exposer les diverses informations permettant de
comprendre la situation de migrant dans son ensemble :
point de vue culturel, social et psychologique. Il n’est
pas dans notre intention de reprendre ces données à tra-
vers cet écrit. Dans notre article, nous présentons tout
doi:10.1684/ipe.2017.1612
Correspondance : L. Valot
<l.valot@ch-pinel.fr >
209
Pour citer cet article : Valot L. L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique : comment traiter encore et encore la question de la honte?
L’Information psychiatrique 2017 ; 93 (3) : 209-16 doi:10.1684/ipe.2017.1612
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm
L. Valot
d’abord de brèves considérations cliniques sur les pro-
blèmes d’alcoolisation chez les sujets immigrés en France.
Dans un deuxième temps, nous exposons les caractéris-
tiques de la honte et ses liens avec l’alcoolisme. Nous
exposons ensuite quelques données sur le nombre de
patients migrants admis dans l’unité d’alcoologie Sesame.
Enfin, à partir d’exemples cliniques, nous avanc¸ons quelques
éléments de compréhension sur la place de la honte chez
ces sujets, et l’intérêt d’un travail d’expression et de recon-
naissance de cet affect.
Brèves considérations
psychopathologiques sur les problèmes
d’alcoolisation chez les sujets
immigrés en France
Les immigrés résidants en France présentent parfois des
troubles psychiques [1-6]. Leur souffrance diffuse recouvre
des plaintes persistantes et invalidantes centrées sur le
corps (fatigue, insomnie, maux de dos, de tête...) [6-8]
en lien à des complications anxio-dépressives [5, 6], des
syndromes psychotraumatiques [8-10], des troubles psycho-
tiques [11-13] et des conduites addictives [4, 9, 14, 15].
Les facteurs qui conduisent à ces troubles sont en majorité
des facteurs environnementaux peu étayants (conditions de
départ et d’accueil, discriminations, isolement social, éloi-
gnement des modèles culturels, problèmes de logement,
de travail, situations de précarité...) et des facteurs psycho-
pathologiques (angoisse de perte, épreuve de la solitude,
nostalgie du pays d’origine, vulnérabilité psychique...).
Dans le champ des addictions, l’alcoolisme de l’immigré
résidant en France est un phénomène indiscutable [6],
mais peu documenté [15]. Cette conduite varie selon les
ethnies [6, 16]. Pour les sujets originaires du Maghreb,
l’alcoolisation est un comportement acquis au cours du
séjour en France [1, 4, 6], de manière plus ou moins précoce.
La durée de séjour et le déracinement sont des facteurs
de risques majeurs d’alcoolisation chronique. Pour les Afri-
cains, la rupture avec les traditions du pays d’origine est
source de tensions, d’un vécu dépressif lié au déracine-
ment et d’alcoolisme chronique [6]. Parmi les Européens,
les immigrés italiens, polonais, espagnols ou portugais ren-
contrent en France une société proche de leurs modèles
socioculturels [17]. L’alcoolisation tient une place dans leur
vie quotidienne (repas) et lors des célébrations festives.
Dans la communauté des Polonais, la présence de perturba-
tions alcooliques, dont des psychoses alcooliques [18] chez
les hommes, est plus souvent retrouvée.
En s’alcoolisant, le sujet migrant tente d’oublier ses diffi-
cultés en tout genre : les situations traumatisantes, la perte
d’appartenance à une communauté et l’éloignement des
siens deviennent plus supportables. L’alcoolisme paroxys-
tique et l’alcoolisation continue sont les pratiques addictives
les plus répandues. La première conduite se retrouve chez
les sujets étrangers récemment arrivés et isolés ; témoin
d’un échec socioprofessionnel ou de difficultés d’adaptation.
Cette addiction entraîne des dommages sociaux [15].
L’alcoolisation chronique concerne les personnes immi-
grées installées en France depuis plus de dix ans. Elle
relève d’un entraînement, surtout dans le milieu profession-
nel, avec une consommation sur les lieux de travail. Elle
relève également d’un processus de socialisation, témoin
d’une insertion progressive et critère de sociabilité dans une
société franc¸aise où l’alcool est valorisé : au café, chez les
amis. Cette alcoolisation, avec sa face conviviale franc¸aise
[17, 19], entraîne des perturbations somatiques et des dom-
mages familiaux et sociaux [9]. Dans les deux cas, l’addiction
chez ces personnes s’accompagne de découragement, de
culpabilité, de honte [17] et de rejet de l’entourage. En outre,
elles ont des difficultés à accéder aux soins.
La honte et ses liens avec l’alcoolisme
Sur le plan psychopathologique [20-26], la honte est défi-
nie comme le sentiment négatif et douloureux de se croire
une personne indigne, manquant de valeur et préoccupée
par la crainte d’être perc¸ue comme telle. La honte a trait à
l’image de soi, donc au narcissisme et surgit dans la rela-
tion : le sujet est honteux en présence d’autrui. Cet affect
frontière entre le narcissique et l’objectal se manifeste par
de la gêne, du malaise, en fonction du regard de l’autre, de
son jugement. Il est associé à des émotions connexes telles
que l’angoisse, la colère, l’humiliation, la peur et la tristesse.
Il se présente avec des manifestations physiologiques (par
exemple, le rougissement) et des comportements typiques
d’évitement, de retrait, reconnus dans la plupart des cultu-
res. La honte, difficile à vivre, engendre un sentiment
d’infériorité et des affects dépressifs. Elle sidère le sujet ;
elle tend à inhiber toute élaboration psychique et entrave ses
moyens de vivre en société. Elle bloque la communication,
elle isole, elle enferme, elle impose de se cacher [20, 25, 27]
de disparaître ou de mourir [20, 21, 23, 25].
La honte se différencie de la culpabilité. Elle est plus
douloureuse et problématique que la culpabilité. La honte
répond à une défaillance vis-à-vis des valeurs idéales et,
au niveau inconscient, renvoie à l’idéal du moi groupal. La
culpabilité correspond à une transgression des interdits et,
au niveau inconscient, se réfère à l’instance du surmoi.
La honte est parfois difficile à reconnaître parce que le
sujet se la cache à lui-même et aux autres, à son entourage, à
sa communauté. Chez le sujet étranger, elle peut faire partie
des «sentiments congelés »en lien à l’impact du trauma de
la migration [28].
Pour Tisseron [25], la honte est une forme de «dés-
intégration ». Le risque principal est de perdre toute qualité
d’être humain, de se sentir réduit à n’être pas grand-chose,
voire détruit. La honte peut s’exprimer dans des manifesta-
tions psychopathologiques variées : pathologies physiques
et psychiques, suicides, toxicomanie, appartenances au
groupe des exclus d’une société, comportements de sou-
mission [29]. Les expériences traumatisantes génèrent la
honte et une dévalorisation narcissique.
210 L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm
L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique : comment traiter la question de la honte ?
En résumé, la honte est le signe d’une blessure narcis-
sique difficilement partageable. Elle est «une atteinte dont
la personne ne peut se relever seul »[30]. Sur le plan psy-
chothérapique, l’abord de cet affect est difficile, car il est
extrêmement ubiquitaire, contagieux, mobile [26]. Nommer
la honte est ce qui permet de la circonscrire, de commencer
à la dépasser et à reconstruire sa personnalité sur d’autres
bases. La nomination permet au patient de se confronter à
ce qui provoque la honte en soi, et de s’en dégager progres-
sivement. La mise en mots de cet affect peut être comparée
à«un apprivoisement de la honte »[24]. Et elle constitue un
point d’appui essentiel dans l’affirmation et la reconstruction
de l’identité du patient.
Pour ce qui concerne l’alcoolisme, de nombreux travaux
internationaux ont étudié le lien entre le sentiment de honte,
celui de la culpabilité, et l’abus d’alcool. Tangney [22, 31],
Dearing et al. [32], et Stuewig et al. [33] estiment que les
sentiments de honte éprouvés dans l’enfance constituent
un facteur de vulnérabilité dans le développement ultérieur
de la dépression, des troubles anxieux, de la prise d’alcool
et d’abus de drogues. À partir d’une étude réalisée auprès
d’étudiants inscrits à l’université et de sujets présentant des
problèmes judiciaires, Dearing et al. [32] se sont intéressées
à la corrélation entre la culpabilité, la honte et le mésusage
d’alcool et de drogues. Ils ont établi l’existence d’un lien
positif entre les éprouvés de honte durant l’enfance et une
consommation problématique de toxiques (alcool, drogues)
au début de l’âge adulte. La population étudiée a tendance
à s’adonner aux produits pour faire face à la honte inté-
riorisée passée. Toutefois, les auteurs n’ont pas relevé de
liens significatifs avec la culpabilité. La honte et la culpabi-
lité doivent être considérées séparément dans la prévention
et le traitement de l’alcoolisme. Dans une étude différente,
Stuewig et al. [33] considèrent que la baisse de l’estime de
soi, avec sa part de honte intériorisée, chez l’adolescent,
représente un facteur de risque d’intoxication à l’alcool et de
troubles du comportement, à l’âge adulte. La consommation
d’alcool et de drogues atténue les pensées négatives res-
senties à l’adolescence. D’autres auteurs [34-37] rapportent
que le recours aux toxiques est régulièrement recherché
pour traiter les émotions déplaisantes (la culpabilité et la
honte) présentes dans l’enfance. Ils montrent le lien positif
entre «le pardon »et la honte pour éviter de développer
une alcoolisation pathologique. En conséquence, d’après
Dearing et al. [32] et Wiechelt [36], il importe de prendre
en compte les éprouvés de honte lors des soins proposés
aux patients alcooliques, dans les centres de traitement des
addictions.
Dans les travaux franc¸ais, la problématique de la honte
de boire est évoquée par différents praticiens [17, 38-40].
Maisondieu [38] est l’un des premiers à mettre la honte en
relation avec la question de l’addiction à l’alcool. Il écrit : «au
début de l’alcoolisme, ilyalahonte, ce sentiment pénible de
son infériorité, de son indignité ou de son humiliation devant
autrui, de son abaissement dans l’opinion des autres. Je ne
connais pas un alcoolique chez lequel manque cet affect dou-
loureux ». L’image négative que le patient a de lui-même,
marquée notamment par la honte, renforce sa conduite
addictive. Par ailleurs, l’alcoolisme féminin, décrit par diffé-
rents auteurs [41-43], est caractérisé par sa consommation
solitaire et dissimulée d’alcool, vécue dans la culpabilité et
la honte.
Pour Descombey [17] et Monjauze [39, 40], l’alcoolisme
est une pathologie de la honte et non de la culpabilité.
Selon Monjauze [40], ce qui fait honte, vraisemblablement,
«c’est l’animalité du processus régressif alcoolique et
l’impuissance du sujet à l’endiguer ». La honte de boire
enferme le buveur dans les mensonges et le silence.
En outre, elle dissimule une honte plus profonde d’une
souffrance subjective faite d’angoisse, de culpabilité et de
dévalorisation. Descombey [17] et Monjauze [39, 40] rap-
portent cette honte, très marquée chez certains malades, à
une relation précoce perturbée par l’environnement familial
chaotique. Dans certains cas, cette honte primaire se trouve
réactivée par les sévices subis dans l’enfance. Une enfance
marquée par la sévérité, le mépris ou la violence de son
entourage peut créer la honte d’exister [40]. La honte exige
en tout premier lieu la restauration narcissique du patient.
Nous retenons ici que le recours à l’alcool est recherché
par certains patients pour dissimuler de nombreuses diffi-
cultés, dont «une honte initiale »qu’ils éprouvaient avant
même de boire ce produit. C’est à travers le récit de leur
histoire personnelle et familiale que le psychologue clini-
cien peut entendre cette honte et accompagner le patient
à la dépasser et à reconstruire sa personnalité sur d’autres
bases.
Ces considérations cliniques énoncées, que dire sur la
problématique de honte chez les sujets migrants alcoo-
liques ? Cette problématique ne semble pas avoir été
abordée chez ces sujets. L’objectif de notre communica-
tion n’est pas d’exposer les composantes de la honte chez
ces patients. À l’aide d’exemples cliniques, nous souhaitons
seulement souligner quelques réflexions psychopatholo-
giques sur l’intérêt du travail d’expression et de reconnais-
sance de la honte pour accompagner au mieux ces sujets.
Caractéristiques de la population
migrante hospitalisée au Sesame
À partir des données recueillies par l’intermédiaire du
département d’information et de recherche médicale (DIRM)
du centre hospitalier psychiatrique Ph. Pinel de la ville
d’Amiens, nous présentons ici le nombre de patients
migrants hospitalisés dans l’unité d’alcoologie Sesame, au
cours des trois dernières années. Ils représentent environ
4 % du nombre de patients hospitalisés. Ce sont en majorité
des hommes originaires d’Europe et d’Afrique. L’importance
numérique du sexe masculin semble plus le reflet de la
migration célibataire ou menacée de séparation. Les patients
sont généralement en arrêt de travail. Certains sujets ont
été admis plusieurs fois à l’hôpital psychiatrique, pour
une courte période de sevrage, avant d’arriver au Sesame
(tableau 1).
L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017 211
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm
L. Valot
Tableau 1. Nombre de patients migrants suivis au CHPP en alcoologie selon l’année.
Nombre de patients
hospitalisés au service
d’alcoologie Sesame
Nombre de patients
migrants hospitalisés
au service d’alcoologie
Sesame
Nombre de patients
migrants suivis en
ambulatoire au service
d’alcoologie Sesame
2012 213 10 soit 4,69 % 49
2013 200 8 soit 4 % 37
2014 210 9 soit 4,29 % 39
Dans le détail des données d’hospitalisation des per-
sonnes migrantes au Sesame, les patients ont été
majoritairement adressés par un médecin ou des travailleurs
sociaux. Ils ont pour la plupart de grandes difficultés pour des
raisons complexes, en rapport avec un contexte familial, éco-
nomique et social qui les fragilise. Ces malades déclarent
une ancienneté de leur consommation d’alcool supérieure
à dix ans. Leur alcoolisme concerne une dépendance à la
bière et au vin. L’absorption d’alcools forts est le plus sou-
vent citée par des consommateurs plus jeunes. Les sujets
d’origine étrangère remontent leur début d’alcoolisation
pathologique à la période de l’âge adulte en lien à leur
séjour en France. Les périodes d’abstinence sont de courte
durée, un an, après plusieurs sevrages. Dans le témoignage
des patients, on note la méconnaissance des dangers de
l’alcool, la tendance à s’isoler progressivement et les dif-
ficultés d’accéder aux soins. L’alcoolisation des femmes
immigrées est solitaire et clandestine.
D’un espace de soins à un espace
psychique : exemples cliniques
L’unité de soins Sesame correspond à une unité
fonctionnelle d’alcoologie rattachée au centre hospitalier
Ph. Pinel. La capacité d’hospitalisation est de vingt lits
pour un mois de soins. En pratique, suite à un entre-
tien médical, l’hospitalisation se décide en dehors de tout
contexte d’urgence. L’objectif principal de la cure consiste
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en
ciblant la santé physique et psychologique, les relations
sociales et les comportements addictifs. Cela demande
des interventions thérapeutiques (médicales et soignantes)
en accompagnant le malade alcoolique vers un change-
ment de consommation (que cela soit l’abstinence ou une
réduction de consommation). En lien à ces interventions,
nous proposons un accompagnement psychologique selon
un regard psychodynamique3sur la personnalité du sujet
«addicté »à l’alcool. Cet accompagnement consiste en
une série d’entretiens basés sur la compréhension globale
3À l’aide de l’orientation psychodynamique, nous cherchons à tenir compte
de l’extrême complexité de l’organisation de la vie psychique et de la grande
diversité des histoires et de situations de chacune des personnes rencon-
trées, sans exclure les apports d’autres approches psychopathologiques
(thérapie comportementale et cognitive ou thérapie systémique).
du patient, à travers toutes ses dimensions culturelles. Il
requiert d’instaurer une alliance thérapeutique avec «la par-
tie saine »[39] de sa personnalité alcoolique. Cette stratégie
permet de contenir les affects qui conduisent le sujet à
s’alcooliser massivement. Dans le cas de situations inter-
culturelles, en référence aux écrits de Surena [44] et de
Guérraoui et Pirlot [45], nos entretiens sont axés sur la souf-
france addictive articulée à l’histoire personnelle et familiale
du patient, en fonction de son tissu socioculturel présent et
passé. Le travail sur les représentations culturelles se fait
dans le dialogue, nous accompagnons le patient dans une
réflexion sur ses affiliations. La langue maternelle est privilé-
giée dans le suivi. Elle permet de sortir de l’irreprésentable
en utilisant les ressources de la culture quand les mots de
l’intériorité manquent [45, 46]. Notre écoute est attentive
aux troubles et traumatismes passés qui peuvent être réac-
tivés (retour du refoulé ou du clivé). Elle tient compte de
notre contre-transfert culturel [45]. En prenant en considéra-
tion la personnalité du patient, nous cherchons à substituer
au silence de la honte la remémoration pour aider le patient
à réacquérir des potentialités de la vie psychique.
Nous présentons maintenant plusieurs exemples cli-
niques. Les sujets rencontrés s’exprimaient en langue
franc¸aise.
Madame A : honte et abus sexuels
dans l’enfance
Madame A., d’origine allemande, sans profession, est
âgée de 49 ans. Elle a gardé sa nationalité d’origine. Cette
patiente vient au Sesame suite à des alcoolisations aiguës
répétées depuis plus de dix ans. Elle a déjà bénéficié de
plusieurs sevrages à l’hôpital. À son entrée, Madame A
présente un tableau dépressif (avec tristesse, culpabilité
et pensées suicidaires) et se plaint de violents maux
de tête et d’une crainte de l’avenir. Durant le séjour, le
traitement prescrit, à base de valium, de réducteurs
d’appétence, d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de vita-
mines, montre son efficacité au bout de deux semaines, en
parallèle aux activités thérapeutiques proposées. Dans les
groupes, elle parle de sa souffrance dépressive et progres-
sivement de sa honte de boire de l’alcool.
En entretien individuel, nous sommes face à une patiente
qui est empêtrée dans des souvenirs traumatiques. De son
histoire de vie, Madame A. se réfère souvent à son enfance
allemande fortement idéalisée. Elle regrette son pays avec
212 L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%