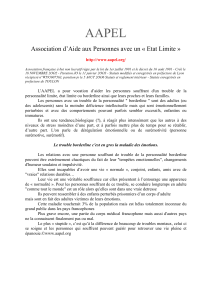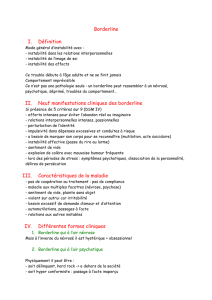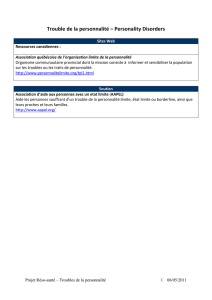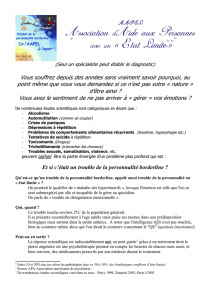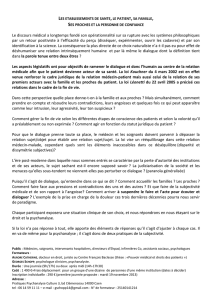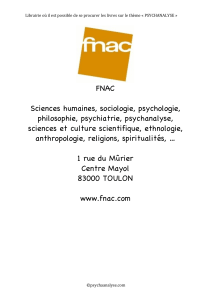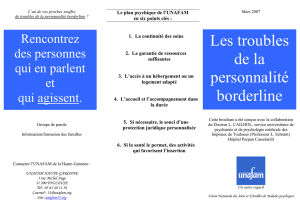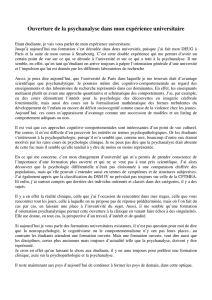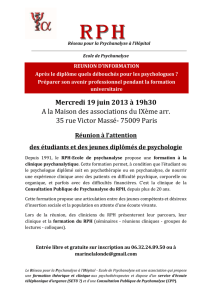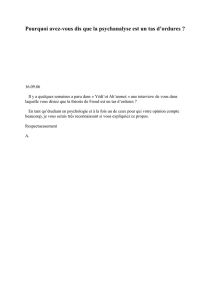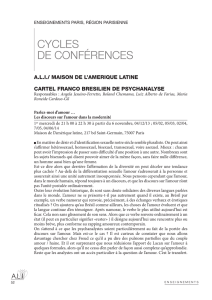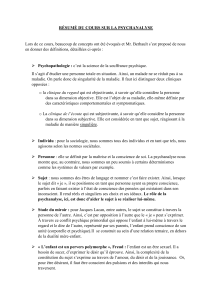lire l`abstract

www.nant.ch
LA PSYCHANALYSE AUTREMENT
Cycle 2017 – Se laisser mourir, vouloir mourir, à travers les âges
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence du
Professeur Antonio ANDREOLI
Psychiatre et psychanalyste, membre formateur de la Société Suisse de Psychanalyse et ancien Professeur et
Chef de service de psychiatrie à l'Hôpital de Genève.
" Le traitement psychanalytique de la crise suicidaire borderline :
un voyage aux confins de la recherche clinique et des sciences
humaines. "
Jeudi 11 mai 2017 à 19h15
Grande salle –– 1804 Corsier s/Vevey
Entrée libre

2/3
La multiplication actuelle des conduites auto-dommageables attire notre attention sur un visage
troublant du nouveau malaise de notre société et la pratique du patient réel des services psychia-
triques montre toute l’ampleur de ce phénomène. Chaque jour, nous côtoyons en effet un même
mal de vivre qui grève la réponse à l’urgence, les soins hospitaliers ou la consultation ambulatoire
d’une menace suicidaire bouleversante. La rencontre avec cette difficulté enferme les soignants
dans des dilemmes dramatiques et montre toutes les limites des dispositifs d’accueil et de traite-
ment du patient aigu.
Ce problème a sollicité un effort d’innovation et de recherche qui a débouché sur un progrès
significatif de la psychothérapie spécialisée et des politiques de soins (Lorillard et al., 2010; Berrino
et al., 2011). Le psychanalyste averti de l’importance d’un tel enjeu est toutefois frappé par ce que
les vicissitudes de la vie amoureuse font valoir dans la clinique de ces sujets. Nombre d’études ont
en effet indiqué que ce facteur est le corrélat plus fréquent de la tentative de suicide et des nou-
velles perspectives ont été ouvertes depuis à une réflexion qui intègre les avancées de la recherche
clinique et l’un des thèmes plus captivants, de l’œuvre freudienne. Ce que le trauma d’amour, allié
de la vie et complice de la mort, importe, par l’entremise de la névrose, dans le fonctionnement de
l’humain pourrait avoir la plus grande importance pour la médecine et la psychologie. L’amour est
surgi en nature avec l’apparition des mammifères. Mais l’amour des êtres humains alimente, lui, un
conflit radical entre la chair et le narcissisme, l’attachement et la sexualité, qui ne cesse de se pla-
cer en travers de la machine instinctivo-émotionnelle de l’espèce. D’où des troubles psychobiolo-
giques innombrables dont ce même conflit complique par ailleurs le traitement.
Ce thème a un intérêt considérable pour faire dialoguer sciences cliniques et sciences humaines et
notamment pour revisiter le « Malaise dans la civilisation » à la lumière de l’intérêt suscité par le «
malaise de la modernité » chez les philosophes et les sociologues. Celui qui pratique tout autant le
divan que les services d’urgence serait en fait tenté de concevoir le dit malaise comme ce qui a
remplacé, chez nos contemporains, le conflit ancestral entre la religion et la sexualité par le conflit,
tout aussi irréductible, entre l’idéal de la Raison et l’amour adulte. L’épidémie suicidaire contempo-
raine n’est en fait qu’un aspect plus troublant de l’intarissable demande de soins d’un nouveau
patient psychiatrique aigu cherchant une solution à des crises de vie où les logiques hétérogènes
du désordre médical, de l’événement et de la personnalité s’entremêlent à l’enseigne d’une perte
de contrôle émotionnel qui a son commun dénominateur dans les vicissitudes de la vie amoureuse.
Le patient borderline, ce sympathique empêcheur de tourner en rond de nos certitudes, est
l’exemple même de cette clinique et un modèle électif des enjeux psychanalytiques à l’épreuve des
faits. À partir de ces considérations nous avons développé une nouvelle forme de psychothérapie
de l’abandon d’amour dont nous discuterons brièvement le rationnel, la technique et les résultats
(3) à la lumière des questions évoquées plus haut (4).
Cette conférence se présente en conclusion comme une invitation à voyager aux confins de la
psychanalyse. De la psychanalyse, de la psychiatrie et des sciences humaines sur le fil de nos
études récentes sur la psychothérapie de la crise suicidaire borderline. Nous nous arrêterons tout
spécialement sur ce que les relations de la réaction borderline et du deuil traumatique de l’abandon
signalent, du côté de l’expérience de la réalité ou du monde interne, des failles du
contrinvestissement de la limite du fonctionnement mental. Le « revenant » qui se fait jour à cette
frontière marque le retour sur scène d’un rapport profond du Moi et de l’Idéal qui est à la fois le
moteur de la crise suicidaire, le noyau de la névrose du narcissisme et la marque indélébile de la
nature fondamentalement traumatique et animiste de l’amour humain (5).

3/3
Références
1). Lorillard S., Schmitt L., Andreoli A. (2010). Comment traiter la tentative de suicide? Première
partie. Efficacité des interventions psychosciales chez des patients suicidaires à la sortie des
urgencies. Annales Medico-Psychologiques 169: 221-228. Seconde partie: une revue des
traitements et de leur efficacité chez des patients borderline. Annales Médico-Psychologiques doi:
10-10.2016/j.amp.2010.08.008
2). Berrino A., Ohlendorf P., Duriaux St., Burnand Y., Lorillard S., Andreoli A. (2011). Crisis
intervention at the general hospital: an appropriate treatment choice for acutely suicidal borderline
patients. Psychiatry research 186: 287-292.
3). Andreoli A., Burnand Y., Cochennec M-F., Ohlendorf P., Frambati L., Gaudry Maire D., Di
Clemente Th., Hourton G., Lorillard S., Canuto A., Frances A. (2016). Disappointed Love and
Suicide: A Randomized Controlled Trial of "Abandonment Psychotherapy" Among Borderline
Patients. 30:271-287.
4). Andreoli A. (2007). Psychanalyse et vérité. Revue Française de Psychanalyse 5/2008: 1591-
1597.
5). Andreoli A. (2016). Amour et créativité: allies de la vie, complices de la mort. Action et Pensée
63: 5-16,
Pour ceux qui voudraient approfondir le questionnement psychanalytique évoqué par l’exposé voir :
- Andreoli A. (1989). "Le Moi et son objet narcissique". Revue Française de Psychanalyse
51: 139-196.
Mots clé: tentative de suicide, urgence, crise, trouble de la personnalité borderline, psychothérapie
analytique, essai clinique randomisé.
1
/
3
100%