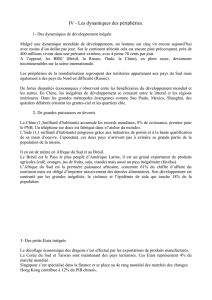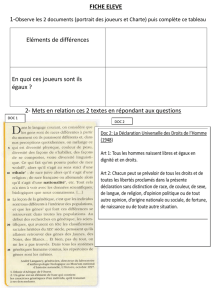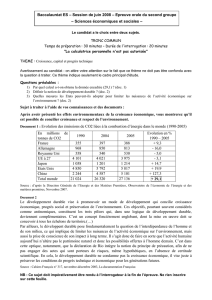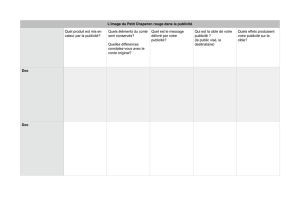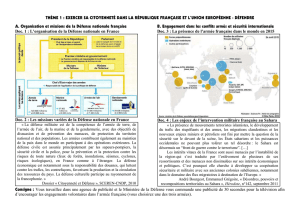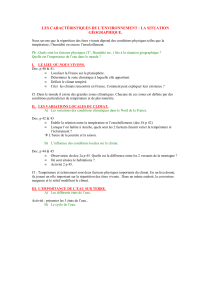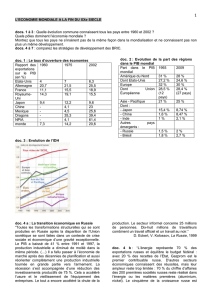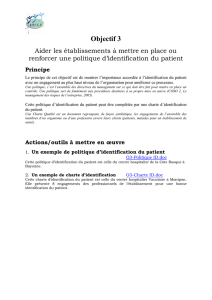Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
*Après l’étude de l’Europe en classe de Première, inscrite également en Terminale dans le
programme d’Histoire sous l’angle de la gouvernance continentale, ainsi que l’espace russe
articulé à l’Eurasie, il s’agit ici de mesurer et de comprendre les dynamiques qui animent les
autres espaces continentaux en interrelations : l’Amérique, celle des Etats-Unis bien sûr mais
aussi celle de pays en pleine mutation dont l’émergence brésilienne est la figure de proue ;
l’Afrique aux dimensions et aux images si contrastées, travaillée par toutes les incertitudes et
les contradictions du développement ; et enfin, l’Asie, celle qui compte , celle du Sud et de
l’Est, avec ses mastodontes démographiques que sont l’Inde et la Chine, cette dernière
semblant cristalliser à elle seule les angoisses et les passions du déclin de l’Occident. Et
pourtant cette « grande ombre pesant sur la prééminence occidentale » (Bernard Guetta)
n’est guère exempte de profondes faiblesses… [Cf. cours La Chine et le monde depuis le
« mouvement du 4 mai 1919 »].
Première partie :
L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud
I- Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale
*Une problématique claire : Pourquoi le bassin caraïbe est-il une interface tout à la fois
américaine et mondiale ?
*Définition d’interface : lexique p.212 + cours « La Méditerranée : une interface Nord/Sud ?
- Quel espace concerné ? Qu’entend-on par bassin caraïbe ?
* Cartes p. 206/207 .
Une mosaïque d’Etats ou de territoires sous tutelle plus ou moins autonomes (34…), à la fois
continentaux et insulaires, ouverts sur le golfe du Mexique et la mer dite des Caraïbes (ou des
Antilles pour les Français…), et donc sur l’Atlantique. Son étendue maritime est de l’ordre de
4,3 millions de km2.
*Carte 2/207 : Géopolitique du bassin caraïbe.
- Le détour par l’Histoire est une fois de plus indispensable si l’on veut appréhender
correctement la géographie d’aujourd’hui…
*Carte 1/206 : Le bassin caraïbe : héritages et métissages.
A- Une interface aux facteurs d’intégration, d’unité et de diversité hérités de la première
mondialisation coloniale
1- Des facteurs d’unité et de diversité
a)Certes la situation de littoralisation est de fait favorable aux échanges : trait d’union entre
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, entre l’Atlantique et le Pacifique (que concrétise
1

l’ouverture du canal de Panama en 1914), le bassin caraïbe dispose de sérieux atouts pour
exploiter les forces centripètes et jouer la carte de l’intégration /coopération, tout au moins
économique.
b)Pourtant, en première approche, c’est plutôt paradoxalement une perception d’éclatement,
d’émiettement et de discontinuité qui s’impose…
-Les disproportions et les rupture de charge sont en effet souvent spectaculaires voire
caricaturales tant au niveau des réalités strictement géographique et démographique (St-Kitts-
et-Nevis /Mexique), qu’économique et géopolitique (Etats-Unis avec la Floride, la Louisiane et
le Texas/Haïti)…
-Les statuts sont également très différenciés entre des Etats pleinement souverains, à
commencer par l’hyperpuissance des Etats-Unis (que l’on confond encore couramment avec
l’Amérique…) ; des territoires semi-autonomes sous tutelle (Porto Rico) ou les territoires
ultramarins de l’U.E (Antilles françaises).
-Les oppositions idéologiques y sont également très marquées et ont été sources de conflits
majeurs qui peuvent perdurer et interférer fortement dans la géopolitique régionale. Ainsi
Cuba est-elle toujours sous embargo américain (même assoupli) depuis la crise des missiles de
1962. Les guerres civiles en Amérique centrale ne sont éteintes que depuis une vingtaine
d’années (fin de la Guerre froide) alors que les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie
(FARC) n’ont pas encore désarmées même si elles ont accepté de négocier avec le pouvoir
central, sous l’égide de la Norvège. Quant au Venezuela bolivarien d’Hugo Chavez, il ne cesse
d’afficher sa totale solidarité avec Cuba et ne rate aucune occasion - tout au moins rhétorique
– de montrer son hostilité à l’impérialisme yankee…
-Enfin plusieurs organisations régionales se partagent l’espace dont les deux principales,
l’ALENA et le MERCOSUR
*Carte 2/207
2-Mais ce simple exposé des fragmentations géopolitiques des Caraïbes pointe déjà trois
constantes :
a)D’abord l’ héritage de toute la période coloniale européenne proprement dite (qui prend fin
dans les dernières décennies du XIXème siècle sur la dynamique des indépendances
bolivariennes), ne serait-ce que dans sa dimension linguistique et culturelle, avec une
discontinuité majeure qui perdure entre un espace anglophone et un espace latin
(hispanophone et lusophone), la présence francophone et néerlandophone étant plus
résiduelle. [Même si la mixité linguistique est désormais d’une plus grande réalité, notamment
aux Etats-Unis, avec une population hispanophone conséquente (qui désormais fait basculer
2

les élections américaines…), et le retour des langues amérindiennes en Bolivie ou au Pérou
comme le Quechua]
*Lexique p.212 : la notion de « Mexamérique.
*Carte 1/206 : Le basin caraïbe : héritage et métissages
La colonisation avec les frontières qu’elle a léguées (à l’instar de l’Afrique), son économie de
traite, de plantations et d’exploitation des ressources minières destinée aux métropoles
colonisatrices d’Europe a clairement entravé un processus de croissance endogène et
diversifiée (industries de biens de consommation par exemple) de la sous-région.
b) Ensuite ce qu’il est convenu de nommer l’impérialisme américain, c’est-à-dire
l’omniprésence des Etats-Unis et leur interventionnisme particulièrement actif dans ce qu’ils
ont toujours considéré depuis la fin du XIXème siècle, en prenant le relais des anciennes
puissances coloniales, comme leur zone d’influence première - leur « arrière-cour » disait-on il
y a peu encore – et qui constitue une sorte de « Méditerranée américaine ». C’est pourquoi le
bassin caraïbe a toujours été emblématique de la bipolarisation du monde jusqu’à la fin des
années 90 et un enjeu tout autant stratégique que symbolique de la Guerre froide.
Dans le but d’établir et de maintenir une pax americana, les Etats-Unis ont ainsi combattu - et
souvent contribué à renverser - tous les régimes d’Amérique latine et ceux des Caraïbes qui
pouvaient contrarier leurs intérêts économiques et géopolitiques (Guatemala,1954 ; affaire de
la Baie des Cochons à Cuba,1961 ; Chili, 1973 ; Grenade, 1983 ; Panama, 1989) ainsi que les
guérillas d’obédience marxiste (Bolivie, Che Guevara, 1967). A contrario ils ont soutenu tous
les régimes, notamment les dictatures militaires, qui leur étaient affidés.
c)L’instabilité politique ainsi que le sous-développement économique et l’extrême inégalité
sociale qui en découle sont ainsi nettement liés à l’héritage coloniale et à la dépendance vis-à-
vis de la puissance tutélaire américaine. Si les régimes institués depuis la fin de la Guerre
froide en Amérique latine (centrale et sud) et dans les îles caraïbes sont dans leur très grande
majorité issus d’élections libres, il n’en demeure pas moins que la corruption et la violence en
forment encore le quotidien, à commencer par le Mexique où l’Etat, miné par le narco-trafic,
abdique devant les cartels et n’est plus totalement en mesure d’administrer l’ensemble de son
territoire.
*C’est ainsi que l’interface caraïbe issue de l’impérialisme (dans son acception globale)
demeure profondément marquée par cette première mondialisation coloniale et sa dimension
proprement américaine dans le cadre des rapports Nord-Sud, qu’incarne la profonde
discontinuité entre la puissance étatsunienne et le bassin caraïbe proprement dit. D’où
l’intérêt de la comparaison méditerranéenne (Cf. programme de Première).
La mondialisation actuelle ne pouvait qu’y trouver un terreau favorable à son expansion.
*Carte 3/207 : Inégal développement et migrations : une interface Nord-Sud.
3

*Carte 1/214 : Les contrastes de richesse et de développement du continent américain.
B- Une interface marquée aujourd’hui par de nouvelles logiques d’intégration à la faveur de
la mondialisation
1- Une interface emblématique de la mondialisation
La continuité géographique entre les Etats-Unis et un bassin caraïbe globalement émergent
mais très hiérarchisé en termes de performance économique et de pacification sociale,
explique l’importance des échanges et des flux, légaux ou illégaux. Le bassin caraïbe offre de
fait une excellente illustration de la mondialisation d’aujourd’hui dans le cadre de Nouvelle
Division Internationale du Travail (NDIT) et des mutations du capitalisme, notamment
financier.
*Cf. cours « Les dynamiques de la mondialisation » (Mobilités, flux et réseaux)
*Carte 1/213 : L’organisation économique du bassin caraïbe.
a)Les flux migratoires sont spectaculaires et de façon écrasante constitués selon un axe
Sud/Nord, de l’Amérique latine et des Caraïbes vers les Etats-Unis, via le Mexique, les Iles
Vierges ou Porto Rico. Depuis près de vingt ans, les Etats-Unis ont érigé un véritable mur sur la
frontière du Rio Grande afin de contrer l’immigration clandestine. Si l’ALENA, créée en 1992,
autorise la libre circulation des biens et des capitaux, il n’en est pas de même des individus…
*Doc1/104 : Le récit d’un migrant mexicain vers les Etats-Unis.
Les flux touristiques sont en revanche Nord/Sud, des Etats-Unis et du Canada vers des iles
tropicales à la réelle qualité de service, comme les Bahamas. La région constitue le premier
espace mondial de croisière. Deux mondes se côtoient…
b) Les flux matériels sont très divers : agricoles, pétroliers (Venezuela, off shore) et
-illustration emblématique du phénomène de délocalisation- produits manufacturés réalisés
dans les maquiladoras, en particulier à la frontière mexicaine (cf. lexique p.212).
*Doc 7/209 : L’industrie maquiladora au Nicaragua
c) La littoralisation des activités est propice à la création de zones franches à proximité des
ports alors même que 5% du trafic maritime mondial transitent par le canal de Panama.
*Doc 5/208 : La zone franche de Colon au Panama (2500 entreprises aux capitaux pour
l’essentiel d’origine asiatique)
*Doc 4/208 : La région centrale du Panama, un nouvel espace mondial ?
d) La criminalisation de l’économie mondialisée y est également importante , constituée d’une
part des différents trafics illicites qui peuvent aller jusqu’à ébranler les Etats, comme celui de
la drogue en Colombie ou au Mexique en générant des centaines de millions de dollars de
profits, et, d’autre part, des flux financiers de blanchissement ou de fraude fiscale dans les
paradis fiscaux (Iles Caïmans, Antigua).
4

Dans le même ordre d’idées, certains Etats offrent également des pavillons de complaisance
comme Panama ou St-Vincent.
2- Miami : métropole de commandement du bassin caraïbe et hub mondial
*Dossier p.210/211 : En quoi Miami est-elle un hub continental et mondial ?
Miami s’affirme comme une plaque tournante de la finance internationale en relayant les
places off shore et en drainant les capitaux de l’ensemble des Caraïbes. Plus prosaïquement
elle est le premier port de croisières dans le monde et la destination privilégiée des retraités
américains et canadiens aisés.
Conclusion : Une interface américaine et mondiale réelle mais une faible intégration à
l’échelle même du bassin caraïbe où les forces centrifuges, les contraste et les inégalités de
développement semblent de beaucoup l’emporter.
L’interface prend ainsi le plus souvent la forme de fractures entre des sociétés et des
économies disproportionnées, celles d’un Nord redoutablement puissant et riche et celles
d’un Sud fractionné et précarisé, en dépit de l’émergence de puissances régionales comme le
Brésil qui entendent désormais poser leurs jalons et rivaliser avec les Grands de la Triade. A
l’image même d’une mondialisation en panne de véritables redistributions équitables…
*Cours « Les dynamiques de la mondialisation » (La mondialisation en débat)
II- Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales
*Bilan p.211 : De l’étude du cas emblématique du bassin caraïbe à la mise en perspective à
l’échelle continentale de l’Amérique.
Le continent américain reconduit-il les dynamiques que l’on a vu à l’œuvre dans l’interface
caraïbe (en termes d’échanges, de flux, de mobilités)?
Une problématique qui se décline en une série de questions complémentaires: Quelles sont
les diverses formes d’intégration continentale en Amérique ? Quelles sont les dynamiques qui
l’animent ? Sont-elles de même nature que celles précédemment identifiées (étude Caraïbes)?
Des lignes de force nouvelles se dessinent-elles ? Quelle est leur inscription dans la
mondialisation ?
*Cartes p.214/215
Descriptif : Plus de 42 millions de km2 (continent le plus vaste après l’Asie),près de 15000 km
du nord au sud et une population de 930 millions d’habitants. Deux pays enclavés : la Bolivie
et le Paraguay, ce qui en l’occurrence constitue un handicap certain.
*Cours « Les dynamiques de la mondialisation »
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%