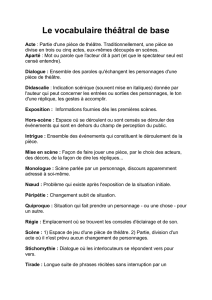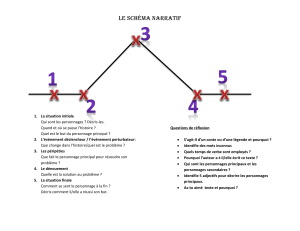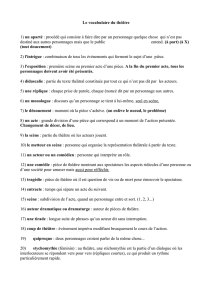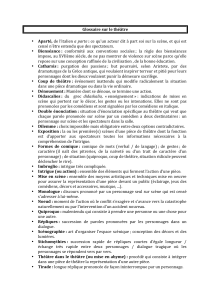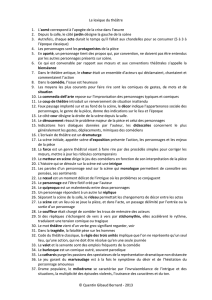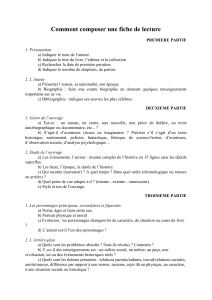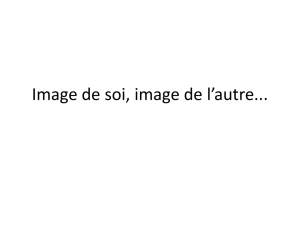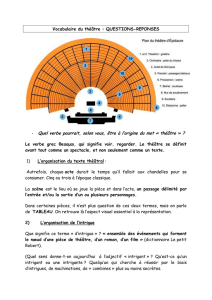Six personnages

Six personnages
PIRANDELLO
Six personnages
en quête
d’auteur
Présentation par
Nadia Ettayeb
Étonnants Classiques, n˚ 2181
ur une scène de théâtre où une troupe répète sans convic-
tion une pièce de Pirandello (
Le Jeu des rôles
) surgissent
six personnages égarés. Leur auteur a refusé de leur donner
vie et les a condamnés à errer, inachevés, dans les limbes de la
création. Cette intrusion dans l’univers de l’illusion sème le
trouble, suscite colère, rire et conflits. Sous le regard fasciné et
sceptique de la troupe d’acteurs et de leur directeur devenus
spectateurs, les six personnages plaident leur cause et jouent
leur existence.
I. P
OURQUOI
ÉTUDIER
S
IX
PERSONNAGES
EN
QUÊTE
D
’
AUTEUR
?
Cette pièce n’appartient pas aux corpus des classiques
français généralement étudiés au lycée. Elle présente cepen-
dant plusieurs aspects en rapport avec les objets d’étude ins-
crits au programme de Première.
Œuvre originale,
Six personnages en quête d’auteur
sou-
lève des questions importantes concernant les enjeux de la
représentation au théâtre. La mise en abyme permet de mener
une réflexion sur l’illusion théâtrale. Le drame « vécu » par
les personnages se heurte sans arrêt aux limites sclérosantes
de sa mise en scène, posant ainsi indirectement la question du
rapport entre texte (celui que les personnages portent en eux
mais qui ne peut être que transcrit par bribes) et représenta-
tion. La relation entre l’œuvre et la mise en scène peut aussi
10
S

198
être envisagée sous un autre angle, puisque la pièce a fait l’objet
de nombreuses représentations, dont une de Jean Prat, dispo-
nible en vidéo à l’ADAV (Ateliers de diffusion audiovisuelle)
1
.
Pirandello affirme dans sa préface : « De ces six person-
nages, j’ai […] accueilli l’être, en refusant la raison d’être. »
C’est pourquoi nous avons privilégié cette approche et déli-
mité des extraits en rapport avec la question de la représenta-
tion et du conflit qu’elle suscite entre personnages « vivants »
et professionnels du théâtre, c’est-à-dire maîtres de l’illusion,
toujours en quête d’effets à produire.
L’acharnement dont font preuve les six personnages dans
leur désir de vivre leur drame donne lieu à des dialogues où
se déploie avec force l’art de convaincre et de persuader, ce
qui constitue un second objet d’étude inscrit au programme.
II. P
ISTES
POUR
UNE
SÉQUENCE
PÉDAGOGIQUE
S
ÉANCE
1
L
A
MISE
EN
ABYME
Objectif : cerner les enjeux de la mise en abyme dans l’œuvre,
par une lecture cursive de la présentation des personnages
et de la didascalie initiale.
Travail préparatoire : on pourra envisager de comparer la liste
des personnages et la didascalie initiale de
Six person-
nages en quête d’auteur
avec celles d’une autre pièce, par
exemple
Ruy Blas
de Victor Hugo.
• Liste des personnages
(•
p. 40
)
– Lieu : l’univers du théâtre.
– Sujet : l’écriture théâtrale.
– Personnages : distinction entre « personnages de la pièce
à faire » et « comédiens de la troupe », entre pièce cadre et
pièce enchâssée. Les personnages ne portent pas de nom (sauf
Mme Pace) ; ils sont désignés par leurs liens familiaux ou
leur âge, ou encore par leur fonction dans l’univers théâtral.
1. ADAV, 41, rue des Envierges, 75020 Paris.

199
Six personnages
– Thème de l’inachèvement suggéré par l’expression
« pièce à faire », qui fait écho au titre de l’œuvre.
– Structure particulière de la pièce : diptyque, sans acte ni
scène, n’obéissant à aucune règle du théâtre classique. Les
interruptions sont dictées par les tâtonnements des gens de
théâtre, désorientés.
• La didascalie initiale
(•
p. 41
)
– Description minutieuse ; scène de théâtre non apprêtée,
qui se dévoile au public dans sa « réalité » quotidienne. Lec-
teurs et spectateurs doivent oublier qu’il s’agit d’une repré-
sentation théâtrale.
– Abondance de mots renvoyant à l’univers théâtral (« salle »,
« rideau », « coulisses », « décor », « scène », « lumière », etc.),
tous assortis d’attributs ou de privatifs qui soulignent l’aspect
naturel (« levé », « tel qu’il est de jour », « sans lumière », « à
moitié caché »).
– Éléments du décor fonctionnant comme des métonymies :
couvercle du trou du souffleur, fauteuil du chef de troupe dont
le dossier, « tourné vers le public », suggère la présence d’un
quatrième mur.
– Importance des indicateurs spatiaux (« çà et là » ; cou-
vercle déplacé) : désordre consciencieusement orchestré par
le dramaturge qui crée de l’illusion.
– Le premier personnage entre en scène presque par
hasard, pour bricoler ; il s’agit d’un machiniste, fonction qui
renvoie à l’envers du décor habituellement dissimulé au spec-
tateur pour que fonctionne la magie théâtrale.
→
Paradoxe de la pièce : Pirandello se sert du théâtre pour
en souligner les limites.
• Prolongement : mise en abyme du théâtre dans le théâtre
Support : Dossier, •
p. 135-142
.
Exercice : répondre aux questions qui se trouvent •
p. 140
et
•
p. 142
.
Shakespeare,
Hamlet
1. – Typographie distinguant le texte des personnages de
celui de la pièce cadre.
– Commentaires d’Hamlet, metteur en scène. Scène dési-
gnée avec ironie comme une « pièce » (
• p. 138
) puis comme

200
un « jeu » (
• p. 139
),
terme équivoque (jeu des comédiens et
jeu de la dénonciation indirecte).
– Texte écrit en alexandrins ; images et références mytho-
logiques (•
p. 136
,
• p. 139
) ; emphase peu naturelle (cf. le
serment de la reine de comédie qui précède l’entrée de
Lucianus,
• p. 138
) ; langage alambiqué (« trente fois douze
lunes », « douze fois trente tours », •
p. 136
).
– Double énonciation : ressort de l’accusation. Ex : tirade
du roi (
• p. 137-138
) = réquisitoire d’outre-tombe dirigé
contre la reine.
2. Dénonciation de l’inconstance, la duplicité et la concu-
piscence de la reine :
– Répétition suspecte du mot « amour » comme si elle
avait besoin de se convaincre elle-même des sentiments
qu’elle porte à son époux.
– Le personnage qui la représente prononce des serments
qui jurent avec la situation (« La lune et le soleil fassent
autant de voyages/Avant que notre amour quitte ce rivage » ;
« Or, malgré mon tourment/il ne faut, monseigneur douter
aucunement », •
p. 136
). Peu de crédibilité des serments mis
en évidence par la comparaison avec un « fruit vert »
(•
p. 137
).
– La reine de comédie est comme un miroir accusateur
tendu par Hamlet à sa mère coupable de trahison (« Qui en
prend un second a occis le premier » : ce dernier vers sonne
comme une accusation sans appel). Écho dans la suite de la
réplique : remariage de nouveau assimilé à un crime (« et je
tue mon mari une seconde fois/Lorsqu’un second mari
m’embrasse entre les draps », •
p. 137
).
– Oxymores : écart entre les paroles et les actes, l’incons-
tance du caractère : « Peine se réjouit, Joie pleure dès qu’il
vente » (•
p. 138
).
– « Mariage » rime avec « avantage » (•
p. 137
) ; écho
dans la tirade du roi à travers un chiasme : « amour mène-t-il
Fortune, ou bien Fortune Amour ? » : thème de la cupidité.
– Invocation finale de la reine de comédie, qui fait réfé-
rence à la situation au moment de l’énonciation : rappel inso-
lent de ce qui menace la mère d’Hamlet : « Ici et en tout lieu,
suivez-moi, maux sans fin,/Si veuve devenue, épouse je
redeviens » (•
p. 138
).

201
Six personnages
Corneille, L’Illusion comique
1. – Anaphore de l’expression « je vois » : étonnement et
incrédulité.
– « Charme », sens étymologique fort : idée d’une inter-
vention magique.
– Antithèse « vivants »/« morts ».
2. – Expression globalisante et démystificatrice : « tous les
acteurs » (• p. 141).
– Retour à la réalité = activités triviales : le partage des
gains.
– Reprise des antithèses (• p. 141) : « l’un tue et l’autre
meurt », « le traître et le trahi, le mort et le vivant/se trouvent
à la fin amis comme devant » ; explication par « la scène »
qui renvoie à l’illusion.
– Valeur performative du langage : « leurs vers font leur
combat, leur mort suit leur parole ».
S
ÉANCE
2
Objectif : étudier comment la mise en abyme met en relief la
confrontation entre l’univers théâtral et celui de la création.
• Remarques préliminaires sur la didascalie (• p. 47-49)
– Didascalie longue : désir de voir la représentation res-
pecter scrupuleusement la nature des personnages et scepti-
cisme à l’égard d’une éventuelle adaptation (les indications
s’adressent à celui qui « voudrait tenter une mise en scène »,
• p. 47, l. 192). Souligne également la nécessité de distinguer
très nettement les personnages et les comédiens, suggérant
ainsi la différence entre l’univers théâtral et celui de l’art qui
aboutit à une incompréhension réciproque.
– Précision de la description du père (couleur des yeux et
largeur du front) comme si le personnage existait d’une vie
propre et ne pouvait quasiment pas être incarné.
– Importance de l’expression « réalités créées » (• p. 47,
l. 204), qui insiste sur l’altérité radicale de ces créatures, à
mi-chemin entre le monde de l’art et la réalité connue.
→ Lecture analytique 1. « Pardon monsieur le directeur […]
les faire vivre pour l’éternité » (• p. 50-57)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%