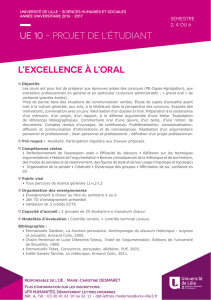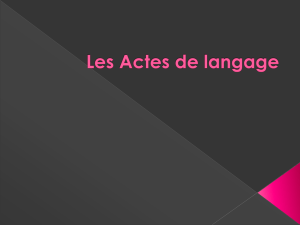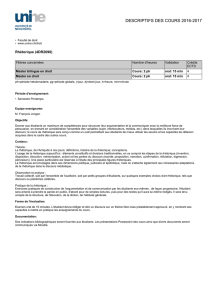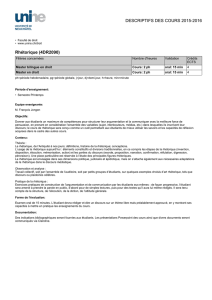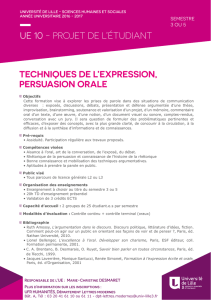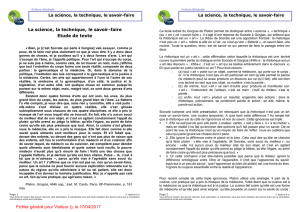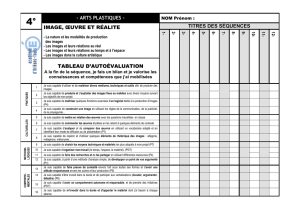La performance avant le performatif ou la troisième

105
La performance avant le performatif
ou
la troisième dimension du langage
BARBARA CASSIN
« [...] ce que l’on peut appeler à juste
titre une rhétorique moderne, une autre étude
systématique de la façon dont on peut avoir un
effet ou être affecté par des actes de discours,
à savoir l’ouvrage d’Austin How to do things
with words, qui est un recueil de notes pour
des conférences (comme le sont les textes
d’Aristote) publiées à titre posthume »
Stanley Cavell « La passion », dans Quelle
philosophie pour le XXIème siècle, J. Benoist et al. éd.,
Paris, Gallimard – Centre Pompidou, 2001, p. 335.
« Rien ne nous empêche de tirer un
trait là où nous le voulons et où cela nous
arrange»
J. L. Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil,
1970, trad. Lane, p. 123.
I
Philosophie, rhétorique, sophistique
Comment « agit » exactement le logos ?
Je voudrais commencer par tracer un horizon de problèmes et un angle d’attaque.
Mon point de départ est la trop célèbre phrase par laquelle Gorgias caractérise le
logos dans l’Eloge d’Hélène (82 DK 11 §8, t. II, p. 290) :
Lovgoı dunavsthı mevgaı ejstivn, o}ı smikrotavtwi swvmati kai; ajfanestavtwi
qeiovtata e[rga ajpotelei``
- phrase que je propose de traduire :

La performance avant le performatif ou la troisième dimension du langage
106
« Le discours est un grand souverain qui avec le plus petit et le plus inapparent des
corps performe les actes les plus divins ».
Trois termes sont à souligner, qui renvoient sinon à l’acte de langage, du moins, au
langage comme acte. La différence entre les deux, acte de langage et langage comme
acte, est précisément ce que je cherche à interroger.
Dunavsthı : c’est le premier déterminant du lovgoı. Notons, pour s’en débarasser,
que je rends lovgoı par « discours » en souhaitant recouvrir du manteau de ce terme
toutes les distinctions ultérieures incubées dans le français ; il importe en effet, pour
comprendre comment « ce discours-ci » tenu par Gorgias (o{de oJ lovgoı §3) peut
légitimement servir de point de départ pour une réflexion sur l’acte de langage, de
remarquer que l’amplitude sémantique du grec lovgoı y est très largement mobilisée,
ne serait-ce que via le jeu constant entre singulier et pluriel. On pourrait par exemple
traduire (ou surtraduire) les occurrences des paragraphes 9 à 13, selon le cas, non
seulement, au singulier, par « langage », « parole », « discours », mais, au pluriel, par
« genres littéraires », « doctrines et traités », « discussions », « phrases et mots ». Il y
va simultanément du rapport à la ratio comme formalisation rationnelle (ejgw; de;
bouvlomai logismovn tina tw`i lovgwi dou;ı §2, « moi, je veux, donnant logique au
discours ») et comme proportion (to;n aujto;n de; lovgon e[cei h{ te tou`` lovgou
duvnamiı pro;ı th;n th`ı yuch``ı tavxin, « il y a le même rapport entre pouvoir du
discours et disposition de l’âme qu’entre dispositif des drogues et nature des corps »
§14). Bref le lovgoı, celui que produit Gorgias comme celui qui a pu persuader
Hélène, ceux des poètes et des oracles, ceux des météorologues, des orateurs et des
philosophes, le lovgoı est un « dynaste » : suivant Chantraine1, dunavsthı est celui
qui a « le pouvoir d’agir » en général, et notamment le « pouvoir politique », comme
Zeus (Sophocle), les chefs d’une cité (Hérodote, Platon), un prince ou un roi
(Thucydide). La parole est d’emblée puissance d’agir.
jApotelei` : tel est le premier verbe qui définit cette puissance d’agir. Il est
composé de televw, « achever, mener à terme, accomplir » une œuvre, une entreprise,
une action, conformément à l’ambiguïté de tevloı, la « fin » comme terme et comme
but, et de ajpov qui insiste sur l’achèvement d’un jusqu’au bout, exactement comme le
1 Chantraine, Pierre, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris,
Klincksieck, 1968-1980, sur lequel je m’appuie pour tout ce qui suit.

107
per de « performe ». On pourrait le rendre par « parachève », je choisis « performe »
pour faire entendre ce qui nous occupe.
[Erga : c’est cela qui est performé. Le terme, de même racine que work, entre dans
deux grands systèmes d’opposition : action / inaction (chez Hésiode par exemple), et
acte / mot, vain mot (au singulier comme au pluriel, d’Homère à Thucydide en
passant par les Tragiques). Cette opposition traditionnelle de la parole et de l’acte, du
verbal et du réel, est évidemment ce que notre phrase de départ met en court-circuit.
Elle le fait non sans profiter de l’amplitude du sens de e[rgon et de son pluriel,
« œuvre, ouvrage, occupation, travail, affaire, manœuvre », qui conjoint le réel de
l’acte et celui de l’œuvre : le lovgoı performe les actes / les œuvres les plus divins.
Cette ambiguïté, que nous n’interrogerons pas davantage, me semble accompagner la
question de la performance telle qu’elle se pose dans l’Antiquité, voire toujours.
Poursuivons la phrase, pour expliciter l’angle d’attaque :
Duvnatai ga;r kai; fovbon pau``sai kai; luvphn ajfelei``n kai; cara;n ejnergavsasqai
kai; e[leon ejpauxh``sai.
De fait, il a le pouvoir de mettre fin à la peur, d’écarter la peine, de produire la joie,
d’accroître la pitié.
Deux nouveaux verbes sont à verser au dossier, confirmant la puissance d’agir du
lovgoı. Duvnatai : le dynaste « a le pouvoir de », le puissant « peut ». Quoi faire ?
Accroître ou diminuer des passions premières (pavqhma, e[paqen §9). L’un des verbes
qui dit l’action sur une passion est plus remarquable que les autres, et apparemment
peu fréquent : c’est ejnergavsasqai mal traduit par « produire » la joie (qui à son tour
est loin de dire cavriı la « grâce » que verse Athéna sur la tête d’Ulysse pour qu’il
apparaisse dans sa force et sa beauté, la « faveur » et la « reconnaissance », le
« plaisir » et la « jouissance ») ; le terme reprend e[rgon l’acte / l’œuvre que performe
le langage comme acte ; à vrai dire, ejrgavzomai (ici en composition avec ajnav peut-
être au sens de produire « à nouveau », ou de « faire monter » la joie) est, à lui seul,
déjà rendu par to perform dans le Liddle Scott Jones. La joie est l’une des
performances les plus divines qu’accomplit le lovgoı.
Voici la question que je voudrais alors poser : en quoi tout ce qui est décrit là
excède-t-il la rhétorique ? Ne peut-on simplement rabattre la première phrase sur la
seconde, la seconde sur une thérapie de l’âme, subjective, et le tout sur une fonction
persuasive de type rhétorique ? Bref, l’action du langage ne se confond-elle pas avec

La performance avant le performatif ou la troisième dimension du langage
108
la rhétorique ? N’est-ce pas ainsi que l’on pense d’habitude, en tout cas chaque fois
qu’un philosophe lit un sophiste ?
Je voudrais tenter précisément un autre éclairage, à l’aide de la notion de
performance. D’où mes traductions. L’enjeu, qui m’est apparu en toute clarté quand
j’ai relu How to do things with words, est celui du statut de la rhétorique. Sèchement :
est-ce qu’il faut compter deux en matière de discours, ou est-ce qu’il faut compter
trois ?
Les questions s’enchaînent aussitôt. Quelle est l’identité du troisième terme ? Pour
la philosophie, le troisième, l’intrus, est la logologie sophistique2, et elle fait
« inexister » ce troisième terme dans toute la mesure du possible à son profit et au
profit de la rhétorique, qu’elle assujettit. Pour Austin, le troisième terme est la
rhétorique, qui survient comme à l’improviste mais dont il tente d’assurer la place
entre l’illocutoire, qu’il « invente », et le locutoire, qu’il circonscrit. La philosophie
grecque et Austin ne partent pas des mêmes évidences, mais ils sont tous deux
confrontés à une troisième dimension du langage – « dit-mension » pour mettre
orthographiquement avec Lacan les points sur les i3.
La double capture philosophique : la sophistique, c’est de la rhétorique, et la
rhétorique, c’est de la philosophie
Compter deux est ce à quoi la philosophie nous habitue. Quand on parle, on peut
ou bien « parler de », ou bien « parler à », selon un « ou » évidemment non exclusif.
« Parler de », dévoiler, décrire, démontrer, est du registre majeur de la philosophie en
tant qu’ontologie et phénoménologie. « Parler à », persuader, faire effet sur l’autre, est
du registre de la rhétorique. Il n’y a pas, du point de vue de la philosophia perennis,
de troisième dimension du langage.
Du coup, la seconde dimension elle-même est aspirée par la première.
On assiste en effet à un double rabattement. D’une part, ce qui pourrait excéder la
rhétorique, à savoir quelque chose comme la performance sophistique entée sur le
langage comme acte, est rabattu sur la rhétorique. D’autre part, la rhétorique devient,
2 Sur le terme « logologie », je me permets de renvoyer à L’Effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995, en
particulier p. 113-117.
3 « Le mieux est que je fasse un effort et que je vous montre comment je l’écris : dit-mension. »,
Columbia University Auditorium School of International Affairs, décembre 1975, dans « Conférences
et entretiens dans des universités nord-américaines », Silicet, n°617, Paris, Seuil, 1976, p. 42.

109
de son côté, plus ou moins tranquillement l’affaire de la philosophie. La troisième
dimension, celle que pourrait servir à esquisser quelque chose comme la sophistique,
est appropriée en même temps que la rhétorique par la philosophie normale, normée,
normative, et le flux potentiellement puissant, actif et autonome de l’acte langagier se
trouve alors domestiqué par l’ontologie.
On peut décrire très précisément ces deux points de rabattement.
Premier point : la sophistique, c’est de la rhétorique. Le Gorgias de Platon institue
cette équivalence comme une évidence de départ, quitte à la retravailler dans la suite
du texte. « Gorgias – demande Socrate – dis-nous toi-même comment il faut t’appeler
en tant que savant en quel art aujto;" hJmi'n eijpe; tivna se crh; kalei'n wJ" tivno"
ejpisthvmona tevcnh". Réponse de Gorgias : Th'" rJhtorikh'", w\ Swvkrate", « en
rhétorique, Socrate ». « Il faut donc t’appeler orateur ? », ïRhvtora a[ra crhv se
kalei'n… – « Et bon orateur, Socrate » jAgaqovn ge, w\ Swvkrate", …4. La sophistique,
c’est de la rhétorique, et c’est le sophiste en personne qui l’aura dit. Même si, selon
toute probabilité et contre l’apparence machinée par Platon d’un toujours déjà là de la
rhétorique, l’on assiste dans cet échange au moment d’invention du mot rJhtorikhv [sc.
tevcnh], comme d’ailleurs du mot sofistikhv, par Platon lui-même5.
Second point : or la rhétorique, c’est l’affaire de la philosophie. C’est vrai pour
Platon, puisque le Gorgias et sa rhétorique-sophistique, « ouvrière de persuasion »
(peiqou'" dhmiourgov"6), ne se comprennent que subsumés ou transcendés par le
Phèdre, avec l’avènement d’une rhétorique philosophique qui se confond cette fois
avec la dialectique et vise un auditoire de dieux7. La bonne rhétorique, c’est donc la
philosophie même. Aussi bien peut-on soutenir qu’avec Platon la rhétorique disparaît,
puisqu’elle se confond soit avec la sophistique quand elle est mauvaise, soit avec la
philosophie quand elle est bonne.
Cet extrémisme philosophique, qui vaut anéantissement de la rhétorique comme
telle, est dès lors moins probant que la perspective aristotélicienne selon laquelle la
4 449a.
5 Je renvoie sur ce point à l’article vraiment convaincant à mes yeux d’Edward Schiappa, « Rhêtorikê,
what’s in a name. Toward a revised history of early greek rhetorical theory » Quaterly Journal of
Speech, feb 1992, vol. 78, p. 2-15. Il l’a développé de multiples manières, notamment dans The
Beginning of Rhetorical Theory in Classical Greece, New Haven, Yale UP, 1999.
6 453a.
7 Je me permets de renvoyer sur ce point aux analyses de L’Effet sophistique, op. cit., p. 414-423, que
j’opérais alors via la lecture proposée par Ælius Aristide.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%