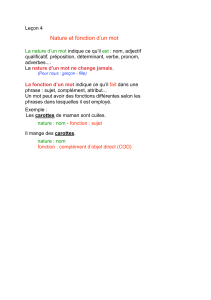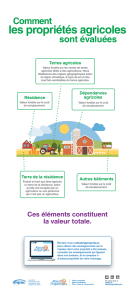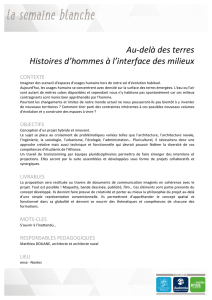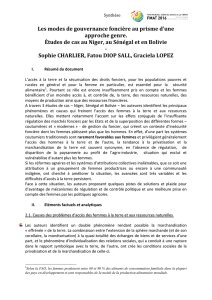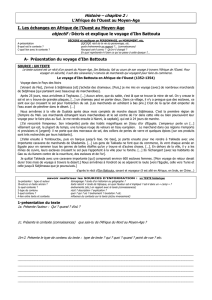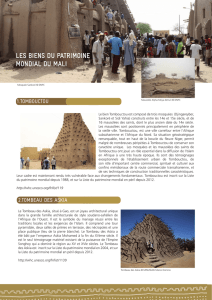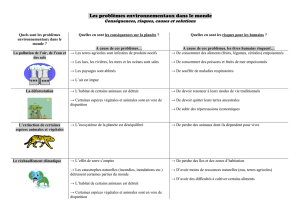Ethnocentrisme et création - Royal Museum for Central Africa

Ethnocentrisme et création
Sous la direction de Annie Dupuis,
avec la collaboration de Jacques Ivanoff
Les productions artistiques des sociétés dites traditionnelles ne sont géné ra-
lement pas présentées comme s’inscrivant dans une continuité historique qui
leur est propre mais, même datées, données comme chefs-d’œuvre intem-
porels ou situées dans une histoire de l’art occidentale – spécifiquement le
primi tivisme – qui les place dans un « présent artistique » auquel l’impact de la
modernité et de la mondialisation aurait mis fin. C’est méconnaître la plasticité
de la tradition, ne pas prendre en compte la diversité de ces œuvres, de leurs
contextes de référence et de leurs facteurs, limiter les emprunts au modèle
occidental donné comme norme et sous-estimer les capacités à interpréter les
modèles étrangers, proches et lointains.
Cet ouvrage interroge cette vision réductrice et cette appropriation de l’Occident
et la confronte à travers de nombreux exemples aux modes d’expression et de
performance artistiques dépassant les chefs-d’œuvre des arts visuels souvent
donnés comme seuls représentatifs en s’intéressant avant tout aux artistes, à
ce qui fonde leur expérience et leur pratique artistiques, à ce qu’ils en disent.
Annie Dupuis
est ethnologue, diplômée de psychologie, vidéaste. Elle a travaillé au musée de
l’Homme et a effectué de nombreuses missions au Gabon et au Togo ; ses recherches portent
entre autres sur la culture matérielle et la muséologie, l’histoire des arts et la probléma-
tique de la création. Elle a enseigné à l’École du Louvre et à l’École doctorale du Muséum
national d’histoire naturelle, a conçu des expositions d’art et d’ethnologie, a réalisé des
films primés dans des festivals internationaux et est l’auteur de plusieurs ouvrages et de
nombreux articles.
JAcques ivAnoff
est ethnologue au CNRS. Il a été le premier chercheur détaché à l’Institut
de recherche sur l’Asie du Sud-Est en Thaïlande, d’où il a dirigé un projet de collaboration
scientifique entre le CNRS et l’université Prince de Songkla. Il a collecté plusieurs centaines
d’heures de littérature orale chez les Malais du sud de la Thaïlande et chez les Moken,
créant ainsi un vaste corpus. Il a réalisé des documentaires, organisé des expositions, et
est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. Il travaille maintenant sur l’art ainsi que sur
les migrations.
Isbn : 978-2-7351-1298-2
36 ¤
Ethnocetrisme et création Sous la direction de Annie Dupuis

Ethnocentrisme et création

Sous la direction de
Annie Dupuis
avec la collaboration de Jacques Ivano
Ethnocentrisme et création
Éditions de la Maison des sciences de l’homme

Relecture
Laurent Bruel et Nathalie Fourrier
Suivi éditorial
Nathalie Fourrier et LucTesnière
Mise en page
LucTesnière et Mélodie Leblois
Illustration de la couverture
Tapis en sachets en plastique.
Meadowlands, Soweto, Afrique du Sud.
Long : 110 cm
Acquis en 1988. Collection particulière.
© Cliché Manuel Valentin, 2001
© 2013
Éditions de la Maison des sciences de l’homme
ISBN : 978-2-7351-1298-2
Imprimé en France

Sommaire
Avant-propos 9
Annie Dupuis
Présentation 11
Annie Dupuis
Première partie
Discours et regards
Arts traditionnels et histoire(s) 37
Annie Dupuis
Contribution à l’étude des masques du Gabon 61
Jean-Claude Andrault. Entretien avec Yves Le Fur
réalisé en 1998 à partir de ses notes de terrain
et revu par les auteurs en 2013.
Mort et créativité dans la tradition des amazones du Dahomey 67
Suzanne Preston Blier
De l’œil et du goût. Histoires de connaissances et de reconnaissance 81
sur le marché de l’art primitif
Solen Roth
Étoiles lantes. La parabole des terres cuites anthropomorphes 101
du Delta intérieur du Niger (Mali), années 1940-1990.
Cristiana Panella
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
1
/
108
100%