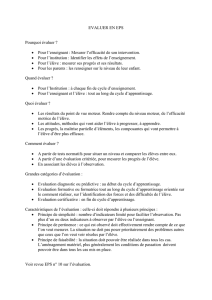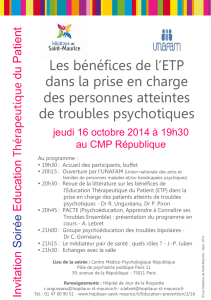Quelle place pour l`éducation thérapeutique du patient dans son

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm
L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 243–6
RÉHABILITATION (1re PARTIE)
Quelle place pour l’éducation thérapeutique
du patient dans son parcours de rétablissement
au sein des services de secteur ?
Olivier Canceil 1, Dominique Willard 2, Claire Calmejane 3, Bénédicte Louvion 4,
Carole Garcia 5, Nathalie Christodoulou 6, Rachel Bocher 7
RÉSUMÉ
L’approche psycho-éducative du patient et de sa famille proche, qui est une démarche d’éducation thérapeutique du patient
(ETP), permet d’améliorer l’adhésion aux soins, l’autonomisation et le rétablissement, ce que de nombreuses études ont
montré. Cette approche a été intégrée dans la pratique des équipes en psychiatrie, ce dont le congrès Reh@b 2012 a pu
témoigner. L’ETP a ainsi été inscrite comme priorité du projet d’établissement 2011-2015 de l’EPS Maison-Blanche à
Paris, avec la constitution d’une équipe transversale et d’une équipe opérationnelle, multiprofessionnelle, qui intervient
dans la conception des programmes, l’information et la diffusion des programmes au sein des pôles, l’animation des séances
éducatives comme de l’accompagnement des patients dans le parcours éducatif. Le CATTP du secteur 44G05 de Nantes a
pu structurer un programme d’éducation thérapeutique « vivre et comprendre sa maladie », sans renoncer aux références
psychodynamiques qui structurent son approche clinique sous la forme d’un groupe de parole, proposé à des patients
psychotiques « jeunes dans la maladie » et présentant des potentialités d’évolution psychodynamique, mais structuré
sous la forme d’un programme de six séances. Enfin, l’expérience parisienne du programme Profamille est née d’une
coopération entre des professionnels de l’hôpital Sainte-Anne, des familles de l’Unafam et de l’association Schizo...Oui !
et a rapidement intégré l’équipe de l’EPS Maison-Blanche qui souhaitait approfondir l’offre qu’elle proposait déjà aux
familles. Les équipes franciliennes proposant le programme Profamille se fédèrent actuellement pour offrir une offre lisible
et accessible sur le territoire de la région. La psycho-éducation familiale permet développer des savoir-faire et savoir-être
et constitue l’outil le plus adapté pour sortir les familles de l’ornière profonde où elles s’enlisent sans cette aide, de leur
propre aveu.
Mots clés : éducation thérapeutique, psycho-éducation, famille, prise en charge
ABSTRACT
What is the role for therapeutic patient education in the course of recovery within the services sector? The psycho-
educational approach to the patient and their immediate family, which is a process of therapeutic patient education (TPE)
permits to improve adherence to care, as well as empowerment and recovery which is essential as shown in many studies.
This approach has been integrated into the practice of many teams in psychiatry, as evidenced by the Reh@b 2012
Congress. TPE has therefore been listed as a priority 2011-2015 establishment project of the Public Health Institution
(PHI) - Maison-Blanche School in Paris, with the training of a cross-functional team and an operational team, that are
1Psychiatre, secteur 75G17, centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France
<olivier[email protected]>
2Psychologue, SHU, secteur 75G14, centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France
3Unafam Paris, 101, avenue de Clichy, 75017 Paris, France
4Cadre supérieur de santé, secteur 75G29, EPS Maison-Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris, France
5Psychiatre, secteur 75G29, EPS Maison-Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris, France
6Psychiatre, Secteur 75G23, EPS Maison-Blanche, 4, avenue de la Porte-de-Saint-Ouen, 75018 Paris, France
7Psychiatre, secteur 44G05, CHU site Saint-Jacques, 85, rue Saint-Jacques, 44093 Nantes cedex 1, France
Tirés à part : O. Canceil
doi:10.1684/ipe.2013.1045
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013 243
Pour citer cet article : Canceil O, Willard D, Calmejane C, Louvion B, Garcia C, Christodoulou N, Bocher R. Quelle place pour l’éducation thérapeutique du patient dans
son parcours de rétablissement au sein des services de secteur ? L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 243-6 doi:10.1684/ipe.2013.1045
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm
O. Canceil, et al.
multi-professional, not only involved in the design programmes, information and dissemination programmes within centres,
but also in the promotion of educational sessions such as patient support in their educational development. The Part-
time Therapeutic Care Centre of the 44G05 at Nantes University Hospital was able to structure a therapeutic education
programme called “Live and understand their illness” without giving up the psychodynamic references which structure
their clinical approach in the form of a discussion group, proposed to psychotic patients called “Young in the Disease”
and offering not only the potentialities of a psychodynamic evolution, but also a structured in the form of a programme
of six sessions. Finally, the Parisian experience of the Profamily programme is the result of co-operation between Sainte-
Anne Hospital professionals, families of Unafam (Help Family and Friends of the Mentally Ill) and the “Schizo... Yes!”
Association etc. also quickly integrated into the PHI - Maison-Blanche team that wished to extend its offer that has already
been proposed to families. These Paris area teams that offer the Profamily programme are now merging to put forward a
readable and accessible offer in this geographical area. The family psycho-education permits to develop “know-how” and
“how to live”. This constitutes the most suitable tool to lift families out of their deep rut where they become stuck without
this assistance, by their own admission.
Key words: therapeutic education, psycho-education, family support
RESUMEN
¿ Qué lugar para la educación terapéutica del paciente a lo largo de su recorrido de restablecimiento dentro de los
servicios del sector ?. El enfoque psicoeducativo del paciente y familia cercana, – enfoque de educación terapéutico del
paciente (ETP) que permite mejorar la adhesión a los cuidados, la autonomización y el restablecimiento – es primordial, lo
que han demostrado numerosos estudios. Este enfoque se ha integrado en la práctica de numerosos equipos en psiquiatría,
de lo que pudo dar fe el congreso Reh@b 2012. Así es como la ETP pudo inscribirse como prioridad en el proyecto
de establecimiento 2011-2015 de la EPS Maison-Blanche en París, con constitución de un equipo transversal y de un
equipo operacional, multiprofesional, que interviene en la concepción de los programas, la información y la difusión del
programa dentro de los polos, la animación de las sesiones educativas tanto como del acompa˜
namiento de los pacientes
en su recorrido educativo. El CATTP del sector 44G05 de Nantes pudo estructurar un programa de educación terapéutica
“Vivir y comprender la propia enfermedad”, sin renunciar a las referencias psicodinámicas que estructuran su enfoque
clínico bajo la forma de un grupo de palabra, propuesto a unos pacientes psicóticos “Jóvenes en la enfermedad” y con
potencialidades de evolución psicodinámica, perro estructurado bajo la forma de un programa de seis sesiones. Por fin, la
experiencia parisina del programas ha nacido de una cooperación entre algunos profesionales del Hospital Sainte-Anne,
unas familias de la Unafam y de la asociación Schizo...¡ Sí ! y rápidamente se integró en el equipo de la EPS Maison-
Blanche que deseaba profundizar en la oferta que proponía ya a las familias. Los equipos de la región de París que proponían
el programa Profamille están actualmente federándose para ofrecer una oferta legible y accesible a todo el territorio de
la región. La psicoeducación familiar permite desarrollar un saber hacer y un saber estar y constituye la herramienta más
adaptada para sacar a las familias del atolladero en el que se están atascando sin esta ayuda, según confiesan ellas mismas.
Palabras claves : educación terapéutica, psicoeducación, familia, tratamiento
Dans la perspective d’améliorer l’adhésion aux soins,
l’autonomisation et le rétablissement, l’approche psycho-
éducative du patient et de sa famille proche est essentielle
et ses bénéfices ont pu être objectivés par de nombreuses
études. La thérapie psycho-éducative (selon Deleu et
Lalonde, 2001 [2]) englobe éducation (pôle pédagogique),
accompagnement et soutien émotionnel (pôle psycholo-
gique) et apprentissage d’habiletés pour gérer la maladie
et la vie personnelle (pôle comportemental).
Cette approche a été intégrée dans la pratique de nom-
breuses équipes en psychiatrie, ce dont le congrès Reh@b
2012 a pu témoigner. Les infirmiers ont également intégré
l’éducation à la santé à leur prise en charge, ce que permet
leur position privilégiée auprès du patient, en prise avec son
quotidien. Ces approches sont désormais reconnues comme
partie prenante des soins, dans ce que la HAS, comme la
loi HPST, établissent comme l’« éducation thérapeutique
du patient » (ETP).
L’éducation thérapeutique est un processus continu,
intégré dans les soins et centré sur le patient,
comprenant des activités organisées de sensibilisation,
d’information, d’apprentissage et d’accompagnement psy-
chosocial concernant la maladie, le traitement, les soins
(circulaire du 12 avril 2012 [1]). La loi HPST inscrit
l’éducation thérapeutique dans le parcours de soins du
patient, avec pour objectif de rendre le patient plus auto-
nome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et
en améliorant sa qualité de vie.
Un programme d’ETP se déroule en trois grandes
étapes :
244 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm
Quelle place pour l’éducation thérapeutique du patient dans son parcours de rétablissement au sein des services de
secteur ?
– un diagnostic éducatif établi avec le patient ;
– un programme personnalisé selon les besoins des séances
collectives et/ou individuelles ;
– une évaluation individuelle à la fin du programme pour
permettre de faire le point sur la compréhension, les acquis
du patient, de proposer de nouvelles séances si besoin et de
transmettre un bilan au médecin traitant.
L’ETP a ainsi été inscrite comme priorité du projet
d’établissement 2011-2015 de l’EPS Maison-Blanche à
Paris, soutenue par sa directrice des soins, M. Dodero,
comme l’ont exposé B. Louvion et C. Garcia. Dans cette
optique, l’établissement a inscrit dans son plan de formation
une certification de référent en éducation thérapeutique et
une attestation de compétence en ETP afin de constituer des
équipes complémentaires pour des niveaux d’intervention
différents. Une équipe transversale, indispensable dans un
établissement éparpillé sur plusieurs sites, a pour mission
d’harmoniser les pratiques, de mutualiser les moyens et de
diffuser l’information sur l’hôpital et une équipe opération-
nelle, multiprofessionnelle, intervient dans la conception
des programmes, dans l’information et la diffusion du
programme au sein des pôles, l’animation des séances édu-
catives comme de l’accompagnement des patients dans le
parcours éducatif. Trois programmes d’ETP ont ainsi vu le
jour en 2011.
Un autre exemple, celui du CATTP du secteur 44G05 de
Nantes du Dr Bocher, montrait comment une équipe a pu
structurer un programme d’éducation thérapeutique « vivre
et comprendre sa maladie » sans renoncer aux références
psychodynamiques qui structurent son approche clinique.
Ce programme se présente comme un groupe de parole, pro-
posé à des patients psychotiques « jeunes dans la maladie »
et présentant des potentialités d’évolution psychodyna-
mique, mais il est structuré sous la forme d’un programme
de six séances, animées par deux infirmiers et un intervenant
différent (psychiatre, psychologue ou assistante sociale),
articulées autour de thèmes différents concernant la réhabi-
litation du sujet souffrant tels que la maladie psychique, les
médicaments, les conséquences de la pathologie psychique
dans la vie quotidienne, la dimension sociale, la relation aux
autres et à la famille. Le fil conducteur en est de parler de
soi avec les autres, en groupe, à partir d’une thématique
définie. Afin de prévenir les effets de diffusion propres
au groupe, les soignants resituent à chacun la dimen-
sion subjective qui est la sienne. Dans cette dynamique
de restauration narcissique, les bénéfices attendus sont la
remise en route de nouveaux investissements et circuits de
relations.
À Paris, comme l’a montré D. Willard, l’offre
d’information et de conseils destinés aux patients et aux
familles est importante avec de nombreuses conférences,
des groupes de paroles, des groupes de soutien mais qui ne
constituent pas de programme d’éducation thérapeutique et
on ne peut que constater un écart entre le discours et les
pratiques.
Les psychiatres qui n’arrivent pas à informer les familles
du diagnostic de leur enfant sont encore trop nombreux,
comme des représentations inadéquates des familles dans
l’esprit des soignants avec des erreurs d’attribution et une
sur-généralisation, favorisées parfois par des théories psy-
chologiques dépassées.
Les familles souffrent et cette souffrance a des consé-
quences néfastes pour le malade et pour la famille. Elles ont
souvent des idées fausses sur la maladie, sur ses causes, sur
ses symptômes et sur la fac¸on de la prendre en charge. Ces
idées fausses sont celles de la population générale et sont
souvent stigmatisantes, attribuant les troubles du compor-
tement observés soit à l’éducation (responsabilité de la
famille), soit à des traits de caractère du malade (responsabi-
lité du malade). Le retentissement sur la santé psychique et
physique des membres de la famille, sur le fonctionnement
familial global et la qualité de vie est important.
Claire Calmejane (Unafam Paris) a témoigné que pour
les parents, il est possible de dépasser la crainte et de pro-
gresser par la compréhension, tant de la maladie de leur
proche que de leurs propres réactions. Le programme Pro-
famille permet d’effectuer ce passage de fac¸on dynamique,
en acteur de cette amélioration des échanges avec le proche
malade et aussi en acteur de son propre mieux-être.
N’importe quelle maladie grave, invalidante représente
souvent le moment de se montrer patient, tolérant. Devant
la schizophrénie, il faut, en outre selon elle, tenter de deve-
nir plus intelligent : il s’agit de faire son chemin au cœur
d’une relation totalement inattendue avec son proche, une
relation dont on ne connaît pas les règles, ni par intui-
tion, ni par inspiration, ni par aucune autre voie tant que
l’on a pas commencé à frayer avec la psychiatrie, c’est-à-
dire déjà tard. La psycho-éducation, cet apprentissage qui,
certes, est envisageable seulement quand la maladie s’est
faite jour, constitue l’outil le plus adapté à sortir les familles
de l’ornière profonde où elles s’enlisent sans cette aide.
Le programme Profamille s’adresse aux familles de
patients atteints de schizophrénie et est développé dans sa
version franc¸aise dans plusieurs pays d’Europe. Développé
par le professeur Cormier en 1988 au Québec, le pro-
gramme a ensuite été diffusé dès 1991, par Chambon, Deleu
et Favord, grâce au réseau francophone des programmes
de réhabilitation psychiatrique fondé par ces mêmes cher-
cheurs, et utilisé en Suisse dès 1993. En France, c’est
depuis 1998 que l’équipe de Yann Hodé au centre hospita-
lier de Rouffach en Alsace et les membres de l’association
Schizo-Espoir, développent leur expérience du programme,
afin d’en améliorer les techniques d’intervention. Depuis,
d’autres équipes ont rejoint celle de Rouffach, afin de
comparer leurs expériences du programme et d’en amé-
liorer le contenu.
Les objectifs du programme ont été définis en essayant
de répondre aux besoins des familles :
– une volonté d’apprendre à communiquer au sein de la
famille ;
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013 245
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm
O. Canceil, et al.
– savoir établir des limites qui permettraient au malade
d’acquérir des stratégies de réadaptation à la société ;
– pouvoir développer des attentes réalistes ;
– savoir recourir à l’aide nécessaire auprès des profession-
nels ;
– développer et maintenir un réseau de soutien social grâce
aux membres du groupe.
Le groupe Profamille parisien est né d’une coopé-
ration entre des professionnels de l’hôpital Sainte-Anne
(D. Willard, O. Canceil et al.), des familles de l’Unafam
et de l’association Schizo... Oui ! et a rapidement inté-
gré l’équipe de l’EPS Maison-Blanche (N. Christodoulou,
P. Podyma et al.) qui souhaitait approfondir l’offre qu’elle
proposait déjà aux familles. L’implication des différents
acteurs dans le projet médical et de soins d’une future CHT
parisienne a eu un rôle catalyseur en favorisant les contacts
et ce rapprochement. Toutes les équipes franciliennes pro-
posant le programme Profamille se fédèrent actuellement
pour offrir une offre lisible et accessible sur le territoire de
la région.
Conflits d’intérêts : aucun.
Références
1. Circulaire DHOS/DGS no2002-215 du 12 avril 2002 rela-
tive à l’éducation thérapeutique au sein des établissements de
santé : appel à projets sur l’asthme, le diabète et les maladies
cardiovasculaires (texte non paru au Journal officiel).
2. Deleu G, Lalonde P. Thérapie psychoéducative – chapitre 52.
In : Lalonde P, Aubut J, éds. Psychiatrie clinique : approche
bio-psycho-sociale,3
eéd. Boucherville : Gaëtan Morin, 2001,
p. 1342-62.
246 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
1
/
4
100%