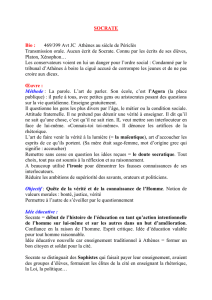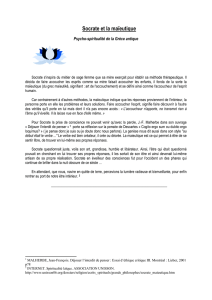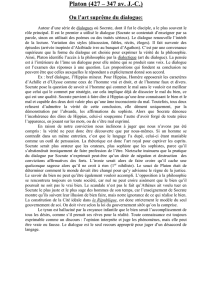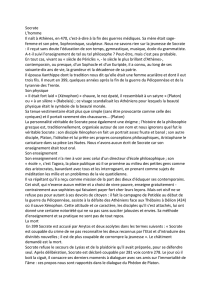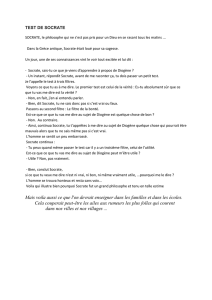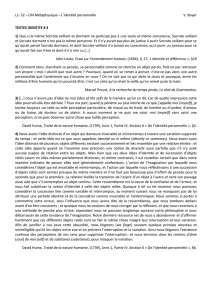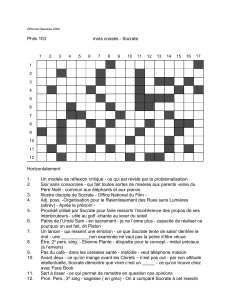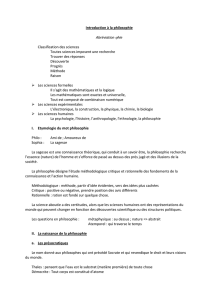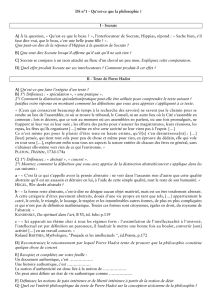La chaîne des vérités

1
LA CHAÎNE DES VÉRITÉS
Sylvain Delcomminette
(Université libre de Bruxelles)
Résumé
Dans le Gorgias, Socrate revendique un idéal de cohérence absolue entre ses propos, d’une part, et entre
ses propos et ses actes, d’autre part. La cohérence est manifestement à ses yeux une condition
nécessaire de la vérité et de la science. En est-elle également une condition suffisante, de sorte que l’on
pourrait qualifier sa position de « cohérentiste » ? La question est difficile : d’un côté, Socrate semble
rejeter cette position en présentant la vérité que la cohérence permet d’atteindre comme seulement
conditionnelle, mais d’un autre côté, il semble franchir un pas supplémentaire dans certains passages en
la présentant comme absolue. Cet article tente de résoudre ce paradoxe en se basant sur la différence
entre réfutation oratoire et réfutation dialectique et en montrant que la cohérence dialectique doit
ultimement s’ancrer dans le désir du bien, ce qui la fait sortir de l’ordre du simple discours.
« Et pourtant, excellent homme, je préférerais que la lyre fût dépourvue d’accord et
dissonante, qu’il en fût ainsi pour un chœur dont je serais le chorège, que la majorité des
hommes fût en désaccord avec moi et me contredise, plutôt que de n’être pas, moi qui suis un,
consonant avec moi-même et de me contredire (ejmautw/' ajsuvmfwnon ei\nai kai; ejnantiva
levgein) »
1
. Par cette déclaration, Socrate manifeste que l’idéal qu’il poursuit est celui d’une
cohérence totale, non seulement entre ses propos, mais également entre ses propos et ses
actes
2
. C’est à l’aune de cet idéal qu’il examine les opinions de ses interlocuteurs, avec le plus
souvent pour résultat de manifester combien ceux-ci en sont éloignés. Pour ce faire, il utilise
la méthode de l’elenkhos, qui consiste à montrer que l’opinion avancée contredit une ou
plusieurs autres opinions que l’interlocuteur soutient également par ailleurs
3
. Socrate, pour sa
part, prétend avec une arrogance assumée que tout ce qu’il dit s’enchaîne « au moyen
d’arguments de fer et de diamant (sidhroi'" kai; ajdamantivnoi" lovgoi") »
4
, selon une
nécessité qui demeure toutefois conditionnée par un fait : celui de l’absence de réfutation
rencontrée à ce jour. Il n’en continue pas moins à avouer ne pas posséder de véritable savoir
sur tout ce dont il est question
5
. La nécessité ici en jeu est bien une nécessité conditionnelle et
non une nécessité absolue : c’est la nécessité de l’enchaînement des différentes propositions
liées par l’argument (lovgo"), qui n’entraîne la vérité de ces propositions que pour autant que
celles dont elles dépendent soient elles-mêmes vraies, ce qui n’est garanti que factuellement,
par le fait qu’elles n’aient pas été réfutées jusqu’à présent
6
.
Le présupposé de cet idéal et de la méthode qu’il fonde est que toutes les vérités sont
nécessairement en accord et s’enchaînent de manière nécessaire. Le Ménon exprimera une
idée similaire de manière mythique en suggérant que la nature tout entière est apparentée et
que l’âme a déjà tout appris, de sorte que « rien n’empêche » qu’en nous ressouvenant d’une
seule vérité, nous retrouvions toutes les autres
7
. L’elenkhos tire la conséquence négative de ce
présupposé, à savoir qu’une proposition qui contredit une autre proposition considérée comme
vraie doit nécessairement être considérée comme fausse. D’un point de vue logique et en
langage non platonicien, on pourrait dire que le principe de non-contradiction est la condition
négative de la vérité. Pour Socrate, ce présupposé est accepté par tous : c’est la raison pour
laquelle le fait de déceler une contradiction ou une incohérence chez son interlocuteur est à
ses yeux une objection dirimante
8
, à tel point qu’il n’hésite pas à affirmer à plusieurs reprises
dans le dialogue que son interlocuteur ne croit pas réellement ce qu’il dit, parce que ce qu’il
dit contredit d’autres opinions qu’il soutient également par ailleurs. Ainsi, au grand désarroi

2
de Polos, il affirme que ce dernier n’a pas déclaré que celui qui fait ce qu’il juge être le
meilleur possède un grand pouvoir – ce qu’il a pourtant bien affirmé
9
–, car une telle
déclaration contredit celle selon laquelle la possession d’un grand pouvoir est un bien pour
celui qui le possède, déclaration également faite par Polos
10
. Plus loin, Socrate va jusqu’à dire
que non seulement Polos, mais tout le reste des hommes considèrent que commettre
l’injustice est pire que la subir et que ne pas être puni est pire qu’être puni
11
, tout en sachant
évidemment très bien que tous affirment le contraire ; mais il considère que dans la mesure où
l’opinion qu’ils professent contredit d’autres opinions qu’ils revendiquent également, ils ne
peuvent la soutenir jusqu’au bout. Calliclès fait lui aussi les frais de ce procédé, lorsqu’il se
voit répondre par Socrate que lui-même, Calliclès, n’accorde pas la thèse qu’il vient tout juste
d’énoncer – à savoir, d’une part, que plaisir et bien sont identiques, et d’autre part, que la
science et le courage se distinguent l’un de l’autre et du bien
12
–, du moins s’il prend la peine
de s’examiner correctement lui-même
13
.
Bien avant les stoïciens, Socrate fait donc de la cohérence une condition nécessaire de
la vérité et de la science. Mais va-t-il jusqu’à en faire une condition suffisante ? Il ne le
semble pas, puisqu’il continue à admettre ne pas savoir, non seulement dans le passage
mentionné plus haut, mais aussi un peu plus tôt, lorsqu’il déclare : « car ce n’est certes pas,
non, en prétendant le savoir, que je dis ce que je dis. Bien au contraire, je cherche, en commun
avec vous ; de sorte que, s’il m’apparaît qu’on me fasse une objection qui compte, je serai le
premier à en convenir »
14
. Reste que de telles objections ne viennent jamais, de sorte qu’en
réalité, Socrate est beaucoup plus sûr de lui qu’il ne le laisse entendre dans ces passages : plus
tôt dans le dialogue, il n’hésite pas à dire à Polos, qui ironise sur la difficulté qu’il y aurait à
réfuter sa thèse selon laquelle ceux qui commettent l’injustice sans en payer la peine sont plus
malheureux que ceux qui sont punis, qu’une telle réfutation n’est pas seulement difficile, mais
impossible (ajduvnaton) : « car jamais on ne réfutera ce qui est la vérité (to; ga;r ajlhqe;"
oujdepote ejlevgcetai) »
15
. Ici, Socrate semble négliger que la nécessité des vérités qui
composent la chaîne qu’il revendique est conditionnée par le simple fait de l’absence de
réfutation à ce jour ; il semble prendre cette absence de fait pour une absence de droit, la
nécessité conditionnelle pour une nécessité absolue. Comment justifier un tel saut ? La
cohérence parfaite de l’enchaînement des différentes thèses socratiques suffirait-elle
finalement à garantir leur vérité ? Dans ce cas, pourquoi Socrate continue-t-il à prétendre ne
pas savoir ? S’agit-il d’une simple feinte ?
Afin de tenter de répondre à ces questions, il convient de commencer par préciser le
sens même de la cohérence revendiquée par Socrate. Pour ce faire, on peut se baser sur ce que
Socrate dit de la réfutation, qui comme nous l’avons vu est son versant négatif. Dans un
passage célèbre de sa discussion avec Polos
16
, Socrate oppose le mode de réfutation oratoire,
pratiqué dans les tribunaux, à celui qu’il privilégie pour sa part. Le premier consiste à
s’appuyer sur « des témoins nombreux et de bonne réputation (mavrtura" pollouv"... kai;
eujdokivmou") », comme si le nombre était gage de la valeur de la preuve. Cette procédure
démocratique par excellence, qui « met aux voix » toute proposition, n’a toutefois « aucune
valeur relativement à la vérité », car rien n’empêche de produire de faux témoins en grand
nombre, y compris parmi les personnes de bonne réputation, qu’ils soient d’ailleurs eux-
mêmes dupes de leur propre erreur ou non. De tels procédés n’ont pas de prise sur Socrate,
qui considère que le seul témoin digne d’être pris en compte est celui-là même que l’on
prétend réfuter – lui-même si c’est Polos qui cherche à le mettre à l’épreuve, ou Polos dans la
situation inverse. C’est dire que l’accord recherché est bien un accord avec soi-même et non
un accord avec la doxa ambiante, dont la force, aussi prégnante soit-elle, ne devient
contraignante que si l’on en a déjà décidé ainsi.
Or il faut remarquer que cet idéal d’accord avec soi-même au mépris de l’opinion de la
foule est également revendiqué par Calliclès, avec la virulence qu’on lui connaît. En effet, ce

3
que Calliclès reproche à Gorgias et à Polos au début de son intervention, c’est d’avoir cédé à
la honte ou au « respect humain » (aijscuvnh), émotion sociale s’il en est, et de ne pas avoir osé
exprimer le fin fond de leurs pensées. Ses mots exacts méritent d’être rappelés : « Gorgias,
disait en effet [Polos], interrogé par toi sur le point de savoir si, dans le cas où, avec le désir
d’être instruit de l’art oratoire, on venait le trouver sans avoir la connaissance de ce qui est
juste, il en donnerait, lui, Gorgias, l’enseignement, a cédé au respect humain (aijscunqh'nai) et
déclaré qu’il donnerait cet enseignement, parce que c’est l’usage et que la déclaration
contraire mécontenterait les gens. Précisément pour avoir accordé cela, il s’est trouvé forcé de
se contredire (dia; dh; tauvthn th;n oJmologivan ajnagkasqh'nai ejnantiva aujto;n auJtw/'
eijpei'n) ; et c’est de cela que tu t’enchantes ! Polos avait raison, à mon avis du moins, de se
rire alors de toi. Or voici qu’en retour c’est à lui d’avoir eu le même sort que Gorgias, et c’est
à moi, du même point de vue, de n’être pas enchanté de Polos, pour la raison qu’il a convenu
envers toi qu’il est plus laid de commettre l’injustice que de la subir ; car c’est pour t’avoir
accordé cela que, à son tour, en s’empêtrant dans tes propos, il s’est laissé museler par toi :
parce qu’il a eu honte de dire ce qu’il pensait (aijscunqei;" a} ejnovei eijpei'n) ! »
17
. Pour
Calliclès – et la suite de son discours le confirmera à l’envi –, l’opinion de la foule ne peut en
aucune manière peser dans la balance ; expression d’une réaction défensive des faibles par
nature contre la domination des forts, elle devrait même plutôt susciter d’emblée le soupçon
de sa fausseté. Remarquons que Calliclès laisse entendre que si Gorgias et Polos avaient
exprimé ce qu’ils pensaient réellement, ils n’auraient pas sombré dans la contradiction ;
autrement dit, leur pensée profonde est parfaitement cohérente, et les contradictions que
Socrate a cherché à y déceler doivent en réalité être considérées comme des contradictions
entre leur pensée d’une part et l’opinion commune d’autre part. D’après Calliclès, la
conception sur laquelle repose l’art rhétorique de Gorgias est sans doute paradoxale au sens
propre, mais elle n’en est pas moins intrinsèquement cohérente.
On voit donc le progrès accompli lorsque Calliclès entre en scène : comme Socrate,
Calliclès ne se soucie pas de l’opinion commune, et comme lui également, il fait de la
cohérence interne d’une pensée la condition négative de sa vérité. Ce n’est donc pas par ironie
que Socrate le qualifie de « pierre de touche » de la discussion
18
: Calliclès est bien
l’interlocuteur rêvé de Socrate, celui qui dira véritablement ce qu’il pense, et lui permettra dès
lors de garantir certaines vérités de manière définitive. C’est ce qu’affirme explicitement
Socrate : « que, dans la discussion, tu t’accordes avec moi, sur ceci ou cela, ce sera dès lors
quelque chose à quoi nous aurons, toi comme moi, appliqué notre pierre de touche, et nous
n’aurons plus besoin de recourir à une nouvelle épreuve (oujkevti aujto; dehvsei ejpæ a[llhn
bavsanon ajnafevrein) »
19
. Avec un interlocuteur comme Calliclès, qui rassemble les trois
conditions recherchées par Socrate – savoir (ejpisthvmh), bienveillance (eu[noia) et franc-parler
(parrhsiva) –, il devient possible, semble-t-il, de transformer une vérité seulement
conditionnelle en une vérité absolue, en ce que si elle n’est pas réfutée par un tel interlocuteur,
elle ne le sera jamais : le fait devient un droit, et ce précisément parce qu’il s’agit de ne se
baser que sur ce que l’on pense vraiment, indépendamment de toute autre considération.
Pourtant, Calliclès ne se révélera pas à la hauteur des attentes de Socrate. Alors que ce
dernier vient de préparer le terrain en lui citant plusieurs exemples de plaisirs que Calliclès
aurait manifestement honte
20
de qualifier de bons et lui demande s’il continue à affirmer
l’identité du bon et du plaisant, il répond : « Eh bien, afin de ne pas rendre mon argument
incohérent (i{na dhv moi mh; ajnomologouvmeno" h\/ oJ lovgo")
21
si je dis qu’ils sont distincts,
j’affirme leur identité »
22
. À quoi Socrate répond : « Tu mets à mal, Calliclès, ce qui a été dit
précédemment, et, si vraiment tu dois parler d’une façon contraire à ce que tu penses, il te sera
impossible de soumettre, en commun avec moi, les choses à l’examen de ce qu’elles valent
(kai; oujk a]n e[ti metæ ejmou' iJkanw'" ta; o[nta ejxetavzoi", ei[per para; ta; dokou'nta
sautw/' ejrei'") ! »
23
. À première vue, la réaction de Socrate paraît étonnante : Calliclès n’a-t-il

4
pas eu raison de résister au sursaut de honte qui l’a surpris et à privilégier la cohérence de son
propos ? Si Socrate lui en fait grief, c’est parce qu’il soupçonne que Calliclès a cessé
d’exprimer ce qu’il pensait vraiment au plus profond de lui-même. Ici se révèle la différence
entre la cohérence interne revendiquée par Calliclès et celle recherchée par Socrate. Calliclès
vise à produire un discours non-contradictoire ; la cohérence à laquelle il prétend est certes
interne, mais seulement interne au discours lui-même ; relativement à celui qui le prononce,
elle demeure externe. Une telle cohérence s’adresse encore au public, c’est lui qu’elle cherche
à convaincre ; si elle ne consiste plus en l’accord entre le discours et l’opinion commune, elle
vise néanmoins à révéler la virtuosité de celui qui la maîtrise aux oreilles des auditeurs. Les
témoins, évacués par Calliclès en ce qui concerne le contenu du discours, sont réintroduits
comme juges compétents pour évaluer sa forme ; la cohérence d’un discours est un pur
habillage extérieur qui ne garantit aucunement que celui qui le prononce y croie réellement
lui-même. Tout autre est la cohérence recherchée par Socrate, qui ne doit pas seulement
concerner les paroles entre elles, mais aussi les rapports entre les paroles et les actes ; ou
encore, les rapports entre les paroles et la pensée.
Ce contraste est bien marqué dans un passage d’un autre dialogue où cohérence interne
et réfutation sont intimement liées, à savoir le Théétète
24
. Dans ce passage, Théétète remarque
que, à la question que vient de lui poser Socrate, il peut répondre soit affirmativement s’il
cherche à éviter la contradiction et à rester cohérent avec la théorie dont il s’est fait le
champion, soit négativement s’il répond dans le sens qu’il juge convenir à la question
présente (to; dokou'n pro;" th;n nu'n ejrwvthsin). Socrate le félicite d’avoir saisi cette
distinction, et commente : « Si donc, à ce qu’il semble, tu réponds affirmativement, c’est le
mot d’Euripide que tu vas justifier : notre langue sera sans reproche, notre pensée ne le sera
point »
25
. Il poursuit : « Si donc, hommes habiles et sages, nous avions, moi et toi, sur tous les
secrets de la pensée, promené notre examen, nous n’aurions plus qu’à nous offrir le luxe
d’une épreuve mutuelle, qu’à nous confronter, à la mode sophistique, en un combat qui ne le
serait pas moins ; à faire, l’un et l’autre, cliqueter arguments contre arguments ; alors que,
simples gens que nous sommes, notre prime désir sera de considérer directement ce que
peuvent être, en leurs mutuels rapports, les objets de nos réflexions, si, en nous, ils sont
mutuellement d’accord ou tout à fait discordants »
26
. Ce passage met bien en évidence la
différence entre la cohérence sophistique, purement apparente et à visée agonistique, et la
cohérence intérieure recherchée par la dialectique comme démarche méthodique.
Or contrairement à ce que sa première réaction laissait présager, il s’avère que ce n’est
pas une telle concordance entre les paroles et les pensées que poursuit Calliclès, mais bien la
première, purement apparente. C’est pourquoi en définitive, le seul interlocuteur à la hauteur
de Socrate est Socrate lui-même, qui conclura le dialogue en solitaire, sans que cela diminue
en rien la valeur de ce qu’il établit ; car comme le reconnaît Glaucon dans la République, c’est
avant tout pour soi-même que l’on dialogue, pose des questions et y répond
27
. L’intérêt de la
forme dialogique est précisément de s’assurer que l’accord donné à chaque étape est bien réel
et non seulement apparent, de manière à éviter que la pensée tourne à vide
28
; mais elle peut
aussi bien s’exprimer au sein d’une seule et même âme, où elle caractérise la pensée
(diavnoia), définie comme « dialogue intérieur de l’âme avec elle-même »
29
. La meilleure
pierre de touche est encore intérieure, pour autant que l’on soit capable de se soumettre soi-
même à une critique radicale, comme ne cesse de le faire Socrate.
Mais comment ancrer cet accord avec soi-même de telle sorte qu’il soit vraiment
intérieur ? Comment garantir qu’il ne repose pas sur des prémisses qui soient de simples
opinions communes inscrites de manière si profonde en nous par l’éducation que nous avons
reçue et la société dans laquelle nous vivons qu’elles nous paraissent impossibles à remettre
en question ? Ce n’est pas un hasard si l’écart entre Calliclès et Socrate relativement à
l’accord avec soi-même éclate à propos de la question du bien. En effet, avec cette question

5
est introduit quelque chose qui n’est plus seulement de l’ordre de l’opinion, mais de l’ordre du
désir. Que tout le monde désire le bien est un lieu commun dans les Dialogues, comme
d’ailleurs dans la philosophie grecque en général : on pourrait dire que cet énoncé est
analytique au sens kantien, en ce que le bien (to; ajgaqovn) n’est tout d’abord rien d’autre que
l’objet universel du désir de tout homme, parce qu’il est ce dont la possession est capable de
nous rendre heureux. Ce point est particulièrement thématisé dans le Philèbe, mais il est déjà
largement préparé dans les Dialogues précédents, et en particulier dans le Gorgias, où Socrate
établit que tous nos actes, jusqu’aux plus insignifiants – être assis, mettre un pied devant
l’autre, etc. –, sont ultimement motivés par la recherche du bien
30
. Or cet axiome fondamental
a des conséquences non seulement « pratiques », mais également « théoriques » – pour autant
que cette distinction ait un sens chez Platon. En effet, dans un passage célèbre de la
République, Socrate affirme comme une évidence que « quand il s’agit du bien, personne ne
se satisfait des apparences (ta; dokou'nta), mais on cherche la réalité (ta; o[nta), et sur ce
point dès lors tout le monde méprise l’opinion (th;n... dovxan) »
31
. La question du bien est
celle qui exige de faire la différence entre la réalité et l’apparence, entre la connaissance et
l’opinion – et ce, poursuit Socrate, précisément parce que le bien est « ce que poursuit toute
âme et ce en vue de quoi elle accomplit toutes ses actions »
32
. C’est un désir qui nous permet
de sortir de l’opinion, en nous fournissant le point d’ancrage qui permettra d’éviter que
l’enchaînement des propositions auxquelles nous donnerons notre assentiment, aussi cohérent
soit-il, tourne à vide, et que l’accord avec nous-mêmes qu’il nous permettra d’atteindre ne
relève pas de la simple apparence extérieure, mais caractérise les rapports entre nos paroles,
nos actes et nos pensées les plus profondes. Et comme ce désir est universel, il garantit
également la validité universelle de cet enchaînement : paradoxalement, c’est par le plus
subjectif et le plus intérieur que la véritable universalité – par contraste avec l’universalité
apparente de la doxa ambiante – peut seulement être atteinte.
Sur ce point, l’écart entre la conception platonicienne et la conception aristotélicienne
de la dialectique est décisif. La dialectique aristotélicienne est coupée de tout lien avec le
désir ; les principes sur lesquels elle repose restent de l’ordre de la doxa, même s’ils relèvent
de cette catégorie particulière de doxai qu’Aristote appelle les e[ndoxa, c’est-à-dire les
opinions bien considérées « par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui
représentent l’opinion éclairée (toi'" sofoi'"), et pour ces derniers, par tous, ou par presque
tous, ou par les plus connus, exception faite cependant des paradoxes »
33
. On le voit, cela
revient à faire de « l’appel à témoins », fermement rejeté par Socrate, le critère permettant
d’établir la validité d’une prémisse dialectique. La dialectique aristotélicienne se meut dès lors
tout entière dans le royaume de l’opinion et ne peut en aucun cas revendiquer le statut de
science. La situation est bien entendu plus complexe, car il existe selon Aristote un usage de
la dialectique pertinent (et même décisif) pour la science ; dans ce cas, il faut sans doute
comprendre que la vérité des prémisses endoxales est garantie par leur ancrage empirique,
quoique la question demeure discutée
34
. En tout état de cause, la situation est radicalement
différente chez Platon, pour qui l’universalité qui garantit la validité des principes de la
dialectique n’est pas à chercher dans un accord de plusieurs individus quels qu’ils soient, mais
dans un désir fondamental qui va permettre de faire de la dialectique une science, et même la
science suprême.
Mais si le désir du bien est universel, la connaissance de ce qu’est le bien est loin de
l’être, et telle est l’origine de toutes nos erreurs et de tous nos malheurs. Comme j’ai tenté de
le montrer ailleurs
35
, ce problème ne sera définitivement réglé que dans le Philèbe, qui
aboutira au terme d’une enquête dialectique rigoureuse – s’ancrant dans ce désir fondamental
dont elle détermine progressivement l’objet – à définir le bien comme l’unité de la mesure, de
la beauté et de la vérité. À défaut d’y être fondé, ce résultat est toutefois déjà annoncé dans les
Dialogues précédents, et notamment dans le Gorgias où, sans véritable argumentation,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%