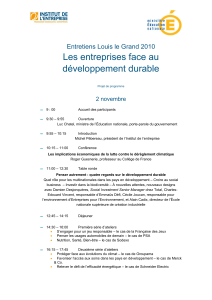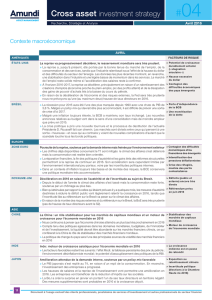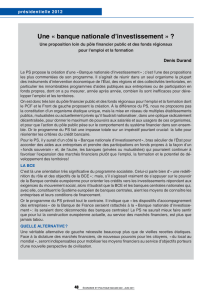EnvironnEmEnt dE taux bas/négatifs, stagnation séculairE… impact

Amundi Discussion Papers Series
DP-15-2016
Avril 2016
ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS/NÉGATIFS,
STAGNATION SÉCULAIRE…
IMPACT POUR LA GESTION D’ACTIFS
Philippe ITHURBIDE, Directeur Recherche, Stratégie et Analyse
Réservé aux investisseurs professionnels


Amundi Discussion Papers Series - D P-15 -2016 3
Résumé
Nous vivons depuis de nombreuses années dans un environnement
de baisse des taux, courts et longs, un environnement lié à la baisse
de l’inflation, à la baisse de la volatilité économique, au fléchissement
des potentiels de croissance, à des politiques monétaires accommodantes…
Les métiers de la gestion d’actifs se sont adaptés graduellement, mais ces
dernières années, un nouveau cap a été franchi : la crise financière a conduit à
un nouveau tassement des potentiels de croissance, à des politiques monétaires
non conventionnelles dont le but avoué était de maintenir les taux d’intérêt courts
et longs à de faibles niveaux (voire même négatifs) afin de contrer les pressions
déflationnistes et de rendre de nouveau solvables des agents trop endettés, et à
une réglementation incitant à acheter et à conserver des obligations d’État. Il est
désormais question de s’adapter à un environnement – potentiellement – durable
de taux bas.
Cet article n’a pas vocation à expliquer pourquoi les taux sont si bas jusqu’à en
devenir négatifs, ni à montrer les effets néfastes des politiques monétaires qui
poussent les taux d’intérêt en territoire négatif, ni même à montrer en quoi les taux
négatifs ont refaçonné les marchés obligataires.
Pour ce faire, nous invitons le lecteur à se référer à nos publications Bertoncini —
Drut (2016), et Ithurbide (2016a, 2016b, 2016c) sur notre site web (www.research-
center.amundi.com). L’objectif du présent article est triple :
Il s’agit d’abord d’évaluer les conséquences de cet environnement sur le modèle
d’affaires des sociétés de gestion. Celles-ci sont nombreuses :
–Revoir la notion d’actif sans risque ;
– Revoir la construction des portefeuilles et notamment le rôle et le poids
des titres gouvernementaux ;
–Revoir le concept de diversication des portefeuilles ;
–Revoir le nombre des fonds qu’il est possible et utile de porter ;
–Revoir la structure des frais de gestion ;
–Optimiser la qualité de l’exécution des transactions ;

Amundi Discussion Papers Series - D P-15 -2016
4
–Mettre l’accent sur les activités de conseil, élément de différenciation.
L’environnement de taux bas a également poussé à revoir à la baisse les espoirs de
rendement des actifs de taux, et donc de l’ensemble des portefeuilles qui intègrent,
par construction ou par précaution, des actifs obligataires. Nous présentons
également dans cet article les différentes solutions permettant d’apporter du
rendement aux portefeuilles :
–Allonger la duration des portefeuilles,
– Accepter un risque de crédit plus grand (davantage de crédit, des notations
plus basses…),
–Ajouter du levier,
–Jouer les distorsions de courbes de taux,
–Rechercher des actifs sous-valorisés car largement délaissés,
– Chercher des actifs à plus haut rendement et à plus faible volatilité
(ABS, infrastructure, dette privée…),
–Ajouter une composante change dans les portefeuilles,
–Capter les primes de liquidité,
–Revoir la construction des benchmarks suivis (approches « Smart Beta »),
–Tirer parti des récents développements dans le big Data/SMART Data an de
mieux capter informations et tendances,
–Mieux évaluer les facteurs d’investissement (approches « factor investing »),
–Investir davantage dans les actifs réels,
–Accepter des portions plus grandes de rendement absolu.
Nous évaluons ensuite les possibilités de sortir de cet environnement de taux bas,
en analysant les facteurs critiques à la hausse des taux (croissance potentielle,
ination, politiques de taux d’intérêt, politiques monétaires non conventionnelles,
politiques budgétaires, réduction des bilans des banques centrales, éclatement de
bulles…), ainsi que les risques de stagnation séculaire et les stratégies d’évitement.
Enn, nous présentons quelques conséquences liées à l’environnement de taux
négatifs sur les « business models » des assureurs, des banques centrales, des
banques et des agences d’émission. Ces implications sont sans doute durables.
En somme, à certains égards, les taux négatifs sont en train de redessiner
l’environnement économique et nancier.
Mots-clés : stagnation séculaire, taux bas, taux négatifs, gestion d’actifs

Amundi Discussion Papers Series - D P-15 -2016 5
Introduction
Quand on parle de taux d’intérêt, on peut en distinguer plusieurs types, fort différents :
des taux de marchés, des taux administrés, des concepts théoriques… :
• Le taux d’équilibre est le taux d’intérêt en ligne avec des fondamentaux ;
• Le taux de marché est celui qui découle des transactions effectives ;
• Les taux court terme et les taux long terme ;
• Le taux directeur est le taux (ou la gamme des taux) administré par la banque
centrale ;
• Le taux naturel est le taux d’intérêt qui équilibre épargne et investissement
quand la croissance est à son potentiel ;
• Le taux neutre : en rythme de croissance potentielle, le taux naturel nominal
neutre est égal au taux réel neutre, plus la cible d’ination de la banque centrale ;
• Le taux nominal est le taux d’un contrat ou d’une transaction ;
• Le taux réel est le taux nominal défalqué d’un indicateur d’ination ;
• Le taux d’actualisation est le taux d’intérêt qui sert, entre autres, à valoriser
les actifs.
Ce qui est remarquable dans la situation actuelle, c’est que tous ces taux ont
fortement baissé, pour des raisons cycliques, pour des raisons structurelles, pour
des raisons liées à la stratégie des banques centrales…
Parmi les facteurs « lourds », structurels, rappelons :
• La baisse de la population en âge de travailler et/ou la baisse des taux
d’activité. On retrouve cela dans la plupart des pays avancés et en Chine,
pays qui est vieux avant d’être riche ;
ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS/NÉGATIFS,
STAGNATION SÉCULAIRE…
IMPACT POUR LA GESTION D’ACTIFS (*)
(*) La première partie de ce Discussion Paper est issue d’une présentation faite avec Marie-Anne Allier
(Deputy Global Head, Fixed Income, Amundi) au Conseil Scientique de l’AMF en février 2015. Elle
sera publiée dans la prochaine édition de la revue du Conseil Scientique de l’AMF.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%