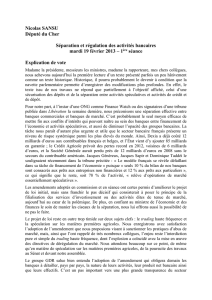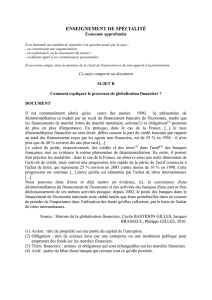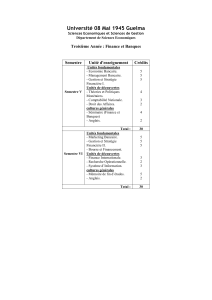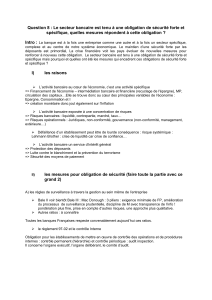Casser la rente bancaire française

!
!
1!
Casser
la rente bancaire
française
Pour un système bancaire plus sûr, plus
concurrentiel, et plus européen
1 MAI 2016

!
!
2!
Résumé
Alors que de nombreux pays se sont engagés dans une remise en question de
la régulation financière, la France se distingue par un débat public sur
l’encadrement des banques quasi inexistant. Les autorités et les banques ont
réussi, malgré la crise, à convaincre l’opinion qu’une réforme du secteur bancaire
n’était pas nécessaire. Mais ignorer ce débat est dangereux.
Qui sait en France que trois des six institutions financières les plus
« systémiques » sont françaises ? Qui se soucie, dans le débat public, de la
surveillance de ces mastodontes financiers ? Dans ce rapport, GenerationLibre
entend contribuer à une prise de conscience de l’opinion sur l’oligopole des banques
et émet des propositions pour rendre le système bancaire français plus vertueux.
L’oligopole bancaire français est dominé par quatre grands groupes financiers
(BNPP, SG, CA, BPCE) dont le total de bilan représente trois fois le PIB. Nos
banques sont devenues des colosses n’ayant plus rien à voir avec les banques
françaises privatisées dans les années 1980 et dont les pratiques anti-
concurrentielles nuisent au consommateur et à la croissance d’ensemble.
Bénéficiant du soutien implicite de l’Etat, l’oligopole bancaire est assis sur
deux rentes pérennes et considérables. La première est alimentée par la garantie
publique implicite dont les grandes banques bénéficient sur leurs sources de
financement. Cette subvention implicite permet aux banques d’échapper à un
« repricing » du risque bancaire et fait porter le coût de ce « business model » aux
contribuables. La seconde, directement préjudiciable pour le consommateur, relève
des mécanismes de sur-tarification des clients captifs : en France, un panier de
service moyen bancaire est supérieur de 14,5% à la moyenne européenne.

!
!
3!
Ce gigantisme bancaire, loin d’être le fruit du hasard, est celui de décisions
publiques. La connivence entre les milieux bancaires et les autorités chargées de
les surveiller est malsaine et porteuse de conflits d’intérêt. L’oligopole français a
véritablement « capturé » et phagocyté le régulateur. Générateur de profits privés
importants en haut de cycle, ce gigantisme peut, par ailleurs, induire des coûts
collectifs énormes en cas de crises. Rien ne justifie la pérennité d’un tel système.
Dans ce rapport, GenerationLibre émet plusieurs propositions visant à casser
les rentes dont bénéficie l’oligopole bancaire et assainir le secteur bancaire
français.
Il est urgent d’introduire plus de concurrence dans le secteur, de permettre à de
nouveaux acteurs d’émerger, de mener à terme le projet d’union bancaire
européenne et de mettre en œuvre une vraie séparation bancaire.
Il est temps de remettre la question bancaire dans le débat public.
!
* * *

!
!
4!
Sommaire
Introduction
I. L’oligopole bancaire français, porteur de risque systémique, échappe
largement au regard critique de l’opinion et des médias
a. L’oligopole bancaire français est dominé par quatre grands groupes financiers
(BNPP, SG, CA, BPCE) dont le total de bilan représente trois fois le PIB
b. Un marché bancaire concentré n’est pas en soi inefficace pour l’économie
mais doit être régulé efficacement pour éviter les comportements de collusion
c. Le secteur bancaire est, pour l’économie dans son ensemble, une source
potentielle de risque systémique que les pays du G20 tentent de mieux
maîtriser depuis 2010
d. En France, le débat public sur la réforme bancaire s’est refermé
II. Une première rente pour l’oligopole bancaire français : la garantie publique
implicite sur les sources de financement
a. Le gigantisme bancaire a été en partie le fruit d’une garantie publique implicite
sur les bilans bancaires
b. Les tentatives récentes de remise en cause du soutien implicite de l’Etat au
secteur bancaire n’ont pas abouti pour le moment à un « repricing » du risque
bancaire
c. Le rôle protecteur joué par la BCE constitue une autre forme de soutien public
III. Une deuxième rente pour l’oligopole bancaire français : la sur-tarification de
clients captifs sur le marché des services financiers de détail
a. Des pratiques anti-concurrentielles présentes partout en Europe
b. La France est particulièrement concernée par le manque de concurrence
dans la banque de détail
IV. Des rentes pérennisées par la capture du régulateur français !
!
V. Casser les rentes pour assainir le secteur bancaire français $
a. L’espoir de l’ubérisation
b. Aller au bout du projet d’union bancaire européenne
c. Mettre en œuvre une vraie séparation bancaire
d. Développer les financements de marché
e. Relancer la politique de la concurrence
VI. Liste de propositions de GenerationLibre pour la réforme du secteur bancaire
Conclusion : remettre la question bancaire dans le débat public

!
!
5!
!
!
Introduction
Les grandes banques françaises ont retrouvé en 2015 le niveau de profit qu’elles
affichaient avant la crise financière. Sur l’année, les six grands établissements ont
généré 23 milliards d’euros de profits, à la grande satisfaction des commentateurs
économiques.
Cet apparent retour à la normale a clos le débat public sur la réforme des banques
en France. Alors que d’autres secteurs se préparent à des changements majeurs
(téléphonie, taxis, transport ferroviaire, énergie, distribution en ligne), le secteur
financier échappe lui aux regards et au débat.
Le monde occidental a pourtant connu en 2008 une crise financière dévastatrice qui,
huit ans après, laisse encore des traces visibles dans nos économies. L’implosion du
système financier mondial, son renflouement en urgence par les Etats (290md€
injectés1 dans les banques en Europe, sans compter les 1200 md€ de garanties
accordées et les 120 md€ dépensés dans le cadre des « bad banks ») et la
récession historique de 2009 (une hausse de 4 points du chômage de 2007 à 2011)
ont conduit, en seulement trois ans, à une très forte augmentation de l’endettement
public (20% du PIB en moyenne) qui pèsera durablement sur la solvabilité des Etats
européens. La crise de 2008 n’était pas seulement anglo-saxonne, contrairement à
ce que les banques continentales veulent maintenant faire croire à l’opinion : entre
2007 et 2010, les aides d’Etat effectivement déboursées en faveur des banques ont
représenté des montants énormes2, 10% du PIB en Allemagne (406md€) et 6% en
France (217md€). Sans ces aides, le système bancaire européen aurait littéralement
fait faillite.
En outre, entre 2010 et 2012, la zone euro a connu une crise majeure qui, là
aussi contrairement aux discours officiels, a été d’abord et avant tout une crise
bancaire. La France n’a pas non plus été épargnée. A l’été 2011, les grandes
banques françaises ont fait l’objet d’attaques sur les marchés très violentes qui, un
moment, ont semblé gagner le marché de la dette publique française lui-même. Le
système bancaire européen n’a dû son salut qu’à une intervention salvatrice à la
limite de la légalité des traités de la Banque centrale européenne. Sans l’injection
massive de liquidités par Mario Draghi à partir de 2012 (LTRO), les banques
d’Europe du sud n’auraient pas été en mesure de rembourser leurs dettes vis-à-vis
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Données rassemblées dans l’excellent et complet rapport Liikanen rendu à la Commission
européenne en Octobre 2012.
2 Pour le Royaume-Uni, ces montants ont atteint 18% du PIB et près de 500md€.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%