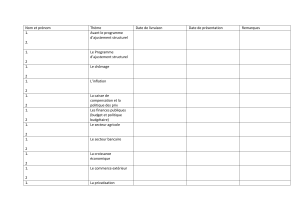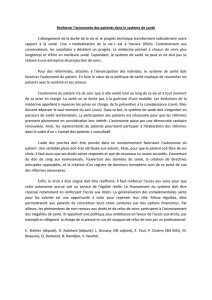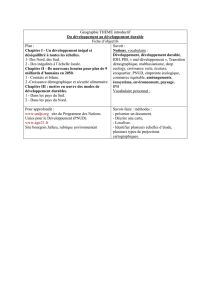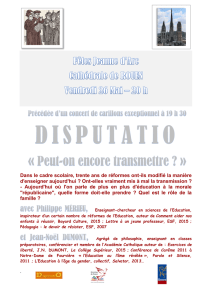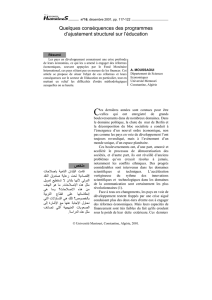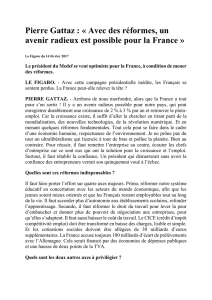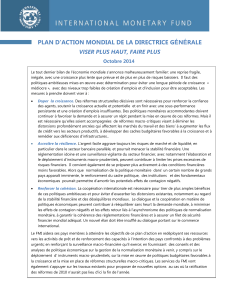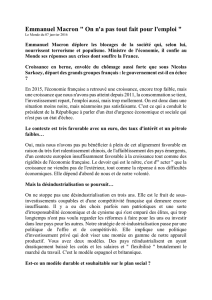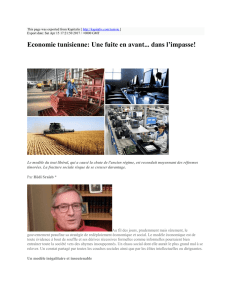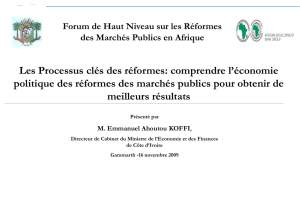Introduction : Les concepts de gouvernance et de - Sen

Introduction : Les concepts de gouvernance et de
développement humain durable et leur genèse
Dans les années 90, très peu de concepts ont suscité autant de discussions et de
controverses, que ceux de «développement humain durable et de bonne gouvernance».
Aujourd’hui, ils ont totalement investi (envahi) le champs de l’analyse économique, politique
et sociale. Non seulement, ils sont présentés comme des critères de bonne gestion qui ouvrent
plus facilement l’accès à certaines ressources des institutions internationales de financement
du développement mais progressivement ils sont déclinés comme éléments d’une probable
conditionnalité dans les relations futures de partenariat avec certains bailleurs de fonds.
Malgré ce rôle clef, ils continuent de susciter beaucoup de débats pas seulement dans le
monde académique mais aussi dans d’autres secteurs d’opinion de la société civile. Cette
importance appelle un certain nombre de clarifications sur la manière dont ces concepts
opèrent dans des économies traversées par de graves crises et qui s’engagent dans des
processus très amples de réformes économiques, politiques et sociales. C’est le cas
notamment du Sénégal qui entreprend depuis une trentaine d’années son redressement
économique et financier à travers une séries de programmes d’ajustement structurel.
L’objectif de ce Rapport National vise à produire un document de référence sur la
gouvernance et le développement humain durable en fournissant une base empirique et
conceptuelle permettant de faire progresser la réflexion sur ces questions. C’est pourquoi
l’option prise et de fournir de manière structurée, le maximum de données et d’informations
susceptibles d’éclairer les situations et d’alimenter le débat national sur les questions
impliquées par la gouvernance et le développement humain durable au Sénégal.
Au paravent, sans entrer dans les débats sur les concepts de développement humain et
de bonne gouvernance, il importe de préciser leur contour pour mieux cerner les réalités q’ils
couvrent réellement.
1°) La notion de développement humain.
En l’espace de dix ans, le PNUD à travers ses Rapports mondiaux sur le
développement humain, a réussi à replacer l’être humain au cœur des débats de la société et
des voix s’élèvent de plus en plus pour réfléchir, et systématiser une approche aussi féconde
et difficile à cerner que le développement humain durable (DHD).
En mettant au centre la croissance économique, la modernisation de nos sociétés
s’accompagne de toutes sortes d’exclusions. Les rapports de pouvoir économique ont
surclassé les préoccupations de bien-être. Et comme le progrès scientifique et technique refuse
le retour en arrière, il faut explorer de nouvelles approches qui puissent entraîner la
mobilisation de tous les secteurs de la société. Cela aura une conséquence sur les réformes qui
permettront une meilleure prise en compte du surplus de richesse créée et faciliteront un large
consensus social par le biais du jeu démocratique. Alors le débat sur le mode de répartition et
de redistribution des richesses se fera sur des bases claires et saines.
Ce sont donc toutes les institutions, les structures, les comportements et les conduites
qui doivent être remis sur le chantier en vue de replacer l’être humain au centre des
préoccupations, en s’attachant à sa dignité comme sujet multidimensionnel et non pas en
simple objet. Autrement dit, c’est l’environnement en entier qu’il faut réajuster à la réalité
humaine. Il apparaît clairement qu’il a fallu au PNUD, un recentrage assez conséquent et une
séparation d’avec les balises du cadre de référence dominant pour s’élever, se hisser et
promouvoir le concept du développement humain durable.

Le concept se définit comme étant un mode de développement qui ne se contente pas
de susciter une croissance économique mais qui en répartit équitablement les fruits, qui
régénère l’environnement au lieu de le détruire et qui permet aux acteurs de s’affirmer et
d’avoir une influence sur les cours de leur existence au lieu de subir ou alors d’être
marginalisés. Il donne la priorité aux pauvres et élargit l’éventail de leurs possibilités et de
leur choix.
Il devient évident qu’à l’orée du troisième millénaire, il est important d’apprécier un
mode d’organisation sociale par sa capacité à allonger une vie, à fournir l’accès au savoir, à
offrir une bonne santé et à renforcer la participation des populations aux prises de décision qui
engagent leur avenir. De telles préoccupations font l’objet de mesures et d’estimations
quantitatives inscrites et traduites à travers différentes indices synthétiques.
Fondamentalement, une pareille approche remet en question les idéologies, les
mythes, les thèses longtemps présents dans nos sociétés. Dès lors, plus qu’une simple notion,
le DHD structure un paradigme. Il fait référence à un système complet de modèles : modèles
de production, modèles de répartition, modèles d’institutionnalisation, modèles de socialisation. Plus
succinctement, il gravite autour d’une série de paramètres qu’on peut ramener à quatre ; la
productivité, la durabilité, l’équité sociale et la maîtrise par les hommes de leur destin.
Par ailleurs, il convient de reconnaître qu’un tel paradigme est plus vaste que les
théories classiques du développement économique, jusqu’ici connues :
◊les modèles de croissance endogène ou autres qui mettent l’accent sur les facteurs de
production et leur articulation dans des fonctions de production réduisent en vue de
l’accroissement pendant une période d’une grandeur de dimension comme le PIB ou le
PNB ;
◊les théories du “Welfare Economics” qui considèrent des usagers et des bénéficiaires de
biens collectifs sans pour autant s’interroger sur leur valorisation en tant qu’acteurs de base
des processus décisionnels ; et
◊la perspective de biens essentiels se penche sur les démunis au mépris de l’expansion des
capacités et des opportunités qui s’offrent aux hommes.
Toutes ces théories ont chacune une faiblesse manifeste tandis que celle du Développement
humain, tire sa légitimité dans une philosophie universaliste, en cela qu’elle se fonde sur le
refus de toute forme d’injustice, d’exclusion et de discrimination. Avec elle aujourd’hui, un
recentrage symptomatique s’est opéré autour de la priorité aux pauvres et de l’élargissement
de leur liberté de choix et leur décision.
En définitive, il s’avère que les deux termes développement humain durable et bonne
gouvernance sont complémentaires et qu’ils n’entretiennent aucune relation d’exclusion.
Mieux, la bonne gouvernance est une condition sine qua none du DHD. La poursuite du
DHD, comme objectif ultime de l’action humaine suppose dès lors le réaménagement de la
manière de gouverner.
2°) La notion de bonne gouvernance
Cela fait une bonne dizaine d’années que le concept de « Bonne gouvernance » a fait
irruption dans le domaine du développement. La notion est apparue en 1989, dans une étude
de la banque mondiale. Elle n’a cessé, depuis , d’être évoquée dans les publications des
chercheurs, les injonction des bailleurs de fonds ou les discours des gouvernements. Comment
expliquer pareil succès aussi rapide ? Pour qu’un concept soit aussi rapidement popularisé
par des milieux aussi divers, il faut qu’il réponde précisément à des préoccupations centrales

du système dont il est issu. On serait donc tenté de croire que l’apparition de la gouvernance
correspond à un changement de paradigme dans la problématique du développement. Il
s’agissait à l’époque, pour les promoteurs des programmes d’ajustement structurel (PAS), de
corriger l’approche « économiciste » de ces programmes et de mettre davantage l’accent sur
l’importance de leur environnement normatif et institutionnel.
Dans les années 90, la dislocation de certains Etats - tant en Afrique qu’en Europe de
l’Est- ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des PAS, ont conduit la
Banque mondiale è redécouvrir la dimension institutionnelle du marché, déjà très présente
chez Adam SMITH On s’est alors enthousiasmé pour les questions touchant au bon
fonctionnement des institutions. L’enjeu consistait à trouver les moyens de faire fonctionner
efficacement les mécanismes de marché, donc d’éliminer les dernières rigidités qui auraient
pu gêner l’ajustement de l’offre et de la demande par les prix. C’est dans un tel contexte,
caractérisé par le regain de vigueur de la théorie institutionnelle du marché et la défiance
persistante vis-à-vis d’une gestion gouvernementale jugée responsable de la crise, que la
Banque mondiale a recouru pour la première fois au concept de bonne gouvernance. Les
distorsions qui caractérisent le fonctionnement des marchés ne pouvaient avoir qu’une
origine, à savoir : les décisions des arbitraires et imprévisibles des Etats. Responsabilité,
transparence, décentralisation et participation, autant de concepts dont l’application n’a
concerné qu’un seul acteur : l’Etat.
Le concept a été par la suite affiné par de nombreuses institutions internationales et
partenaires au développement ( PNUD, Banque Mondiale, OCDE, …).comme cela apparaît
dans l’encadré qui suit :
Encadré 1 : Différentes définitions du concept de gouvernance
Agence Canadienne de Développement International (ACDI) : l’ACDI utilise les termes
«bon gouvernement» ou «saine gestion des affaires publiques» pour désigner la façon dont
un gouvernement gère les ressources sociales et économiques d’un pays. Le bon
gouvernement (ou la saine gestion des affaires publiques) désigne un exercice du pouvoir, à
divers échelons du gouvernement, qui soit efficace, intègre, équitable, transparent et
comptable de l’action menée.
Banque Asiatique de Développement : Pour la Banque Asiatique de Développement, la
gouvernance réfère à l’environnement institutionnel dans lequel les citoyens interagissent
entre eux et avec les agences gouvernementales. Même si les aspects reliées aux politiques
sont importants pour le développement, le concept de bonne gouvernance tel que définie
par la Banque aborde essentiellement les ingrédients reliés à une gestion efficace. La
Banque perçoit la gouvernance comme un synonyme de gestion du développement efficace.
Banque Inter-américaine de Développement : La Banque Inter-américaine de
développement est concernée par les aspects économiques de la gouvernance et la capacité
de mise en œuvre de l’appareil gouvernemental. Ceci implique la modernisation du
gouvernement et le renforcement de la société civile, la transparence, l’équité sociale, la
participation et l’égalité des sexes.
Banque Mondiale : La Banque Mondiale définit la gouvernance comme la manière dont le
pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays, et
dans un but de développement. Cette définition fait ressortir les trois axes de la
gouvernance à savoir : la forme du régime politique, la manière dont l’autorité est exercée
dans la gestion d’un pays, et la capacité du gouvernement à déterminer et appliquer les
politiques.

Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE – CAD). Le CAD utilise une définition de la gouvernance qui rejoint
celle de la Banque mondiale, et qui désigne «l’exercice du pouvoir politique, ainsi que d’un
contrôle dans le cadre de l’administration des ressources de la société aux fins du
développement économique et social».
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Pour le PNUD, il faut
entendre par gouvernance, l’exercice d’une autorité politique (la formulation de
politiques), économique (la prise de décisions à caractère économique) et administrative
(la mise en œuvre de politiques) aux fins de gérer les affaires d’un pays. Suivant cette
définition, la gouvernance repose sur des mécanismes, des processus et des institutions qui
permettent aux citoyens et aux groupes d’exprimer des intérêts de régler des litiges et
d’avoir des droits et obligations. Le PNUD a de plus, cerné les trois paliers de
gouvernances, à savoir l’Etat qui créée un environnement politique et légal propice ; le
secteur privé qui crée emplois et revenus, et la société civile qui facilite l’interaction
politique et sociale.
Il apparaît alors que la gouvernance renvoie pour certains à une amélioration de la
gestion du secteur public ; une responsabilité économique ; la prédictibilité et l’autorité de la
loi et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour d’autres, elle signifie «bon
gouvernement» caractérisé par les vertus de responsabilité, de légitimité et de compétence
(Banque Mondiale, 1989 ; ODA, 1993). La gouvernance est également explicitement
rattachée à la démocratie (USAID, 1991). Cependant, une autre tentative visant à synthétiser
la définition renvoie à la gouvernance en tant qu’exercice de l’autorité politique, économique
et administrative dans la gestion des affaires nationales à tous les niveaux (PNUD, 1997).
Appuyée sur trois concepts clefs : la responsabilité, la décentralisation et la transparence, la
bonne gouvernance a donc consisté dans une sorte de « juridicisation » de l’action publique.
Depuis son apparition la notion de bonne gouvernance est étroitement liée à la
recherche de solutions à la crise de l’Etat avec, cependant, des variantes selon les priorités des
organisations intervenant dans l’octroi et la gestion de l’aide internationale. Or, aujourd’hui,
deux principales conceptions de l’Etat émergent :
1°) la vision jacobine, inspirée de ROUSSEAU, qui repose sur une conception
utopique du pouvoir politique et de la vie démocratique, autrement dit sur un postulat général
de bienveillance des hommes politiques et de l’administration. Cette conception est
caractérisée par l’absence des incitations monétaires et de sanction ;
2°) la conception inspirée de MONTESQUIEU, qui consacre la non bienveillance des
gouvernements et prend compte, à cet effet, l’influence des groupes d’intérêt. L’organisation
de l’Etat est repensée en terme de contre pouvoirs.
La plus ou moins bonne gouvernance étant indéniablement liée à la forme
d’organisation de l’Etat, force est de reconnaître que le modèle jacobin, utile à une certaine
époque, est devenu inadapté voire inefficace à cause essentiellement de la complexité de la
société et de l’économie. Or, les pays africains semblent prisonniers de la vision jacobine dont
ils ont hérité de colonisation française et qui devient un véritable vecteur de corruption
Les institutions internationales sont elles aussi prisonnières de cette vision jacobine.
Les politiques d’ajustement dont elles préconisent l’application prônent une réduction des
salaires réels – déjà très bas – dans la fonction publique, mettent en place des incitations au
départ volontaire des fonctionnaires, incitations dont profitent les employés de l’Etat les plus
dynamiques qui peuvent saisir les opportunités des conditions de travail plus favorables qui
leur sont offertes hors de la fonction publique (le secteur privé).

La théorie du choix public, et la nouvelle économie publique dont elle fournit une
marque,ypothèse que les décideurs politiques ne sont guidés que par la poursuite de l’intérêt
général. En lieu et place de cette vision platonique, la théorie du choix public insiste sur le fait
que ces décideurs, comme on le suppose dans la théorie économique standard, se comportent
comme «l’homo-économicus» : ils maximisent leur bien être économique personnel.
Sans doute, il serait excessif d’aller jusqu’au bout de la logique de la nouvelle
économie politique qui déboucherait sur ce que Jagdish Bhagwati 1989 a appelé «le paradoxe
du déterminisme » (paradox determinacy). Si les politiciens et les bureaucrates déterminent
leurs actions dans le but de maximiser leur bien être personnel, alors l’analyse normative n’a
aucune chance d’influencer la politique.
Il faut s’interroger sur les conditions préalables à la mise en place des politiques de
bonne gouvernance qui sont dans une large mesure liées à l’application des politiques
économiques profondes dont l’Afrique a besoin. En effet, le schéma de la bonne gouvernance
est appliqué aux pays en développement en général et à l’Afrique en particulier sous
l’instigation des partenaires au développement et des institutions internationales. Des efforts
louables sont entrepris en Afrique pour mettre en œuvre la bonne gouvernance ; ils sont
orientés vers plus de participation, de responsabilité, de décentralisation et de transparence.
De nombreux programmes visant à étendre le champ de la responsabilité publique (politique
ou administrative) ont été mis en œuvre ces dernières années. Les donateurs ont voulu, tout à
la fois, rapprocher les décisions du lieu de leur mise en œuvre et accroître la soumission au
droit des autorités publiques et ce tant au niveau local que national, à travers la
décentralisation le contrôle de légalité qui l’accompagne, comme par le truchement de
mesures tendant à renforcer l’indépendance de la justice. Ils ont cherché à obtenir une plus
grande transparence, via l’appui aux médias indépendants, la publication des procédures de
passation des marchés publics, ou l’appui à la création de structures d’observation des
élections. L’ensemble de ces stratégies a contribué à promouvoir et à renforcer l’Etat de droit,
support essentiel de la bonne gouvernance.
En définitive, il s’avère à l’analyse que les deux termes développement humain
durable et bonne gouvernance sont complémentaires et n’entretiennent aucune relation
d’exclusion. Mieux, la bonne gouvernance est une condition sine qua none du DHD. La
poursuite du DHD, comme objectif ultime de l’action humaine suppose dès lors le
réaménagement de la manière de gouverner. Elle va alors se présenter sous 4 volets à partir
desquels, il devient possible d’évaluer les performances de chaque pays ; le volet politique qui
concerne la participation au processus électoral ainsi les procédures qui orientent ces
élections, un volet institutionnel relatif à l’existen,ce te les performances des institutions, un
volet économique et un volet social.
Le volet institutionnel constitue aujourd’hui un enjeu important de la recherche et un
volet déterminant de la bonne gouvernance. Comprises comme des ensembles complexes de
normes, de règles et de comportements, les institutions sont conçues pour des fins collectives.
C’est pourquoi, elles sont souvent assimilées à des organisations c’est-à-dire des unités de
coordination ayant des frontières identifiables et fonctionnant de façon relativement continue
en vue d’atteindre des objectifs partagés par les divers acteurs de la vie économique, politique
et sociale. L’Etat et son administration, les marchés et les ONG sont au cœur même du
dispositif institutionnel. Quelles sont leur composition et leurs principales missions
particulièrement dans les réformes économiques et politiques ? Le volet institutionnel
comprend les éléments suivants : la création d’une commission électorale indépendante ;
l’existence d’un médiateur ; l’auditeur général ; la direction des crimes économiques et de la
corruption ; la commission des droits humains ; une autorité indépendante pour les médias ;
l’existence d’une société civile active, etc. Cependant, le simple fait de créer ces institutions
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%