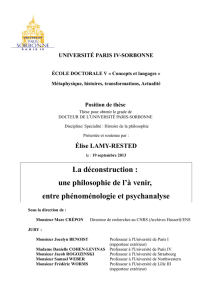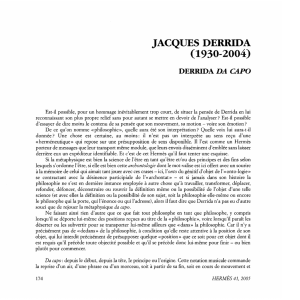Hommage à Jacques Derrida -ce qui nous revient.

1
Hommage à Jacques Derrida
-ce qui nous revient.
par Charles Ramond
ramond.charl[email protected]r
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
1
L’hommage que je me propose de rendre à Jacques Derrida (décédé le 09
octobre 2004) ne se situera pas principalement sur le plan personnel ou affectif. Si
j’ai connu personnellement Derrida, en effet, ce fut de trop loin, comme élève à l’ENS
dans le début des années 80, puis, de temps à autre, comme organisateur de
conférences, pour pouvoir m’autoriser d’une réelle familiarité. Il s’agira donc plutôt
d’un hommage philosophique. Non pas cependant une série de louanges, ou une
recension de ce en quoi Derrida a été justement selon moi reconnu comme un des
philosophes les plus marquants du XXème siècle –encore qu’il sera légitime sans
doute de rappeler ici et là tel ou tel thème. Non : la mort même de Derrida, me
semble-t-il, nous oblige à poser une question philosophique à laquelle d’une certaine
façon il n’a jamais cessé de penser : qu’est-ce que ça change, d’avoir à parler d’un
philosophe mort plutôt que d’un philosophe vivant ? Telle sera donc aujourd’hui,
encore grossièrement présentée, ma question : une interrogation quelque peu
circulaire, où réflexive, sur la possibilité même de rendre hommage à quelqu’un
comme Derrida sous prétexte qu’il est récemment décédé. En quoi cet hommage, je
m’empresse de préciser, d’atténuer ce qu’une telle question pourrait avoir de
choquant, en quoi cet hommage, donc, devrait-il être différent de celui que, parmi
bien d’autres en France et dans le monde entier (peut-être moins nombreux en
France qu’on aurait pu l’attendre) je lui ai souvent rendu, ne serait-ce qu’en
l’enseignant régulièrement depuis plusieurs années, en publiant des conférences sur
son œuvre, des lectures ou des présentations de ses textes
2
? Telle sera ma
1
Conférence prononcée à la Société de philosophie de Bordeaux, le 4 mai 2005.
2
Voir notamment Le Vocabulaire de Derrida (Paris : Ellipses, 2001) ; Derrida-La
Déconstruction (Paris : PUF, 2005), et la conférence « Spinoza – Derrida » publiée d’abord en ligne
sur http://spip.univ-poitiers.fr/philosophie/IMG/rtf/Spinoza_Derrida-Ramond.rtf, et reprise sur plusieurs
sites comme par exemple http://hyperspinoza.caute.lautre.net/article.php3?id_article=1287.

Hommage à Jacques Derrida - Ce qui nous revient.
2
première question. Il semblerait absurde et dénué de bon sens de soutenir que cette
mort ne fait aucune différence. Et pourtant, Derrida lui-même, sa vie durant, n’a
jamais soutenu autre chose. Si bien que nous sommes aujourd’hui dans une position
assez semblable, toutes différences maintenues par ailleurs, à celle des disciples de
Socrate qui, comme le raconte le Phédon, veulent absolument pleurer Socrate, en
contradiction performative directe avec eux-mêmes puisque, comme Socrate le leur
rappelle à plusieurs reprises tantôt avec bonhomie, tantôt avec une pointe
d’agacement, il a passé sa vie à leur enseigner qu’il serait absurde et ridicule de le
pleurer le jour de sa mort, comme s’il leur fallait choisir entre être des disciples et
pleurer leur maître :
1. « ‘—Nous mettrons donc tout notre zèle, dit Criton, à suivre ton conseil.
Mais comment devons-nous t’ensevelir ? —Comme vous voudrez, dit-il, si
toutefois vous pouvez me saisir et que je ne vous échappe pas’. Puis,
souriant doucement et tournant en même temps les yeux vers nous, il
ajouta : ‘Je n’arrive pas, mes amis, à persuader à Criton que je suis le
Socrate qui s’entretient en ce moment avec vous et qui ordonne chacun de
ses arguments. Il s’imagine que je suis celui qu’il verra mort tout à l’heure, et
il demande comment il faudra m’ensevelir. Tout ce long discours que j’ai fait
tout à l’heure pour prouver que, quand j’aurai bu le poison, je ne resterai plus
près de vous, mais que je m’en irai vers les félicités des bienheureux, il le
regarde, je crois, comme un parlage destiné à vous consoler et à me
consoler moi-même » (Phédon 115 C-D, traduction de E. Chambry, GF)
Socrate, dans ces dernières lignes, fait allusion à une courte scène du début
du dialogue, dans laquelle les disciples ont demandé à Socrate de leur raconter
encore une fois pourquoi il ne fallait pas avoir peur de la mort : sans doute ils le
savaient déjà, mais souhaitaient l’entendre encore une fois, comme des enfants qui
aiment qu’on leur raconte, pour les rassurer, et au moment où la nuit va tomber sur
eux, une histoire qu’ils connaissent pourtant parfaitement :
2. « ‘Je vois bien [...] que Cébès et toi, vous seriez bien aises d’approfondir
encore davantage la question, et que vous craignez, comme les enfants,
qu’au moment où l’âme sort du corps, le vent ne l’emporte et ne la dissipe
réellement, surtout lorsqu’à l’heure de la mort le temps n’est pas calme, mais
qu’il souffle un grand vent’. Sur quoi Cébès, se mettant à rire : ‘Prends que
nous avons peur, Socrate, dit-il, et tâche de nous persuader, ou plutôt
imagine toi, non que nous ayons peur, mais que peut-être il y a en nous un
enfant que ces choses-là effraient, et tâche de le persuader de ne pas
craindre la mort comme un croquemitaine. –Eh bien, dit Socrate, il faut lui
chanter des incantations tous les jours, jusqu’à ce qu’il soit exorcisé. –Où
trouver, Socrate, répliqua-t-il, un bon enchanteur contre ces frayeurs, quand
toi, dit-il, tu nous abandonnes ?’ » (Phédon 77D-78A).
Socrate ne se fit pas prier, mais, comme on sait, les disciples pleurèrent
quand même :
3. « Jusque-là nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos
larmes ; mais en le voyant boire, et quand il eut bu, nous n’en fûmes plus les
maîtres. Moi-même, j’eus beau me contraindre ; mes larmes m’échappèrent
à flots ; alors je me voilai la tête et je pleurai sur moi-même ; car ce n’était
pas son malheur, mais le mien que je déplorais, en songeant de quel ami

Hommage à Jacques Derrida - Ce qui nous revient.
3
j’étais privé. Avant moi déjà, Criton n’avait pu contenir ses larmes et il s’était
levé de la place. Pour Apollodore, qui déjà auparavant n’avait pas un instant
cessé de pleurer, il se mit alors à hurler et ses plaintes fendirent le cœur à
tous les assistants, excepté Socrate lui-même. ‘Que faites-vous là, s’écria-t-il,
étranges amis ?’ » (Phédon 117B).
Eh bien, je crois que nous sommes à notre
façon
, aujourd’hui, placés devant
le même type de contradiction par l’auteur à qui nous voulons, nous voudrions rendre
hommage après sa mort, comme s’il y avait là, dans ce passage, une raison toute
particulière de composer et de prononcer un pareil « hommage ». Comme les
disciples de Socrate, nous savons bien que nous ne devrions pas le faire, que c’est
contraire à la philosophie que nous voulons louer. Et comme eux cependant, nous
aimerions sans doute qu’on nous raconte encore une fois ce que nous savons peut-
être déjà, à savoir pourquoi il ne devrait y avoir aucune raison particulière de rendre
hommage à Jaques Derrida juste après sa mort, parce qu’au fond de nous-même,
même si nous le savons, nous avons du mal à le croire. C’est donc cette histoire, ou
plutôt ce sont donc ces raisons, que je m’apprête à vous redire aujourd’hui, ici et
maintenant, pour commencer.
-I-
Les thèmes les plus originaux de la philosophie de Derrida, en effet, telle
qu’elle se constitue dans la fin des années 60, et qui font immédiatement de lui un
philosophe de première importance, peuvent être considérés comme autant
d’expressions variées d’une thèse principale : à savoir, la liaison d’essence, ou, pour
employer un langage moins métaphysique, l’équivalence généralisée entre l’écriture
et la mort. Prise en elle-même et pour elle-même, d’ailleurs, cette idée qu’il y a
quelque chose de mort dans l’écriture, que rien par exemple ne ressemble autant à
une bibliothèque qu’un cimetière (puisque ce sont tous deux des lieux de mémoire,
où l’on range côte à côte des objets parallélépipédiques portant des noms propres et
enveloppant les traces d’une présence), cette liaison de l’écriture et de la mort, donc,
est aussi ancienne que la philosophie, et sans doute que l’écriture elle-même, et est
au fond une idée assez naturelle, spontanée, et en cela assez populaire : « les
paroles s’envolent, les écrits restent », nos écrits sont en effet assez comparables à
nos restes.
Si elle ne faisait que reprendre cette liaison traditionnelle de l’écriture à la
mort, la philosophie de Derrida ne serait certainement pas originale. Si elle l’est
cependant, comme je le crois et comme je vais essayer de le montrer à grands traits
dans le début de cet « hommage », c’est que d’une part elle réactualise le thème de
la liaison écriture-mort de façon particulièrement systématique (je n’hésiterai pas à
prononcer ici ce terme), et que d’autre part elle en fait le point d’appui archimédien,
ou le point de bascule qui lui permet de remettre en question (de « déconstruire »,
pour parler comme le fait Derrida) justement la plupart des philosophies de la
tradition métaphysique, et au premier rang desquelles celle de Platon, qui pourtant
n’avait pas manqué de signaler, nous y reviendrons, la liaison de l’écriture et de la
mort, pour critiquer le discours écrit (Socrate n’écrit pas, c’est le début mythique de la
philosophie elle-même, comme on sait), le discours écrit qui est comme un enfant
sans son père, qui ne peut se défendre car il ne sait pas répondre aux questions
qu’on pourrait lui poser, ce discours écrit qui est donc comme un discours mort.

Hommage à Jacques Derrida - Ce qui nous revient.
4
De quelque façon qu’on prenne les choses, en effet, la philosophie de
Derrida me semble fondamentalement hantée par une intuition centrale, selon
laquelle il ne saurait y avoir de signification, ou de sens, qu’à la condition d’une
absence. En cela, elle s’oppose frontalement à la construction métaphysique par
excellence, celle de Platon bien sûr, mais aussi celle qu’on peut retrouver sous
diverses formes chez Descartes, chez Rousseau, voire chez Husserl, et chez bien
d’autres encore, centralement ou latéralement, construction métaphysique dont
l’énoncé central serait au contraire que le sens ou la signification doivent être
ultimement référés à une présence, sous la forme d’une intuition ou d’un contact
avec le vrai, comme on le voit dans la scène archétypique de la sortie de la caverne
platonicienne -et il ne serait pas difficile de multiplier des exemples pris dans toute
l’histoire de la philosophie.
Pourquoi la condition de possibilité de la signification serait-elle l’absence
plutôt que la présence ? La réponse de Derrida est une sorte d’appel au bon sens et
à l’expérience (par où il est très éloigné, sur ses positions principales, de la préciosité
et de l’obscurité gratuite qu’on lui impute parfois), et pourrait s’appuyer (même si à
ma connaissance il ne le fait pas lui-même) sur une remarque déjà faite par Aristote :
de même qu’on ne peut pas voir ce qui est directement posé sur notre œil, de même
la signification ne peut surgir que dans une certaine distance par rapport à tout
contexte d’énonciation. Telle est l’idée principale, telle est l’harmonique
fondamentale que l’on retrouvera partout chez Derrida. Elle s’appuie sur
l’observation du rôle du langage, qui est de « transporter » de la signification : par
définition, donc, une signification doit pouvoir se produire et produire des effets « loin
de » l’endroit où elle a été émise : elle ne peut donc en aucune façon être liée, ou
« collée », à son contexte d’origine, ou à quelque contexte que ce soit, faute de quoi
elle ne pourrait pas être transportée, et donc ne serait tout simplement pas une
signification. L’idée d’une signification liée à un contexte est tout aussi contradictoire,
à ses yeux, que celle d’un langage privé, ou d’un code qui serait « structurellement
secret » : tout code peut être déchiffré, par définition, tout langage peut être
transporté, ou traduit, par définition, et donc la signification ne peut se produire, ou
requiert comme sa condition de possibilité la plus stricte un certain « arrachement »
au contexte, donc une certaine prise de distance aussi bien vis à vis de celui qui
parle que vis à vis de ce dont il est dit quelque chose. Cette idée toute simple, qu’on
appelle la différence originaire, est une des notions principales de la philosophie de
Derrida, et motive et fonde sa critique de Husserl dans l’un de ses premiers livres, La
voix et le phénomène. Non seulement Derrida considère, en tenant compte de
l’acquis psychanalytique, que toute coïncidence avec soi, avec le monde, ou avec les
autres ne relève et ne peut que relever que du fantasme, mais bien plus, ce divorce
d’avec soi, d’avec le monde et d’avec les autres qui nous interdit à jamais quelque
fusion réelle que ce soit, bien loin d’être un obstacle à la communication ou à la
production de signification, en est la condition de possibilité même. Et, puisque le
mode de (télé)communication dans lequel cette absence joue visiblement ce rôle de
condition de possibilité de la communication est « l’écriture » (puisqu’en effet, par
définition, on n’écrit qu’à quelqu’un d’absent), Derrida va faire de l’écriture le modèle
de toute communication, de toute signification, et il dira : s’il y a production de sens,
c’est qu’il y a absence, et donc c’est qu’on est dans l’écriture : c’est ce qu’il va
appeler l’archi-écriture, qui consiste simplement, on le voit, à considérer toute forme
de communication pourvue de sens, y compris la communication orale, comme une
forme « d’écriture », c’est-à-dire comme une forme de communication « en
l’absence » et non « en présence ». Et, à l’objection de bon sens qui consisterait à

Hommage à Jacques Derrida - Ce qui nous revient.
5
faire remarquer que, lorsqu’on parle à quelqu’un, on est bien en présence de cette
personne, Derrida ferait sans doute remarquer (et là encore le motif analytique serait
déterminant) que rien empiriquement n’est plus faux, et que la plupart du temps,
lorsque nous parlons à une personne qui est en face de nous, elle est bien loin de
nous être « présente », puisque au fond nous ne savons rien de la façon dont elle
reçoit notre discours, si elle nous écoute ou si elle pense à autre chose, si elle
s’ennuie ou si elle s’instruit, etc : c’est l’expérience la plus courante, au contraire, que
de parler à quelqu’un d’absent ; et, ajouterais-je, il n’est pas tellement plus facile de
parler à quelqu’un de présent quand on se parle à soi-même : à qui parle-t-on en
effet dans ce cas ? il est bien difficile de le dire.
De « l’absence » (à soi, au monde, aux autres, au contexte) comme
condition de possibilité de la signification à « la mort », le pas est vite franchi : et
c’est là que nous commençons à retrouver notre thème. Si nous prenons en effet
comme modèle la lettre, ou la « carte postale », nous comprenons immédiatement
qu’une carte postale, une fois reçue, est lisible en l’absence de celui qui l’a envoyée.
L’émetteur est absent lors de la réception du message, et il a écrit précisément parce
qu’il était loin du destinataire, parce que le destinataire était absent au moment de
l’écriture du message. Ce message, quel qu’il soit, et par conséquent tout message
pourvu de sens, flotte donc, pour ainsi dire, entre un émetteur et un destinataire
également virtuellement absents, c’est-à-dire, pour parler clairement, virtuellement
morts.
a) Du côté de l’émetteur : nous pouvons parfaitement recevoir des
messages émis par des morts : la plupart des livres que nous lisons ne sont pas
autre chose. Derrida généralise cette remarque, dès ses premiers ouvrages, en
associant auteur et mort : un auteur est toujours virtuellement mort en tant qu’auteur,
tout simplement parce que, dès qu’il est émis, le message (livre ou lettre) peut être
compris en l’absence de celui qui l’a émis (il est fait pour cela), et donc repousse
immédiatement son auteur vers la mort : ce que j’écris (mes livres, mes lettres),
devant par définition suppléer mon absence, enveloppe donc cette absence, la
suppose, l’indique, la prépare, commence immédiatement (« aussi sec », pour parler
comme Derrida) à se passer de moi, à me nier, à me désigner comme l’absent ou le
mort. En ce sens, tout écrit, comme le dit Derrida dans La Voix et le Phénomène, a
une valeur testamentaire. Toute la culture est comme un immense testament, tout
lecteur est en position d’héritier, et tout auteur à la place d’un mort. Et tout cela
conduit Derrida à voir dans le nom propre, et donc dans la signature, les marques
mêmes de la mort. Ce thème est très présent, naturellement, dans le recueil
« d’oraisons funèbres » (j’emploie ce mot maintenant faute de mieux) paru en 2003
(Chaque fois unique, la fin du monde) et qui nous accompagnera aujourd’hui tout au
long de cet hommage :
4. « Déjà ce livre <The Inverted Bell>, qui fraya tant de voies nouvelles, jouait
gravement et puissamment avec le nom propre, c’est-à-dire avec la mort [je
souligne, CR], et c’est une des choses, parmi d’autres, qui aussitôt
m’impressionnèrent. Car de quoi, de qui, à qui parlons-nous, ici, maintenant,
en son absence absolue, sinon du nom et au nom de Joe Riddel ? Au cours
de la vie même, de notre vivant, comme du vivant de Joe, nous le savons et
le savions déjà : le nom signe la mort et marque la vie d’une ride à déchiffrer.
Le nom court à la mort plus vite que nous qui croyons naïvement le porter. Il
nous porte à une vitesse infinie vers la fin. Il est d’avance le nom d’un mort.
Et d’une mort précipitée qui nous arrive en lui, par lui, sans être jamais
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%