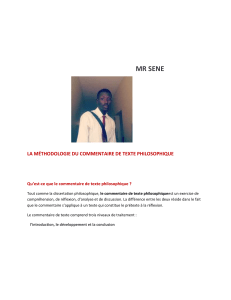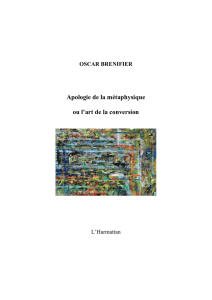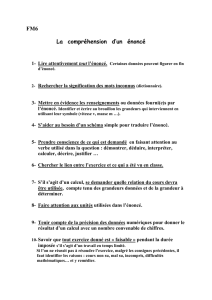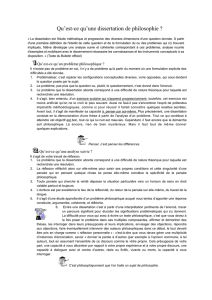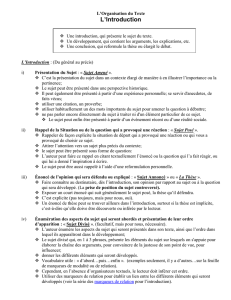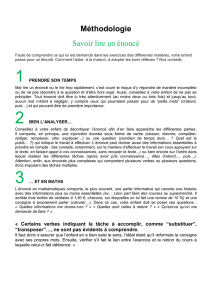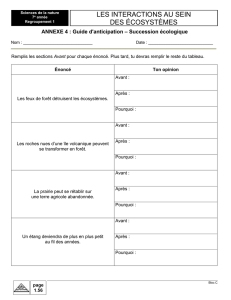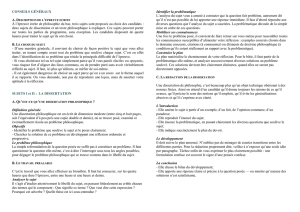Méthodologie de la dissertation

Méthodologie de la dissertation
Si l’on fait des dissertations dans d’autres disciplines que la philosophie, en dépit de quelques
points communs, il convient de commencer par ‘‘oublier’’ pour ainsi dire les méthodes
préconisées dans ces disciplines.
La dissertation philosophique est un exercice de réflexion à la fois personnelle et
informée :
— personnelle parce qu’il s’agit de réfléchir par soi-même dans le but de répondre à la
question posée ;
— informée parce qu’il s’agit, à partir de sa réflexion, de retrouver des auteurs de
philosophie, de nourrir ses propos de référence à des auteurs, c’est-à-dire à des éléments de
doctrines.
Cette double exigence dessine les deux écueils qu’il ne faut pas manquer d’éviter :
— le premier consiste à simplement faire étalage de connaissances tenues pour
philosophiques ;
— le second consiste à ne faire aucune allusion à des connaissances précises.
La dissertation de philosophie n’est donc ni une conversation savante, ni un monologue
indigent : elle est une discussion qui requiert qu’on la rende possible. Elle consiste dans la
mise en évidence, l’articulation problématique, la présentation détaillée et la résolution de
problèmes impliqués par un énoncé.
Règle d’or : avant de rédiger au propre, écrire au brouillon, et avant d’écrire au brouillon,
REFLECHIR, c’est-à-dire se donner le temps de la réflexion !!!
I. La réflexion.
1. Bien lire l’énoncé .
Il convient d’abord de bien lire l’énoncé qui est proposé, de se demander ce qui, en lui,
conditionne le reste – en effet, l’énoncé trouve son sens, non pas tant dans les notions qu’il
contient que dans l’orientation que lui donne sa forme syntaxique.
. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une question, le tout est de savoir apprécier le
caractère problématique de celle-ci, question qui, parce qu’elle lie des notions mises en relation
par un groupe verbal, nous invite à réfléchir à cette relation, à son existence et à sa nature.
Une chose est ici à proscrire : répondre immédiatement à la question. En effet, ce serait
confondre une question avec un problème – les deux termes ne sont pas synonymes, nous
allons y revenir…
. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une combinaison de notions – ’’vouloir et pouvoir’’,
‘‘égalité et liberté’’, etc. -, il s’agit, non pas d’étudier simplement les notions impliquées, mais
d’en sonder dès le départ les implications, autrement dit d’envisager et de questionner les
différents types de rapport possibles entre ces dernières. Ainsi, dans ‘‘vouloir et pouvoir’’, cette
relation de coordination proposée est-elle basée sur un lien :
— d’identité,
— d’analogie,

— d’opposition (contrariété/contradiction),
— de fondation (antériorité chronologique, logique ou métaphysique) ,
— de dépendance, d’influence,
— de causalité (linéaire ou réciproque),
— de condition (facilitante, nécessaire, suffisante),
— de complémentarité,
— d’inclusion, d’exclusion,
— de finalité,
— …,
— voire un non-lien ?
En outre, il est bon de repérer les différents domaines – politique, économique,
mathématique, esthétique, moral, etc. — au sein desquels ces notions prennent sens.
. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une seule notion – ’’La représentation’’, ‘‘Juger’’,
‘‘Douter’’, etc. -, il faut se prémunir d’emblée contre la tentation d’enfermer trop vite le sens du
mot en présence dans un registre strictement philosophique.
Avant d’être un concept – i.e une idée générale dont la définition est modifiée, amendée,
voire créée de toutes pièces par un auteur en fonction d’un problème et d’un cadre
argumentatif déterminés -, un mot est d’abord une notion – i.e est une idée générale de l’usage
courant ou de l’histoire des idées — et possède toujours déjà un univers sémantique qui lui est
propre.
Quand une seule notion est donnée, il convient de le transcrire de manière interrogative –
’’qu’est-ce que la représentation ?’’, ‘‘qu’est-ce que juger ?’’, etc. -, l’énoncé invitant à adopter
comme axe problématique la recherche d’une définition exhaustive, non contradictoire et
synthétique de la notion, en recourant à ses différents niveaux de signification.
2. Transformer le sujet en une interrogation.
Qu’il soit déjà sous la forme d’une question ou non, il faut donc toujours transformer le
sujet en une interrogation portant sur ce qu’on nous demande de penser. Il s’agit de reformuler
le sujet à sa façon pour se l’approprier.
3. Se demander pourquoi cette question nous est posée et problématiser le sujet.
Au regard d’un sujet, il est bon de se demander pourquoi se pose cette question.
→ Exemple de sujet : ”Autrui peut-il m’aider ? “. La réponse immédiate est oui. Pourquoi alors
me pose-t-on cette question ? Quelque chose ne doit pas aller de soi. Et en effet, autrui peut
toujours me conseiller, reste que c’est toujours moi qui au bout du compte ai à choisir et à
assumer la responsabilité de mes choix.
Au regard d’un sujet, il est également bon de se demander ce qui est supposé dans la
question. Il faut se demander quels sont les sous entendus de l’énoncé, ce qu’il faut déjà
admettre pour poser une telle question.
→ Exemple de sujet : “Imaginer, est-ce seulement nier la réalité ?“. Ici, on suppose que
l’imagination est effectivement une négation de la réalité mais que c’est peut-être aussi quelque
chose de plus. Mais est-ce juste, légitime ?
→ Exemple de sujet : “En quoi le langage est-il spécifiquement humain ? “. Ici, on suppose

que le langage est spécifiquement humain et qu’il se différencie donc de la communication
animale. Mais est-ce juste, légitime ?
Il faut bien comprendre que la question elle-même ne fait pas encore problème – qu’elle soit
donnée comme telle dans l’énoncé ou qu’elle soit établie à partir des ou de la notion posée(s)
dans l’intitulé.
En fait, la dissertation de philosophie demande à ce que soit découvert le ou un
problème qui à la fois s’exprime et se dissimule dans une question.
Distinguons question et problème.
Il y a cinq types de questions possibles : les questions d’être, de lieu, de temps, d’ordre et de
cause. On les reconnaît à leur formulation :
— Qui? Que? Quoi? Quel? Lequel? Qu’est-ce? Est-ce que? (Que ç’é qu’ça?!)
Pareille question porte sur l’être, sur l’existence d’un sujet ou d’un objet
— Où? (Où c’é qu’c’é?!)
Pareille question porte sur le lieu, sur l’espace.
— Quand? (C’é quand ç’é que ?!)
Pareille question porte sur le temps.
— Comment? (Comment ç’é que?!)
Pareille question porte sur l’organisation, sur l’ordre, sur l’agencement d’une chose. Elle est
une combinaison de Où? et de Quand? C’est une interrogation esthétique, éthique et/ou
historique.
— Pourquoi? (Pourquoi ? ou Pour quoi?)
Pareille question porte sur la cause, l’origine ou encore le sens, la finalité d’une chose. C’est
sans doute la question la plus troublante puisque la réponse qu’elle peut apporter génère encore
et toujours une nouvelle question : Pourquoi?. Elle ne s’évanouit que devant l’humour et les
limites de notre imagination.
Pareilles questions ne peuvent prendre une forme philosophique que : 1. si leur forme
interrogative rend possible plusieurs réponses crédibles, 2. si elles interrogent la raison à un
niveau de généralité et d’universalité qui concerne tout homme, et 3. si elles s’articulent à des
notions abstraites du langage.
1. Une question qui n’a qu’une seule réponse possible est en effet d’ordre pratique -factuelle,
scientifique, technique ou juridique— ou religieuse -dogmatique, fanatique. A l’opposé, la
question philosophique, comme un entonnoir inversé, débouche sur une ouverture large; elle
permet une perspective étendue, elle est un point de départ, alors que la question d’ordre
pratique ou religieuse mène à un seul point donné, un aboutissement.
2. Une question qui ne concerne qu’un individu ou un seul groupe sort en effet du cadre de
la philosophie puisqu’elle n’est pas universelle. Elle appelle une réponse spécifique -factuelle ou
juridique— qui s’applique à la situation donnée. Ainsi la question de savoir qui je suis peut avoir
une portée philosophique ou non selon qu’elle nous est posée par un douanier -‘’Qui êtes-
vous?’’— ou un philosophe –‘’Qui sommes-nous’’.
3. Si le langage permet l’expression de la pensée, en aucun cas celle-ci lui préexiste. Toute
question ou réflexion philosophique s’exprime donc dans un discours. Mais tout discours n’est
pas nécessairement une pensée philosophique. Tout dépend ici de sa formulation.

Ceci précisé, on s’aperçoit que toutes les questions ne sont pas philosophiques, notamment
celles qui ne renvoient pas à des problèmes comme les questions factuelles, c’est-à-dire les
questions dont la réponse s’obtient par une observation adaptée de la réalité, des faits -‘‘Quelle
heure est-il ? ‘’.
D’autres questions, en revanche, sont l’expression d’un problème : celles qui ne trouvent pas
de réponses satisfaisantes lorsqu’on a recours à l’observation des faits, soit parce que ceux-ci
sont muets sur la question, soit parce qu’ils offrent une multiplicité de réponses contradictoires
-‘‘Tout homme a-t-il droit au respect?’’. Or telles sont précisément les questions philosophiques
et, par conséquent, les sujets de dissertation. C’est justement ce problème qu’il s’agit de
découvrir et d’exposer. Voilà ce que l’on nomme la problématisation.
4. Problématiser.
La problématisation a pour point de départ le sujet-question et pour point d’arrivée la
formulation d’un problème. Mais qu’est-ce qu’un problème ?
Un problème est une contradiction. Qu’est-ce qu’une contradiction ?
Une contradiction consiste en deux propositions qui paraissent vraies, qui peuvent se
défendre par un ou plusieurs arguments, mais qui s’opposent l’une à l’autre de telle sorte que si
l’une est vraie, alors l’autre est fausse. Une contradiction consiste en deux propositions
incompatibles et qui toutefois semblent vraies toutes les deux. Ou alors, une contradiction
consiste en deux propositions contraires qui semblent aussi fausses l’une que l’autre. Or, étant
contraires l’une à l’autre, elles ne devraient pas être fausses toutes les deux.
Dans les deux cas, le problème consiste en cela qu’il est tout aussi impossible de soutenir
simultanément deux idées parce qu’elles sont incompatibles, que d’en adopter une parce que
l’autre semble tout aussi valable, tout aussi vraie.
Exemple : d’un côté, en tant qu’ils sont des hommes justement, tous les hommes ont droit
au respect. D’un autre côté, il semble bien falloir soutenir que certains hommes ont perdu ce
droit en raison de ce qu’ils ont fait. Dès lors, la contradiction est flagrante :
— ou bien tous les hommes, sans aucune exception, ont droit au respect,
— ou bien certains ont perdu ce droit, donc tous n’y ont pas droit.
Ces deux idées ne peuvent pas être soutenues conjointement.
Pour passer de l’un à l’autre, pour passer de la question — ’’Tout homme a-t-il droit au
respect?’’ — au problème – manifeste dans la contradiction -, il n’y a pas vraiment de méthode,
de technique, mais tout au plus des recettes — aussi faut-il ne jamais perdre de vue qu’il est vain
de croire qu’il existe vraiment une technique de la dissertation : ce serait croire qu’il existe une
technique pour penser.
Trois opérations sont toujours nécessaires. Une fois avoir reformulé le sujet, c’est-à-dire une
fois l’avoir transformé en une question s’il ne l’était pas déjà, il s’agit :
— d’analyser et de tenter de définir les termes de la question, tous, sans exception.
Pour cela, se gardant d’associer hâtivement des références aux notions de l’énoncé, il est bon
de commencer l’analyse en laissant toute considération érudite de côté, pour se consacrer
rigoureusement aux notions elles-mêmes, à leurs significations et aux obstacles qui viennent
troubler l’élucidation de leur véritable statut. Il faut s’appuyer sur leur compréhension
commune, sur leur polysémie, afin d’en faire surgir la complexité, les ambiguïtés. Le seul jeu des
acceptions ordinaires permet souvent de nourrir l’interrogation philosophique. Ce n’est alors

que dans le corps du devoir que le recours aux concepts philosophiques deviendra pertinent,
lorsqu’il s’agira de surmonter certaines difficultés impossibles à résoudre sur le terrain du sens
commun. Il s’agit aussi de spécifier la ou les notions en présence, autrement dit il faut dire ce
qu’elles ne sont pas en faisant un travail de voisinage, établissant des liens avec des notions
proches pour mieux les différencier.
— de questionner la question, c’est-à-dire de mettre en place, autour et à propos de l’énoncé,
des questions ordonnées s’enchaînant logiquement ou se déduisant de la question posée. Ce
sont précisément ces questions qui seront examinées dans le corps du devoir et auxquelles on
devra fournir des réponses.
→ Exemple de sujet : “Une société peut-elle se passer de religion?’’
. Sens du sujet : un milieu humain organisé où se trouvent intégrés tous les individus est-il en
mesure d’exister sans l’institution rendant à Dieu hommage et honneurs ?
. Questions centrales que fait naître le sujet : la religion, une structure nécessaire à l’équilibre
des sociétés et des groupes ? La religion ne tend-elle pas à compenser les impuissances et les
manques des groupes humains et des sujets composant ces derniers ? Les hommes peuvent-ils
vivre sans l’infini et l’absolu?
→ Exemple de sujet : “La science peut-elle tenir lieu de sagesse ?“
. Sens du sujet : l’ensemble des connaissances discursives établissant des lois entre les divers
phénomènes peut-il remplacer une conduite juste et raisonnable ou en fournir le modèle ?
. Questions centrales que fait naître le sujet : toute vérité se réduit-elle à la science ? Toute
connaissance autre que scientifique doit-elle être considérée comme un épiphénomène sans
consistance réelle ? La science est-elle en mesure de légiférer sur toutes choses ?
— de choisir le problème fondamental posé par le sujet.
→ Exemple de sujet : “L’avenir doit-il être objet de crainte ?“
. Sens du sujet : la dimension future du temps, qui contient les événements qui ne se sont pas
encore produits, mais adviendront certainement, induit-elle nécessairement, de ce fait,
l’inquiétude et la peur face à un avenir dont l’inconnu peut paraître plein de menaces ?
. Questions centrales que fait naître le sujet : n’y a-t-il pas une dimension contradictoire dans
l’intitulé du sujet lui-même? L’avenir, n’étant pas donné, ne saurait constituer pour nous un
objet réel, lequel est seul, éventuellement, capable de susciter une crainte. L’avenir ne pourrait-il
être aussi bien porteur d’espoir ?
. Problème fondamental : l’avenir, étant lié à mes possibles, ne doit-il pas être, plutôt qu’objet
de crainte, porteur d’angoisse ?
→ Exemple de sujet : “Quelle est la fonction première de l’Etat ?“
. Sens du sujet : quel est le rôle le plus important joué par l’organisme constitué d’institutions
à l’aide desquelles il régule, oriente la société dont il est ainsi l’organe dirigeant ?
. Questions centrales que fait naître le sujet : L’Etat possède-t-il une fonction ou un rôle ? Ne
désigne-t-il pas, au contraire, une entité parasitaire ? L’Etat, contrainte ou organe fonctionnel,
puissance de vie ou réalité mortifère ? Est-il vraiment nécessaire ? Qu’en attend la société dans
son ensemble?
. Problème : l’Etat est-il un obstacle ou un moyen ? Et s’il est un moyen, au service de
qui/quoi fonctionne-t-il ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%