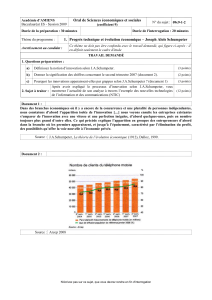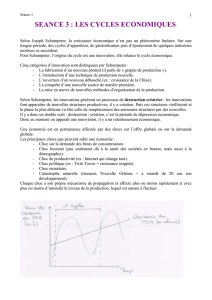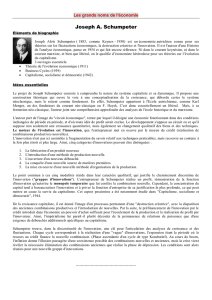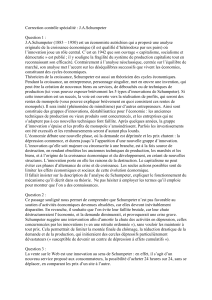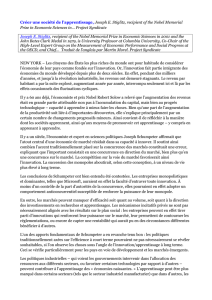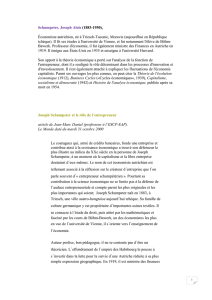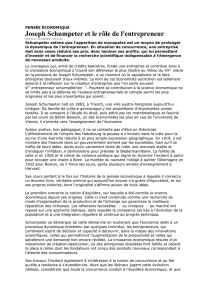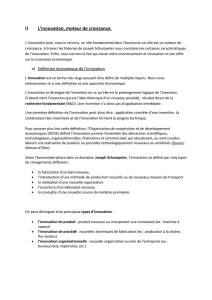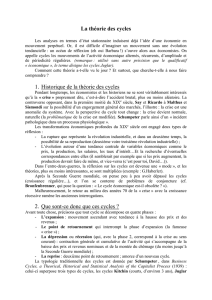scHumpeTer, le propHèTe De l`innovaTion

2ème trimestre 2008 • 153
Prophet of Innovation. Joseph
Schumpeter and Creative Destruction
Thomas K. McCraw
SCHUMPETER,
LE PROPHÈTE DE L’INNOVATION
Jean-marC daniel
Professeur à ESCP-EAP
Entrepreneur schumpetérien, destruction créatrice, innovation, autant de maîtres
mots de l’œuvre de Schumpeter qui sont désormais des outils courants de
la réflexion économique. Pourtant, on connaît en général assez mal ce grand
bourgeois autrichien au destin heurté qui fut souvent négligé de son temps malgré
une énergie à publier et à se faire comprendre qui force l’admiration.
Avec Prophet of Innovation : Joseph Schumpeter and Creative Destruction,
Thomas McCraw nous donne une biographie intéressante et intelligente
de ce géant de la théorie économique que fut Joseph Schumpeter.
Intelligente car elle est écrite ni à charge ni dans un style hagiographique
comme c’est hélas souvent le cas des biographies d’hommes remarquables.
McCraw ne cherche pas à masquer les faiblesses de son héros, mais tente de les com-
prendre. Le lecteur perçoit assez bien non seulement la personnalité de Schumpeter
mais aussi les aspects complexes de la période dans laquelle il a vécu.
Grandeurs et misères du personnage
McCraw rappelle que Schumpeter se plaisait à dire qu’il s’était mis comme objec-
tifs de vie d’être sinon le meilleur, du moins un des meilleurs économistes de son

Livres & Idées
154 • Sociétal n°60
temps, un des plus grands séducteurs et un des meilleurs cavaliers. Et commentant
ces objectifs à la fin de sa vie, Schumpeter déclarait avoir eu des problèmes avec les
chevaux…
Humour aristocratique et d’une certaine façon assez éminemment britannique chez
cet Autrichien qui ne se remit jamais de ne pas être anglais, chez ce bourgeois qui
voulut toute sa vie durant passer pour un dandy de haute volée.
Schumpeter naquit en 1883, la même année que Keynes, l’année où mourut Karl
Marx. Ces deux personnages ont d’ailleurs joué un rôle déterminant dans sa vie et
dans sa carrière dans la mesure où il ne cessa de dénoncer leurs théories comme
lourdement erronées. Et pourtant, malgré le simplisme des idées de Keynes tendant
à faire croire que la ruine des finances publiques assurerait la richesse de la nation
et malgré le caractère imprécis et contestable des thèses marxistes, Schumpeter fut
forcé de constater que ces deux personnages ont occupé le devant de la scène durant
toute sa vie et l’ont relégué au second plan pendant longtemps. « Comme Keynes,
il est possible d’admirer Marx tout en considérant néanmoins que sa vision sociale
est fausse et que chacune de ses préoccupations est fallacieuse », écrivait Schumpeter
pour définir sa pensée à leur sujet.
Si, de son vivant Schumpeter a paru comme effacé par Keynes et Marx, aujourd’hui
il est largement le vainqueur posthume de la comparaison. Mais évidemment, il
l’ignore et le sentiment d’incompréhension qui le minait quand il se comparait à
eux a fait partie des multiples causes de la tristesse générale qui l’accompagnait.
Schumpeter, McCraw insiste régulièrement là-dessus, fut fondamentalement mal-
heureux. Affichant toujours en public une grande sérénité et une certaine aisance
face à la vie, dans son for intérieur, celui que retrace la lecture de son journal ou
l’analyse des confidences qu’il a pu faire ici ou là, on découvre un personnage accablé,
déçu par sa vie et convaincu de n’avoir pas obtenu ce qu’il méritait.
Il faut reconnaître que sa vie fut marquée par de nombreuses tragédies. Il a quatre
ans lorsque son père meurt dans un accident de chasse. La famille Schumpeter est
alors une famille de riches industriels catholiques de Triesch en Moravie. Le destin
du jeune Joseph Aloïs semble scellé, il est appelé à diriger les usines familiales et à
mener une vie respectable et confortable de grand bourgeois de province dans l’Em-
pire des Habsbourg. Mais sa mère devenue veuve en décide autrement : elle quitte
Triesch pour Graz puis Vienne afin de donner la possibilité à son fils unique de se
faire recevoir dans la plus haute société du pays. Elle épouse un général à la retraite,
Eugen von Keler, pour que son fils puisse accéder aux meilleures universités, à celles
réservées à la noblesse germanophone de l’Empire. Ce schéma où une rupture bru-
tale – la mort du père – devient l’occasion d’un dépassement – l’abandon du cocon

2ème trimestre 2008 • 155
familial pour entreprendre une conquête de la capitale – sera celui qui toujours mar-
quera la vie de Schumpeter. Or le moins que l’on puisse dire est que ce schéma s’est
déroulé de façon chaotique.
En effet, après la mort du père, Schumpeter va connaître d’autres déconvenues :
la disparition de la bonne société viennoise à laquelle il aspirait avec la Première
Guerre mondiale ; la mort prématurée de sa deuxième épouse qui restera à jamais
dans ses propos et dans ses longs moments de solitude le symbole du regret d’une
vie qui aurait pu être autre ; la disparition du monde universitaire allemand qui était
sa référence avec l’avènement du nazisme ; la suspicion qui l’entoure alors qu’il est
professeur à Harvard depuis 1932 au moment de l’entrée en guerre des États-Unis
contre le Japon et l’Allemagne du fait de ses origines autrichiennes et de publica-
tions enthousiastes de son épouse d’alors sur l’économie japonaise.
Ambiguïté
Mais McCraw met en évidence un aspect non négligeable dans le déroulement de
la vie de Schumpeter, à savoir qu’à bien des égards ses malheurs furent souvent
liés à son comportement, à l’ambiguïté permanente qu’il a entretenue le concer-
nant. McCraw raconte qu’après un premier mariage assez peu heureux avec une
Anglaise, Schumpeter tombe amoureux d’Annie Reisinger, la fille des concierges
de son immeuble. Amour intense qui heurte sa mère plus ambitieuse sur l’origine
sociale espérée de sa belle-fille ; amour surtout fondé sur un mensonge : il cache
à Annie son premier mariage et lorsqu’il l’épouse en deuxièmes noces en 1925, il
omet de préciser qu’il est déjà marié. Malgré la désorganisation des relations entre
l’Angleterre, patrie de sa première épouse, et l’Autriche vaincue, Mme Schumpeter
hurle depuis Londres à la bigamie et le menace des pires ennuis judiciaires sans qu’il
sache comment réagir.
McCraw raconte que dans les années 1920, banquier audacieux mais finalement
ruiné, il continue à mener grand train, préférant cacher à son entourage qu’il n’a plus
d’argent et vivre de dettes de plus en plus difficiles à assumer.
McCraw raconte comment, professeur chahuté dans son deuxième poste à Graz en
Autriche, il a failli devoir renoncer à toute carrière d’enseignant mais a soigneuse-
ment évité par la suite de faire allusion à son passage dans cette université. Ironie du
sort, jugé trop strict par les étudiants autrichiens, il décide aux États-Unis, quand il
enseigne à Harvard, de se montrer très conciliant et il s’attire la foudre de ses collè-
gues américains qui l’accusent de laxisme.
Schumpeter, le prophète de l’innovation

Livres & Idées
156 • Sociétal n°60
Épisode délicat également que celui de son passage à la tête du ministère des
Finances de la jeune république autrichienne. En 1919, il est le premier ministre des
Finances d’une Autriche diminuée et rongée par l’inflation. Les principaux respon-
sables gouvernementaux sont socialistes, ce qu’il n’est pas. C’est Hilferding, le grand
théoricien de la social-démocratie austro-allemande, qu’il a croisé dans des séminai-
res de réflexion animés par le grand économiste Böhm-Bawerk, qui le recommande
aux nouveaux dirigeants installés à Vienne. Très vite, il se sent en porte-à-faux par
rapport à l’équipe gouvernementale et il accumule les prises de position en rupture
avec celles de ses collègues. Ainsi, quand le gouvernement argue de l’état lamentable
de l’économie autrichienne pour refuser le principe même de réparations versées aux
pays vainqueurs, il accorde une interview dans la presse allemande pour affirmer
qu’il se fait fort, si on le laisse agir, de rendre à l’Autriche sa prospérité d’antan en
quatre ans et donc de la rendre à même de satisfaire aux engagements qu’on prétend
lui imposer.
Ce mélange de provocation, de maladresses et de mensonges aurait pu cantonner
Schumpeter dans un ostracisme hautain et le condamnait à l’oubli. S’il n’en fut rien,
c’est grâce à l’originalité et à la richesse de sa pensée.
Un économiste de génie
Sa première force en tant qu’économiste, c’est d’abord d’avoir énormément tra-
vaillé. Ses déboires privés et notamment la mort après à peine un an de mariage de
sa deuxième épouse l’ont laissé seul et lui ont donné du temps pour lire, méditer,
écrire. Le travail fut sa raison d’être et l’être de sa raison. Sans lui, il aurait pu, selon
McCraw, sombrer dans la folie ou pousser jusqu’à ses plus ultimes conséquences son
état d’esprit suicidaire.
Sa deuxième force est d’avoir toujours voulu se distinguer des autres et d’avoir de
ce fait exploré des domaines ignorés, d’avoir cherché à comprendre des dynamiques
que, par paresse ou par routine, les autres économistes négligeaient.
Sa troisième est évidemment d’avoir eu un talent naturel d’économiste, d’avoir
possédé un sens inné des enchaînements économiques, une capacité incontestable
de distinguer le fondamental et d’ignorer l’accessoire. Schumpeter a longuement
réfléchi à ce qu’est un économiste et à la méthode qui doit le guider. Son premier
constat est que l’économiste doit être mathématicien. Juriste de formation, formé aux
belles lettres – on trouvera sur son chevet au lendemain de sa mort un livre d’Euri-
pide qu’il lisait en langue grecque – Schumpeter défend l’idée de l’indispensable

2ème trimestre 2008 • 157
mathématisation de l’économie. Il est un des fondateurs de la Société d’économétrie
et il insiste auprès de ses étudiants, notamment à Harvard, sur la nécessité d’avoir un
bon niveau en mathématiques. Le deuxième élément de la méthode de Schumpeter
est de toujours appuyer ses thèses sur l’histoire. L’économiste a comme seul champ
d’expérimentation de ce qu’il affirme l’étude de l’histoire. Mathématicien, historien,
sociologue, juriste, tel doit être l’économiste. Et tel fut Schumpeter.
Que reste-t-il de ses recherches ? De plus en plus de choses serait-on tenté de dire,
tant, de fait, se sont effacés les simplismes keynésiens et les délires référencés à Marx.
Schumpeter avait déjà remarqué que les disciples proclamés de ces deux grands
hommes, en trahissant la pensée de leur maître, en soulignaient les limites.
Il reste donc un triptyque quasi magique qui permet de comprendre l’économie
capitaliste, depuis les origines de la révolution industrielle jusqu’à nos jours. Ce
triptyque est constitué de l’entrepreneur, du progrès technique et du crédit. Ce qui a
fait la croissance économique depuis le XVIIIe siècle, c’est d’abord l’existence d’in-
dividus déterminés qui ont utilisé leur volonté, non pas à se détruire sur des champs
de bataille comme pendant la période féodale, mais à construire dans des usines ;
c’est ensuite le progrès technique, l’innovation, la destruction créatrice, expressions
aujourd’hui bien connues, y compris du grand public, qui font de l’économie vue par
Schumpeter une dynamique et non pas un équilibre comme l’équilibre de marché
des économistes classiques ou néoclassiques ou l’équilibre de sous-emploi de Marx
et de Keynes ; c’est enfin le prolongement de cet aspect dynamique dans le domaine
monétaire au travers du crédit et du développement du système bancaire.
L’histoire comme expérience, la destruction créatrice comme mécanique du futur,
autant de façon d’intégrer le temps face à des réflexions économiques théoriques qui
ont souvent eu du mal à le cerner, à le comprendre, à rendre compte de ses consé-
quences. Ce jeu du temps, Schumpeter a cru le décrire de façon quasi exhaustive
dans son livre Business cycles de 1939. Œuvre colossale par son ambition et par son
volume, elle ne rencontre pas à l’époque de sa publication l’écho attendu.
En fait, ce qui va assurer la renommée et la survie intellectuelle de Schumpeter, ce
sont deux livres dont il n’aura pas le temps de voir l’impact. En 1942, Capitalisme,
socialisme et démocratie et en 1954, L’Histoire de la pensée économique sont livrés au
grand public. Ces deux livres, remarquables de clarté et de précision, sont le bilan
d’une œuvre et d’une vie. Leur message subliminal est celui du constat désabusé de
l’échec momentané des valeurs du capitalisme auxquelles croit Schumpeter. Dans sa
Tchécoslovaquie natale, en 1948, les communistes s’emparent du pouvoir avec le sou-
tien d’une partie significative de la population. Ingratitude des peuples qui doivent
leur bien-être au capitalisme et qui ne cessent de le vilipender, qui doivent leur travail
Schumpeter, le prophète de l’innovation
 6
6
1
/
6
100%