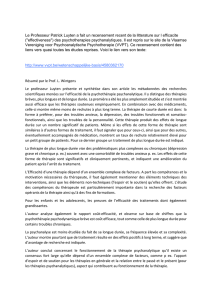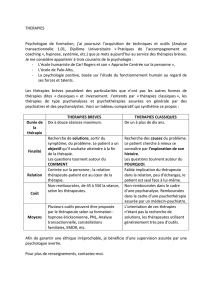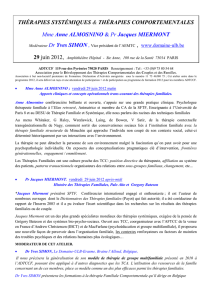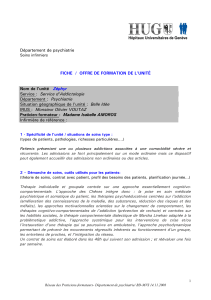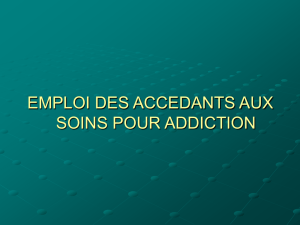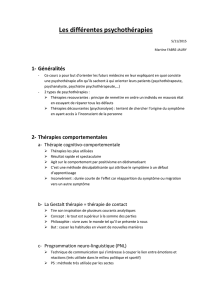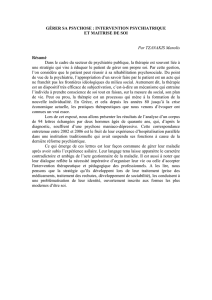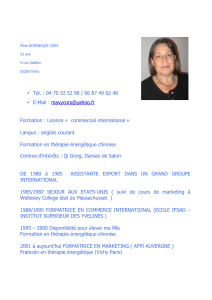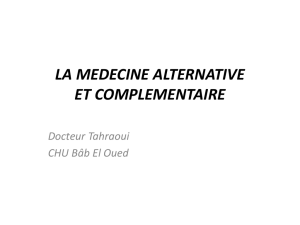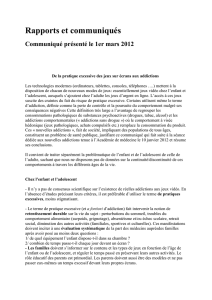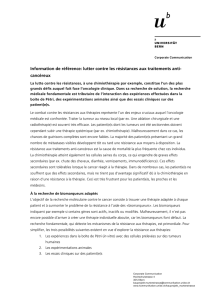Pour une thérapie avecla famille

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012 10
Pour une thérapie avec la famille
Un entretien avec Jacques Miermont*
Propos recueillis par Florence Arnold-Richez et Didier Touzeau
Le Dr Jacques Miermont, 66 ans, psychiatre, psychanalyste et
pionnier de la thérapie familiale, partage son temps entre ses
consultations hospitalières à l’hôpital Paul-Guiraud à Villejuif
et son cabinet libéral dans le XXe arrondissement de Paris. Un
ancien atelier au fond d’une cour si calme et lumineuse, comme
il en existe tant, mine de rien, dans cette capitale agitée. Un
triplex avec une petite salle d’attente, un minuscule bureau
qui tient de l’antre de l’écrivain et du repaire de collection-
neur. Sur les étagères, des statues africaines, des reproductions
d’objets cultes de Tintin, des sortes d’éprouvettes non orientées
qui ne peuvent rien verser, des posters de caïrn et mégalithes
bretons… Prévert en aurait enrichi avec bonheur son célèbre
inventaire… Jacques Miermont, musicien de cœur (ancien Pre-
mier prix de conservatoire à Clermont-Ferrand !), aime le piano,
la psychanalyse et la thérapie familiale. Avec Maurice Porot, il
MUSICIEN, PSYCHANA-
LYSTE ET THéRAPEUTE
FAMILIAL
LeCourrierdesaddictions:
La médecine et la psychiatrie :
une vocation ?
Jacques Miermont : Mon par-
cours est un peu singulier, car je
voulais faire de la musique, et plus
particulièrement du piano et de la
composition. Je jouais Messiaen,
Debussy, Ravel, Beethoven, Cho-
pin, Schumann, puis Boulez, plus
tard Xenakis, Ligeti, etc. Mon père
ne l’entendait pas de cette oreille:
il voulait que je sois dentiste.
J’étais très attiré également par la
psychanalyse. J’ai donc échappé à
l’art du fauteuil dentaire, grâce à
celui du divan et aussi de la méde-
cine ! C’était alors plus ouvert que
la psychanalyse seule ! J’ai donc
fait mes études de médecine à
Clermont-Ferrand, où j’ai travaillé
sur un sujet de thèse qui m’a pas-
sionné : “Contribution à l’étude
du caractère de Beethoven”, dont
j’ai tiré plus tard un livre co-écrit
à l’initiative de Maurice Porot. Je
a publié, il y a bien des années, un “Beethoven et les malenten-
dus” (c’est le cas de le dire !) dans lequel ils se sont livrés à une
étude médico-psychologique du grand Ludwig Van, dans la tra-
dition de la psychologie compréhensive.
Aujourd’hui, il est responsable du pôle de thérapies familiales
du groupe hospitalier Paul-Guiraud. Il en gère directement
l’une des deux unités de consultations familiales, la seconde
étant gérée par Laurent James, pilier, comme lui, de la Société
française de thérapie familiale. Jacques Miermont en est d’ail-
leurs toujours le dynamique président.
Depuis longtemps, il défend et pratique une approche systé-
mique compréhensive, pragmatique, des patients “addicts”, loin
de la “doxa” rigide du cognitivisme comportemental systéma-
tique. Pour lui, il s’agit moins d’une thérapie de la famille qu’avec
la famille. Par une alliance, mieux – une coopération – avec elle.
suis “monté” ensuite à Paris où je
suis devenu “un enfant de la Sal-
pê” chez Duché, Wildlocher, puis
à Sainte-Anne où j’ai fréquenté
assidûment les présentations de
Lacan, avant de rejoindre Paul-
Guiraud à Villejuif (PGV)… Je me
suis rapidement rendu compte
qu’on envoyait assez systémati-
quement tous les patients résis-
tants aux traitements “dans les
secteurs”. J’ai donc voulu voir de
plus près, à Choisy-le-Roi, Orly,
iais, comment les secteurs en
question, particulièrement éprou-
vés par les détresses sociales et
les pathologies psychiatriques
qu’on y rencontre, pouvaient les
prendre en charge. J’ai compris,
sur le terrain, que l’approche fa-
miliale pouvait être particulière-
ment “productive”, qu’on pouvait
faire des thérapies avec la famille
ou en famille, essentiellement à
la demande des professionnels.
J’ai constaté que, lorsque l’on
s’intéresse à la famille, elle est au
rendez-vous, prête à nous aider.
C’est un peu comme si elle fonc-
tionnait comme un instrument
de résonance et de sécurité : en
coopérant avec elle, on diminue
la souffrance du patient et de ses
proches, et, ce faisant, on rend
notre travail plus intéressant. Je
me suis donc formé à la psycha-
nalyse et aux thérapies familiales
pendant une douzaine d’années. Il
faut dire que, en 1975, cette der-
nière approche, très minoritaire,
était mal vue. On la jugeait hos-
tile à la psychanalyse et contre-
venante à la “doxa” officielle ! Par
ailleurs, on percevait les familles
comme systématiquement patho-
logiques, voire pathogènes. Pas
très positive comme approche du
patient et de son entourage!
À partir de 1977, j’ai commencé à
pratiquer des thérapies familiales
dans un service de psychiatrie
de PGV (Choisy-le-Roi, Orly,
ais), ainsi que dans un cabinet
privé, d’abord dans le XIIe arron-
dissement, puis dans le XXe.
Dix ans plus tard, j’ai eu l’oppor-
tunité de créer une fédération en
thérapie familiale pour plusieurs
services psychiatriques, sociaux
et judiciaires dans le Val-de-
Marne : CHS Paul-Guiraud, CHU
Paul-Brousse à Villejuif, CHU de
Bicêtre, ultérieurement fonda-
tion Vallée à Gentilly, Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-
de-Marne, en partenariat avec
les juges des enfants du Palais de
justice de Créteil, et cela pendant
une dizaine d’années.
Depuis 2012, la fédération s’est
réorganisée en pôle de thérapies
familiales du groupe hospita-
lier PGV, inscrit dans le projet
médical de l’établissement, dont
je suis le responsable. Les collè-
gues font appel à nous pour des
patients difficiles, que je tiens à
aller voir dans ces moments “de
crise”, lorsqu’ils sont hospitalisés.
Cela me permet de rencontrer
leurs proches, au plus près d’eux,
sur le terrain, et de créer un lien,
une alliance, dans l’empathie et le
respect de ce qu’ils sont, de leur
façon d’échanger, de fonction-
ner… J’ai aussi ouvert il y a 35 ans
un cabinet où j’ai pu également
prendre en charge, en privé, des
patients avec des pathologies
lourdes, en particulier une famille
confrontée à une jeune fille toxi-
comane, suivie en cothérapie avec
Sylvie Angel.
Le Courrier des addictions :
Vous êtes également enseignant et
chercheur ?
J.M. : Oui, j’ai fondé ensuite, en
1979, une association de for-
mation et de recherche clinique
en thérapie familiale, le Centre
* Psychiatre institutionnel et libéral, psychanalyste, thérapeute familial, président de la
Société française de thérapie familiale, responsable du pôle de thérapies familiales du
groupe hospitalier Paul-Guiraud, Villejuif.
Addict déc 2012.indd 10 10/12/12 11:08

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012
11
d’étude et de recherche sur
la famille à Paris. À ce titre, j’ai
assuré des interventions, forma-
tions et supervisions à Montpel-
lier, Besançon, Metz, Nancy, Cler-
mont-Ferrand, en Guadeloupe,
en Martinique, à Bruxelles et à
Montréal. En 1990, j’ai participé à
la fondation de l’Association eu-
ropéenne de thérapie familiale
et, en 1993, à celle de la Société
française de thérapie familiale.
J’en suis toujours le président.
C’est aussi cette année-là que j’ai
pu soutenir une thèse d’univer-
sité, sous la direction du Pr Jean-
Louis Le Moigne, sur “Les signes
de l’autonomie dans la communi-
cation et la cognition” à l’univer-
sité d’Aix-Marseille III. J’ai, de ce
fait, obtenu, dans cette même uni-
versité, l’habilitation à diriger des
recherches. Depuis 1993, encore,
je participe à l’enseignement des
internes en psychiatrie de la ré-
gion parisienne (CHU de Bicêtre,
CH Paul-Brousse, CH Sainte-
Anne). J’ai également assuré, de
1976 à 1997, un enseignement
de psychopathologie adulte pour
les étudiants de deuxième année
de l’École des psychologues pra-
ticiens à Paris. Depuis, j’enseigne
sur les thérapies familiales pour
les étudiants de cinquième année
de cette école, ainsi que pour les
étudiants de psychologie clinique
en master 2 de l’université de Pa-
ris-V (centre Henri-Piéron).
Actuellement, je poursuis une
recherche clinique sur les psycho-
thérapies dans “une perspective
éco-étho-anthropologique” et une
recherche interdisciplinaire sur
les processus de communication
et de cognition contribuant à l’au-
tonomie des systèmes humains
complexes.
ANIMATEUR
ET MéDIATEUR
LeCourrierdesaddictions:
Qu’entendez-vous par “pers-
pectives éco-étho-anthropolo-
giques” ?
J.M. : C’est toute la probléma-
tique de la cybernétique du self:
elles trouvent leur origine dans
l’œuvre de G. Bateson. En bref:
les conduites humaines peuvent
être appréhendées dans la double
comparaison entre espèces (étho-
logie) et entre systèmes humains
de parenté (anthropologie), ce qui
met en perspective la construction
contextuelle de leurs écosystèmes
de vie et de survie (écologie). Ces
perspectives proposent d’infléchir
le modèle de la pathogenèse intra-
familiale, voire de s’en dégager. La
coexistence de plusieurs formes
de souffrances ou symptômes
ne signifie pas qu’il existe des
relations de cause à effet entre les
uns et les autres. Les addictions
affectent les différents niveaux
d’organisation des processus ri-
tuels (les expériences), mythiques
(les croyances) et épistémiques
(les connaissances) qui agencent
les relations personnelles au sein
de la famille. Les troubles addic-
tifs ne sont pas créés par d’autres
troubles. Ils sont plutôt l’expres-
sion de restrictions concernant
les circuits complets de l’esprit
qui impliquent des modifications
neurophysiologiques, émotion-
nelles et environnementales. Il
apparaît que les responsabilités
éducatives, les traits de caractère,
les interactions intentionnelles
et conscientes ne sont que des
manifestations conjointes à celles
des troubles addictifs. En réalité,
les perturbations qui affectent le
tissage des liens concernent les
niveaux proto-symboliques, qui
court-circuitent la volonté, la res-
ponsabilité, le libre arbitre. Deux
processus cognitifs affectent les
différences informationnelles et
conduisent à des redondances
contraignantes : les acquisitions
relationnelles précoces liées à
l’accoutumance d’une part, les ap-
prentissages par essais et erreurs
d’autre part.
Quand on lit Konrad Lorenz
(1973), on voit que, au-delà des
apprentissages approfondis, nous
sommes traversés, très tôt au
cours de la petite enfance, par
l’empreinte, les sensibilisations
précoces, le rodage des processus
moteurs, l’habituation, la fuite
résultant d’un traumatisme, l’imi-
tation, l’accoutumance. Celle-ci
se caractérise par la connexion
entre la séquence instinctive de
lien et le schéma contextuel dé-
sormais acquis, la globalité de ce
dernier devenant indispensable
au déclenchement de la séquence
coordonnée héréditairement. La
connaissance des familiers, au-
delà du processus d’empreinte,
repose ainsi sur l’accoutumance,
qui rend indispensable le lien
préférentiel avec eux et permet la
différenciation avec les relations
étrangères à l’univers familial.
LeCourrierdesaddictions:
Ces processus ont-ils une tra-
duction biologique durable ?
J.M. : Sur le plan du système ner-
veux central et du système ner-
veux végétatif, le renforcement
indéfectible des liens, pour peu
qu’ils soient sources de plaisir, se
traduit par la sécrétion des mor-
phines naturelles par des neu-
rones spécifiques. Mais comme
le souligne Jean-Didier Vincent
(1986), l’état central fluctuant du
cerveau oscille entre des mouve-
ments de plaisir et de déplaisir.
L’éducation consiste à supporter
l’effort, source d’une certaine
dose de déplaisir, de manière
à accomplir des actions qui
donnent accès à une satisfaction
secondaire qui “vaut la peine” et
qui mérite d’être poursuivie tout
au long du développement psy-
cho-affectif.
Lors d’un recours à la drogue, ce
processus est inversé : l’obtention
du plaisir immédiat lié à la prise
de toxique débouche secondaire-
ment sur une expérience de souf-
france. Les opioïdes artificiels
viennent se substituer aux endor-
phines sécrétées par le cerveau.
L’accoutumance au produit rend
sa consommation toujours plus
contraignante et de plus en plus
importante pour atteindre les
mêmes niveaux de plaisir. Cette
hypothèse est congruente avec
l’observation psychodynamique
selon laquelle la prise de toxique
reproduit artificiellement une
relation symbiotique et régres-
sive à une mère toute puissante.
L’accoutumance au produit vient
remplacer l’accoutumance aux
liens interpersonnels et au dé-
passement de soi par les appren-
tissages symboliques. Dans cette
perspective, l’objectif d’une prise
en charge de la famille consiste
moins à réactiver les situations
supposées traumatiques, qu’à
encourager l’effort de rencontres,
pour retrouver les satisfactions
liées au développement des liens,
sources d’épanouissement.
C’est par rapport à cette pers-
pective que je conçois mon rôle
dans la thérapie avec les familles,
comme celui d’un animateur qui
créé un espace artificiel, théra-
peutique, de rencontre, garant
du dispositif de sécurité, qui
évite qu’elle ne vire au règlement
de comptes… Je suis le médiateur
qui aide le patient à recouvrer
ses états d’avant l’intoxication.
J’essaye de lui faire retrouver
le plaisir de cette rencontre, de
recréer cette accoutumance na-
turelle à l’autre, qui déclenche à
nouveau chez lui la production
de ses endorphines naturelles…
De lui redonner un peu de sens
à la vie. Mais, je ne me pose pas
la question des dysfonctionne-
ments, de la pathogenèse de cette
famille, dont je ne vais pas là,
résoudre le problème, même si
en faisant ce travail, on peut finir
par les “détricoter”. Nos patients
ne cherchent pas à ce qu’on leur
bâtisse un château en Espagne
de 365 pièces. Ils veulent parfois
qu’on leur repeigne seulement
la cuisine ! Leur psychothérapie
n’est pas… leur autopsie psy-
chique !
LeCourrierdesaddictions:
Quelle place peuvent prendre,
dans le cadre de cette ap-
proche, les associations “d’au-
tosupport”, Alcooliques ou
Narcotiques Anonymes, par
exemple ?
J.M. : Il faut penser à mobiliser
toutes les ressources de l’entou-
rage, si c’est possible, et pas seu-
lement celles de la famille au
sens strict. Bateson s’est rendu
compte en son temps que l’impli-
cation des groupes de buveurs
anonymes permettait un travail
thérapeutique plus fondamental
que celui que l’on pouvait faire
avec les familles. Dans le sillon
des Alcooliques Anonymes (AA),
diverses communautés se sont
développées pour venir en aide
aux personnes confrontées à
diverses addictions : Narcotiques
Anonymes (NA), Cocaïnomanes
Anonymes (CA), Anonymous
Gamblers (AG), Outremangeurs
Anonymes (OA), Sexoliques Ano-
Addict déc 2012.indd 11 10/12/12 11:08

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012 12
nymes (SA), Déprimés Anonymes
(DA), Dépendants Affectifs Ano-
nymes (DAA), Enfants-adultes,
de famille dysfonctionnelle ou
alcoolique (EADA), Pharmaco-
dépendants Anonymes (PA), etc.
Ces communautés proposent un
programme en 12 étapes dont
le principe fondamental est que le
sujet doit admettre qu’il a perdu la
maîtrise de sa vie. Il s’agit à la fois
d’un “travail sur soi” et de la dé-
couverte d’une entité supérieure
à soi et d’une appartenance à une
communauté qui lui permet de
développer sa personnalité, dans
un processus de reconnaissance
et de valorisation. La spécificité
de chacun de ces groupes est une
condition essentielle pour que
puisse se construire un proces-
sus d’identification structurant.
Et c’est l’acceptation de la puis-
sance de ce groupe qui provoque
le développement de potentialités
comportementales et psycholo-
giques et de prises de conscience
surprenantes, et souvent ines-
pérées. La valeur thérapeutique
pour chaque personne partici-
pant à l’évolution du groupe tient
en grande partie à ce processus
d’entraide.
Dans le sillage de ces commu-
nautés, se sont développés des
groupes d’entraide, non alcoolo-
dépendants comme Al-Anon, ou
non toxicomanes comme Nar-
Anon, destinés aux familles et
amis des usagers.
En dehors de ceux-ci, peu déve-
loppés en France, les conjoints
ont aussi accès à leurs propres dé-
veloppements dans des groupes
qui leur sont dédiés. Ils leur
permettent de connaître et com-
prendre la maladie du conjoint,
d’apprendre comment se com-
porter avec lui, éviter d’être mora-
lisateur, et surtout à ne plus être
victime de la manipulation liée
aux troubles de la dépendance.
L’EFFET STABILISATEUR
DE LA THéRAPIE
FAMILIALE
LeCourrierdesaddictions:
Les addictions sont-elles une
indication type de l’approche
familiale ?
J.M. : Elles en ont même été
très rapidement une indication
majeure ! Quand on sollicite le
conjoint, la famille, les proches
sur ces sujets qui “partent en
vrille”, lorsqu’ils participent à des
consultations avec eux, on rend
possibles les échanges personnels.
La famille, dans ces cas-là, permet
d’inscrire, dans le temps et en un
lieu, ces sujets qui téléphonent à
3heures du matin quand ils sont
en manque, loupent les rendez-
vous ou se déplacent à des heures
inattendues… La coopération avec
la famille joue un rôle stabilisa-
teur essentiel.
LeCourrierdesaddictions:
Qui est demandeur de la thé-
rapie en famille ? Quelles sont
les options possibles de théra-
pie familiale ?
J.M. : Rarement le toxicomane
ou l’alcoolodépendant lui-même.
Lorsqu’une substance crée une
dépendance toxique, elle n’a pas
seulement des effets délétères sur la
personne elle-même. Aussi, lorsque
les manifestations de violence et
les risques vitaux surgissent, tant
dans la sphère privée, familiale
que publique ou professionnelle, la
demande d’intervention est moins
le fait du consommateur que de
ses proches qui se trouvent par-
ticulièrement démunis, et encore
plus fréquemment des personnes
étrangères directement ou indirec-
tement interpellées par la situation
critique. Dans un tel contexte, les
professionnels impliqués ne sau-
raient attendre que la demande
émerge spontanément du sujet
toxicomane, qui est rarement à
même de s’inscrire dans un cadre
psychothérapeutique donné.
On a donc plusieurs cas de figure:
le patient et les membres de sa
famille qui se sentent concer-
nés consultent d’eux-mêmes ;
le patient et les membres de sa
famille qui se sentent concernés
consultent à la demande d’un ou
plusieurs professionnel(s) ; la per-
sonne toxicomane consulte seule.
Lorsque l’alliance thérapeutique
est acquise, l’intervenant a inté-
rêt à solliciter, avec son accord,
la participation de ses proches
aux consultations ; le thérapeute
et un ou plusieurs membre(s)
d’une même famille consultent
pour la personne toxicomane qui
refuse de participer à une ren-
contre conjointe. Dans ce cas, on
va chercher à créer le climat de
confiance et de sécurité suscep-
tible de rassurer l’absent, par per-
sonnes interposées, et de l’inciter
à se joindre au groupe. Lorsque ce
refus est durable, à l’impossible
nul n’est tenu : on travaille dans
ce cas, sur sa partie souffrante,
qui vit chez les autres, chez ses
proches : c’est son “self social” que
l’on tentera ainsi de soigner.
Bien sûr, la forme que prendra le
processus thérapeutique variera
plus ou moins selon la nature et
les initiateurs de la demande, la
La Société Française de Thérapie Familiale :
bientôt 20 ans
La Société française de thérapie familiale (SFTF),
association loi 1901, a été fondée comme société
savante le 20 janvier 1993. Ses objectifs :
– favoriser le développement des thérapies fami-
liales ;
– promouvoir un niveau de compétence, de qualité
et d’éthique dans la pratique clinique, la recherche, l’enseignement de la thérapie familiale ;
– favoriser la diffusion de l’enseignement des professionnels systémiciens et thérapeutes familiaux français res-
ponsables de leurs pratiques ;
– promouvoir la recherche par les rencontres, les publications, les moyens audiovisuels et autres documents
scientifiques dans ce domaine ;
– échanger l’information concernant la thérapie familiale et l’approche systémique au travers des personnes,
institutions et organisations françaises concernées par les problèmes de santé et le développement des systèmes
familiaux et sociaux ;
– créer des liens avec les autres organisations ayant des buts communs ou compatibles, nationaux et internatio-
naux ;
– faciliter la coopération avec les associations nationales et internationales concernées par les aspects médicaux,
sociaux, légaux, psychologiques, psychanalytiques, culturels, économiques, cognitifs, scientifiques, etc. des sys-
tèmes humains.
La SFTF organise des séminaires, un colloque annuel, des groupes de recherche. Elle est affiliée à la Fédération
française de psychiatre, au Collège pour la qualité des soins en psychiatrie, à l’Association européenne de thérapie
familiale.
Son conseil d’administration : Jean-Clair Bouley, Patrick Chaltiel, Bernard Gébérowicz, Élida Romano, Denis
Vallée, Danièle Roche-Rabreau, Claudine Cany, Charles Heim, Serge Hefez, Patrick Vinois, Jacques Miermont,
Gérard Schmit, Marc Habib, Reynaldo Perrone, Yveline Rey, Patrick Bantman, Michel Maestre, Jean-François
Mangin, Anne Almosnino, Laurent James, Chantale Parret.
Son bureau : président : Jacques Miermont ; vices-présidents : Danièle Roche-Rabreau et Patrick Chaltiel ; secré-
taire général : Jean-Clair Bouley ; trésorier : Marc Habib ; séminaire du lundi : Patrick Vinois et Jean-François
Mangin ; SFTF régions et relations avec l’EFTA : Michel Maestre ; relations avec l’EFTA : Claudine Cany et Yve-
line Rey ; SFTF régions : Charles Heim ; commission affiliation : Bernard Gébérowicz.
La SFTF compte plus de 400 membres. Adresses : 8, rue Édouard-Lockroy, 75011 Paris. 65-67, avenue Gam-
betta, 75020 Paris. Tél. : 01 43 38 16 98. Internet : http://www.sftf.net/
Addict déc 2012.indd 12 10/12/12 11:08

Le Courrier des addictions (14) – n ° 2 – avril-mai-juin 2012Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012
13
solidité de la coopération avec le
patient. Mais, en gros, on distin-
guera les thérapies de la famille et
les thérapies avec la famille ou en
famille. En effet, depuis leur ori-
gine, les thérapies familiales ont
été confrontées à deux options
opposées : la première postule
que le symptôme “addiction” est
l’expression d’un processus qui
se situe au cœur du fonctionne-
ment familial. Les cliniciens vont
donc se focaliser sur la famille,
chercher à en identifier les dys-
fonctionnements, ici et mainte-
nant, ou en remontant plus loin,
voire à plusieurs générations en
arrière. La seconde considère
que le symptôme est lié à une
perturbation de l’organisme de la
personne qui affecte de manière
périphérique la dynamique de la
vie familiale. Elle ouvre “sa focale”
sur les dimensions socio-psycho-
biologiques du trouble. La durée
en sera, elle aussi, très variable :
certains vont nécessiter quelques
séances seulement, d’autres plu-
sieurs années, voire une décen-
nie. Certaines familles reviennent
après quelques années. Il n’y a pas
de règles en la matière.
v
F.A.R.
Bibliographie
− Dictionnaire des thérapies familiales.
Paris : Payot, 1987 ; 2e édition, 2001.
− Écologie des liens. ESF, Paris : 1993;
3e édition revue et augmentée. Paris :
L’Harmattan, 2012.
− L’homme autonome. Paris : Her-
mès, 1995.
− Psychose et thérapie familiale. Paris:
ESF, 1997.
− Psychothérapies contemporaines.
Paris : L’Harmattan, 2000.
− Les ruses de l’esprit ou les arcanes
de la complexité. Paris : L’Harmattan,
2000b.
− érapies familiales et psychiatrie.
Paris : Doin, 2e édition, 2010.
− Ruses de l’humain dans un monde
rusé : identités, unité, complexité. Pa-
ris: L’Harmattan, 2007.
− Rédaction d’une quarantaine de
chapitres dans des ouvrages collectifs,
d’une centaine d’articles dans diverses
revues.
− Reynaud M. Les prises en charge
familiales dans les addictions. In : Ad-
dictions et psychiatrie. Paris : Masson,
2005:268-92.
− Rahioui H et Reynaud M. éra-
pies familiales comportementales et
cognitives et addictions. In : éra-
pies cognitives et comportementales et
addictions. Paris : Médecine-Sciences,
Flammarion, 2006:56-65.
La cigarette fait le lit de l’alcool et des
drogues chez les jeunes hyperactifs
vLe fait de fumer des cigarettes très tôt dans la vie constitue, pour
des jeunes hyperactifs avec troubles déficitaires de l’attention
(TDAH), un facteur de risque avéré de mésusage ultérieur d’alco-
ol, cannabis, cocaïne, crack, etc. Or, plus de 1 jeune hyperactif sur 3 fume
(contre 1 sur 4 chez les jeunes en général), et plus précocement (à 13,9 ans
versus 15,4 ans), 89 % avant l’âge de 18 ans. Pourquoi cet “effet passerelle”
spécifique des cigarettes vers l’alcool ou d’autres drogues chez les jeunes
hyperactifs ? Les auteurs de cette étude, conduite par J. Biederman aux
États-Unis pendant 11 ans sur 165 jeunes TDAH de 6 à 17 ans (versus
374sujets témoins), émettent l’hypothèse que la nicotine pourrait “modu-
ler l’activité dopaminergique dans le système mésolimbique” de ces sujets
qui ont déjà des anomalies de cette activité cérébrale. Cela provoquerait
chez eux un “renforcement positif pour d’autres comportements addictifs”.
Biederman J, Petty CR, Hammerness P, Batchelder H, Faraone SV. Cigarette smo-
king as a risk factor for other substance misuse: 10-year study of individuals with
and without attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2012;201:207-14.
Compte rendu dans le Journal International de Medecine (www.jim.fr)
Eviplera®, nouvelle trithérapie
à comprimé unique (STR)
vAprès la mise à disposition de Viread
®
, Emtriva
®
, Truvada
®
et
Atripla
®
, Gilead, engagé dans la lutte contre le VIH, lance en
France Eviplera
®
. Cette association de 3 antirétroviraux (emtri-
citabine/rilpivirine/ténofovir disoproxil) en un seul comprimé, à prendre
1fois par jour (Single Tablet Regimen [STR]), est destinée au traitement
de l’infection par le VIH-1 des adultes n’ayant jamais reçu de traitement
antirétroviral et présentant une charge virale (quantité de VIH dans le
sang) inférieure ou égale à 100 000 copies/ml d’ARN du VIH-1. Eviple-
ra
®
, nouvelle option thérapeutique efficace et d’administration simple,
répond ainsi aux recommandations européennes qui préconisent que les
patients séropositifs puissent recevoir un traitement antirétroviral à un
stade précoce de la maladie. Les STR, combinant des médicaments ayant
démontré leur efficacité, aident aujourd’hui les patients à mieux observer
leur traitement, élément indispensable à la réduction du risque et d’échec
thérapeutique et de résistance médicamenteuse du VIH.
Rappelons que près de 34 millions de personnes vivaient, en 2011, avec
le VIH dans le monde, environ 2,3 millions de personnes en Europe dont
152 000 en France, pays qui a le second taux le plus élevé de nouveaux cas
d’infection à VIH de l’Union européenne, avec 6 300 nouveaux cas par an.
État des lieux de la consommation
des benzodiazépines en France
vQuelques chiffres relevés dans le rapport d’expertise de l’Afs-
saps, publié en janvier 2012, dont la rédaction a été coordonnée
par Philippe Cavalié et Nathalie Richard: 22benzodiazépines
ou apparentées étaient commercialisées en France en 2011. En 2010, 134
millions de boîtes ont été vendues, dont 50,2 % d’anxiolytiques et 37,6 %
d’hypnotiques. Cette classe de médicaments a généré 183 millions d’eu-
ros de chiffres d’affaires en 2010, soit 0,7 % du montant total des ventes
de médicaments en France. En 2010, 20 % de la population française en a
consommé au moins une fois et 60 % des consommateurs sont des femmes.
Le temps de traitement médian est de 7 mois. Environ la moitié des sujets
traités par une benzodiazépine anxiolytique et hypnotique le sont plus
de 2 ans (avec ou sans interruption de traitement). Environ la moitié des
patients ne bénéficie que d’une seule délivrance ou prescription. En 2009,
selon certaines données européennes, la France était le deuxième pays
européen consommateur d’anxiolytiques (après le Portugal) et d’hyp-
notiques (après la Suède). Pourtant, depuis 2002, la consommation des
benzodiazépines anxiolytiques a diminué avec un nombre de consomma-
teurs constant, suggérant une diminution de la consommation individuelle,
souligne le rapport, avec, cependant, une tendance à la hausse depuis 2009.
À noter aussi : la consommation des benzodiazépines hypnotiques dimi-
nue au profit d’une augmentation régulière de celle des substances qui leur
sont apparentées (zolpidem et zopiclone). L’Afssaps rappelle que si le traite-
ment par ces médicaments est indispensable pour de nombreux patients, il
présente aussi des risques. “Ils peuvent en particulier entraîner des troubles
de la mémoire et du comportement, une altération de l’état de conscience
et des fonctions psychomotrices. Ces effets sont accrus chez le sujet âgé. De
plus, plusieurs études suggèrent un lien possible entre benzodiazépines et
démences, dont la maladie d’Alzheimer... Une étude pharmaco-épidémiolo-
gique, soutenue par l’Afssaps, a également confirmé que ces médicaments
étaient susceptibles d’altérer les capacités à conduire un véhicule et qu’une
part non négligeable des accidents de la route pouvait leur être attribuée.
Enfin, l’usage de ces médicaments expose également à un risque de dé-
pendance psychique et physique qui s’accompagne d’un syndrome de
sevrage à l’arrêt du traitement. Le rapport aborde aussi l’aspect de l’addic-
tovigilance de cette consommation dont le réseau a mis en évidence une
utilisation problématique avec un usage abusif ou détourné par les toxico-
manes, voire criminel à des fins de soumission chimique.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Addict déc 2012.indd 13 10/12/12 11:08
1
/
4
100%