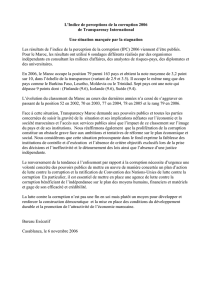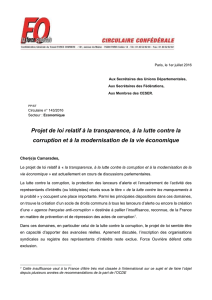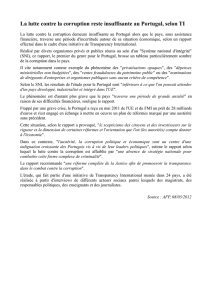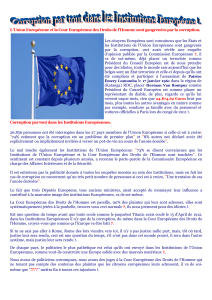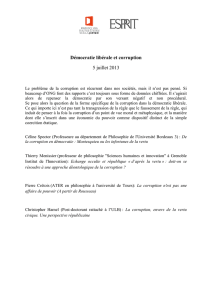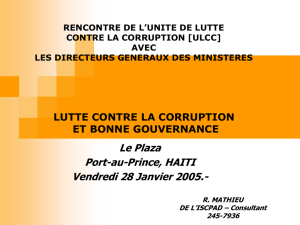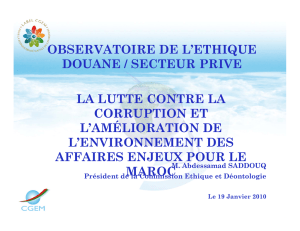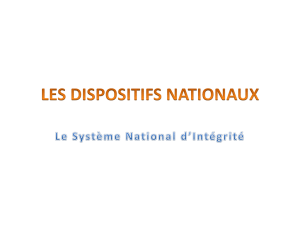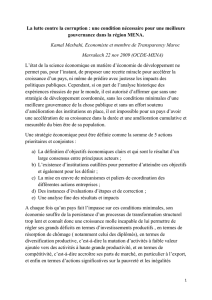Maquette de La Lettre de Transparence n° 4 Déc 99

La Lettre de Transparence 1er trimestre 2000 1
.
n° 4
Janvier 2000
Lettre d’Information de
Trans
p
arenc
y
International
Nigeria : une page tournée, un tournant à prendre
Avec l'élection d'Olusegun Obasanjo à la présidence du Nigeria, une occasion unique s'est présentée
à
Transparency International de jouer un rôle en s'appuyant sur ses liens de longue date avec le nouveau chef de
l'Etat qui, dès son arrivée au pouvoir, attendait de lui un soutien dans ses efforts pour attaquer la corruption, u
n
fléau associé au nom de son pays. Le président Obasanjo n'a pas tardé à démontrer son attachement aux
principes d'une stratégie anti-corruption en prenant des initiatives dans quatre domaines : le défi éthique et l
a
mise en place de normes, la réorganisation institutionnelle, la réglementation des pratiques administratives e
t
l'engagement déterminé de son entourage.
Sur le front éthique, le Président a proclamé en termes particulièrement clairs sa détermination de conduire
avec son équipe un gouvernement propre et de faire régner dans la fonction publique un esprit de dévouemen
t
et non d'enrichissement personnel. Il a procédé à un nettoyage initial des lieux en révoquant ou en mettant à l
a
retraite un nombre appréciable de hauts responsables du gouvernement et de l'armée. Les avoirs suspects de
certains fonctionnaires ont été saisis en attendant le résultat d'enquêtes. Christopher Kolade, mandaté par TI-
Nigeria, a été chargé de réexaminer les contrats publics récents, tandis qu'une deuxième équipe s'est chargée
d'analyser les contrats en cours signés depuis 1976. TI a participer à la confection d'un code de conduite pou
r
les ministres et leurs collaborateurs et à une série de séminaires organisés à l'intention du même groupe de
dirigeants pour définir les valeurs et le style du nouveau régime. Il a également joué un rôle consultatif e
t
fourni une assistance technique dans plusieurs domaines, comme dernièrement lors d'un atelier sur la réforme
des marchés publics.
Le changement dont a besoin le Nigeria ne pourra se concrétiser que si le contexte, intérieur et extérieur,
se révèle propice. Le président nigérian a essayé d'agir sur ce contexte, comme en témoignent la vigueur et le
contenu de son offensive initiale contre la corruption et les dysfonctionnements du gouvernement. Mais l
a
tâche principale à long terme, qui consiste à introduire un changement culturel, a tout juste commencé. Le
Nigeria, est le plus grand et potentiellement le plus dynamique pays d'Afrique. Les intérêts établis y son
t
puissants, bien armés et solidement retranchés, les divisions politiques complexes et profondes, de sorte que
les problèmes sont abordés sous un angle subjectif et partisan.
Tout en se réjouissant de la chance inhabituelle de travailler avec un chef d'Etat qui est un sympathisan
t
notoire, TI se doit d'aller au delà de la personne du président s'il veut avoir un impact durable, la cible étant le
Nigeria et non Obasanjo. TI a déjà été reconnu comme un acteur sur la scène nigériane, mais une telle
reconnaissance constitue autant un défi qu'une opportunité. TI insiste toujours sur l'idée que ce sont les
sections nationales qui doivent former les troupes de combat. TI-Nigeria existait bien avant le présent régime.
Son action visait un changement radical et ne pouvait prospérer sous une dictature. Se donnant pour objecti
f
des sociétés transparentes, TI s'efforce de mettre en place des changements structurels durables, si bien que ses
actions ne sont pas liées à un régime. Le Nigeria, tel un cas d'école en Afrique, permettra de tester si les
partenaires de TI peuvent promouvoir un réel changement.
Peter Eigen
Président de Transparency International
Durban : une nouvelle éta
p
e
La Conférence Internationale Anti-Corruption (IACC) a tenu sa 9
è
me
session à Durban du 10 au 15 octobre dernier. Lancée il y a seize ans pa
r
un petit groupe de gens inquiets de l'ampleur prise par la corruption dans
le monde, cette réunion bisannuelle a peu à peu grossi. Transparency
International, qui était né entre temps, a été sollicité il y a quatre ans d'as-
surer son secrétariat et a pris depuis lors une part active à son animation.
La manifestation de Durban aura marqué une étape dans l'histoire de
l'IACC, aussi bien par la dimension de la rencontre que par les évolu-
tions qui ont pu être enregistrées et par les résolutions adoptées.
La réunion précédente, qui avait lieu à Lima en septembre 1997,
avait déjà battu un record d'affluence avec un bon millier de participants
venus de 93 pays. A Durban, le nombre des congressistes et celui des
pays représentés a encore augmenté de moitié. Le continent africain étai
t
particulièrement bien représenté, y compris l'Afrique francophone,
demeurée jusqu'alors relativement à l'écart de ces rassemblements.
Les orateurs ont fait un double constat. Ils ont relevé les importantes
avancées réalisées depuis Lima. Sur le plan multilatéral, si la conventio
n
anti-corruption de l'OCDE tient la vedette, d'autres progrès ne sont pas
moins notables, en particulier dans les travaux du Conseil de l'Europe. E
t
ces avancées ne se limitent plus à des textes mais entrent à présent dans
les faits. C'est ainsi que des banques de développement n'hésitent plus
à
user des armes qu'elles se sont données et à disqualifier pour un certai
n
temps des entreprises convaincues de corruption. La politique interne de
nombreux pays a elle aussi évolué : les grands pays exportateurs sup-
priment progressivement la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés
à
l'étranger ; des entreprises, en nombre croissant, se dotent de codes de
conduite ; des dispositions se multiplient pour protéger ceux qui révèlen
t
des actes de corruption ; certains gouvernements s'engagent dans une
action d'ensemble pour faire reculer la corruption.
Il a fallu toutefois reconnaître les limites de ces avancées. En maints
endroits le mouvement reste minime ou velléitaire ou même traduit un
Bonne Année 2000 à tous
La seule condition pour que le mal puisse
triompher, c'est que les bons ne fassent rien
Edmund Burke
Pourquoi janvier ?
Nous paraissions jusqu'ici le
dernier mois de chaque trimestre,
comme la TI Newsletter, dont nous
reprenons des éléments pour les
lecteurs francophones. Un décalage
d'un mois nous permettra d'y puise
r
des nouvelles
p
lus récentes.
Dans ce numéro pag
e
U La connaissance de la
corruption s'élargit …………..
2
U La convention OCDE de 1997:
où en est sa transposition?…..4
La liberté de l'information …
U
5
U Les collectivités locales ………
6
Initiatives internationales …....8
U Identifier les territoires
Les procureurs se concertent
"non coopératifs"
U
Avancées d'un pays à l'autre…9
U Suisse : progrès et insuffisance
U Maroc : projet de réforme
des dispositions légales
administrative
La corruption au quotidien….1
0
U Etats-Unis : pots-de-vin dans
U Bosnie : un milliard de dollars
les contrats militaires
volatilisés
Echos de notre réseau…..….…11
U La famille s'a
g
randit
recul. Ont été notamment soulignés les risques inacceptables que
courent encore trop souvent les journalistes.
On note, d'autre part, la conjonction dans les interventions, d'u
n
accent fort placé sur les valeurs qui inspirent l'action engagée pou
r
combattre la corruption (faire reculer la pauvreté, faire respecter les
droits de l'homme, consolider la démocratie) et, dans les conclusions,
des résolutions qui se veulent très concrètes. A la Déclaration de Lima
succède l'Engagement de Durban. La nuance n'est pas fortuite.
Les congressistes entendent en particulier pousser au maximum l
a
coopération régionale et internationale et, singulièrement, l'entraide
judiciaire ; mettre en oeuvre les conventions déjà signées ; intensifie
r
les échanges d'expériences. Ils ne négligent pas pour autant les
questions relevant de la politique intérieure des Etats : le financemen
t
de la vie politique ; l'indépendance et les moyens de la justice ; l'actio
n
à mener dans les domaines fiscal et douanier, de manière à assurer les
ressources permettant le relèvement, souvent indispensable, des salaires
publics ; la transparence des marchés publics.
Leurs résolutions visent aussi le secteur privé : normes profession-
nelles d'intégrité, initiatives sectorielles dans les branches les plus
sensibles ; participation des professions bancaire et financière à la lutte
contre le blanchiment. Ils soulignent également la nécessité d'une actio
n
globale incluant la société civile, qui doit elle-même, dans le secteu
r
associatif, élever le niveau de ses exigences éthiques. Ils prennent acte,
avec satisfaction, de la création d'un fonds de partenariat créé par le
PNUD (programme des Nations Unies pour le développement), à l'initiative
de TI, pour soutenir une participation plus significative de membres de
la société civile à des interventions destinées à combattre la corruption.
Sont enfin mentionnées la nécessité de perfectionner l'analyse de l
a
corruption et d'évaluer les réformes engagées.
Le prochain rendez-vous est fixé en 2001 à Prague, et Séoul a pris
rang pour recevoir la conférence en 2003. TI-France

L'ICPE présente une liste de dix-neu
f
importants pays exportateurs de produits
industriels, rangés selon l'inclination de leurs
firmes à accorder des pots-de-vin pou
r
enlever des marchés. Il repose sur les
réponses données au cours d'un sondage
commandé par TI, après appel d'offres,
à
Gallup International. La question posée étai
t
la suivante : "Dans les secteurs profession-
nels avec lesquels vous traitez régulière-
ment, veuillez indiquer si les sociétés des
p
ays suivants sont très susceptibles,
susceptibles ou non susceptibles de verse
r
des pots-de-vin pour gagner ou conserve
r
des contrats dans votre pays."
L'enquête a été conduite dans quatorze
p
ays en développement ou en transition,
ayant un certain poids économique, choisis
p
our obtenir une répartition équilibrée entre
les continents et les civilisations. Ont été
écartés les pays qui sont par trop dépendants
de l'aide étrangère ou d'une même source
d'approvisionnement, ou encore ceux dans
lesquels l'enquête apparaissait trop difficile
à
conduire. Ont ainsi été retenus :
Rang Pays Note
1 Suède 8,3
2 Australie 8,1
Canada 8,1
4 Autriche 7,8
5 Suisse 7,7
6 Pays-Bas 7,4
7 Royaume-Uni 7,2
8 Belgique 6,8
9 Allemagne 6,2
Etats-Unis 6,2
11 Singapour 5,7
12 Espagne 5,3
13 France 5,2
14 Japon 5,1
15 Malaisie 3,9
16 Italie 3,7
17 Taiwan 3,5
18 Corée du Sud 3,4
19 Chine
(y
com
p
ris Hon
g
Kon
g)
3
,
1
- cinq pays d'Asie Pacifique : Inde, Indoné-
sie, Thaïlande, Corée du Sud, Philippines ;
- trois pays d'Afrique : Nigeria, Afrique du
Sud, Maroc ;
- trois pays d'Amérique latine: Brésil, Argen-
tine, Colombie ;
- trois pays d'Europe: Russie, Pologne, Hon-
grie.
Dans chacun d'eux cinquante à soixante
personnes ont été interrogées : des responsa-
b
les de grandes sociétés et de banques
commerciales, tant nationales qu'étrangères,
des avocats d'affaires, des associés de
cabinets d'audits, des représentants de
chambres de commerce étrangères. Les
réponses recueillies font apparaître une
grande convergence des opinions, ce qui
renforce la fiabilité des données recueillies.
Comme pour l'établissement de l'IPC,
chaque pays se voit attribuer une note allan
t
de 0 à 10. La note est d'autant plus basse que
les exportateurs du pays concerné son
t
considérés par les personnes interrogées
comme davantage portés à recourir aux pots-
de-vin pour emporter des commandes.
L'indice de corruption des pays exportateurs
Cet indice garde ses caractéristiques essentielles des années
précédentes. Il résulte d'une compilation de sondages, provenant de
divers instituts. Certains de ces sondages sont réalisés auprès de
résidents des pays considérés, autochtones ou expatriés, soit dans les
milieux d'affaires, soit dans le grand public. D'autres s'adressent à des
experts, en grande partie non-résidents. Pour chaque pays inclus dans
l'indice, les appréciations émanent à la fois de résidents et de non-
résidents.
En 1999 il a été jugé possible de prendre en compte les enquêtes
de trois instituts supplémentaires, dont le nombre passe ainsi cette
année de sept à dix (1). Les sondages retenus l'ont été en fonction de
leur qualité et de l'adéquation des questions posées à l'objet de l'indice.
Cela a permis de couvrir 99 pays au lieu de 85 en 1998.
L'exigence, pour inclure un pays dans l'indice, de disposer d'a
u
moins trois sources, a été maintenue. De même, comme déjà l'année
p
assée, on a pris en compte, lorsque c'était possible, les résultats
enregistrés par les instituts de sondage au cours des trois dernières
années, cela de manière à éviter les brusques variations que pourrai
t
faire subir à l'opinion publique un événement très médiatisé.
Il reste que les comparaisons d'une année à l'autre appellen
t
beaucoup de prudence. L'inclusion de nouveaux pays modifie le
classement des autres. La note elle-même, qui est attribuée à un pays
ne varie pas seulement en fonction des changements survenus dans ce
p
ays mais peut aussi être légèrement affectée par des modifications
mineures dans l'échantillonnage ou la méthodologie adoptée par l'u
n
ou l'autre des instituts impliqués, voire par l'inclusion ou l'exclusio
n
L
'i
n
di
ce
d
e percept
i
on
d
e
l
a corrupt
i
on
d'un institut, encore que, précisément pour éviter cela, les auteurs de
l'IPC limitent autant que possible le recours à des sondages uniques,
non répétés chaque année. C'est pour éviter des rapprochements hâtifs
que le tableau de l'année précédente n'est plus, depuis 1998, présenté
n regard de celui de l'année en cours. e
La notation demeure graduée sur un barème qui va de 10, pour u
n
pays jugé exempt de corruption, à zéro, là où la corruption serai
t
généralisée. Les notes sont calculées, comme l'an dernier, avec une
décimale et une seule, pour éviter à la fois une précision illusoire e
t
des effets de seuil. Pour chaque pays le tableau donne le nombre de
sondages utilisés et l'écart-type indiquant la plus ou moins grande
dispersion des notes enregistrées : plus cet écart est faible, plus les
appréciations recueillies sont concordantes et plus la note qui e
n
résulte est fiable.
(1)
- Economist Intelligence Unit (publications Country Risk Service et Country Forecasts)
- Gallup International (50th Anniversary Survey)
- Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook)
- Political & Economic Risk Consultancy (Asian Intelligence Issue)
- Political Risk Services (International Country Risk Guide)
- Banque Mondiale / Université de Bâle
- World Economic Forum
- Wall Street Journal, Central European Economic Review
- Freedom House
- International Working Group
Depuis 1995, Transparency International (TI) établit chaque
année un indice de perception de la corruption (IPC), qui vise
à
mesurer la façon dont est perçue la plus ou moins grande
vulnérabilité à la corruption de l'appareil politico-administrati
f
des différents pays.
Cet indice a le défaut de ne révéler qu'une face de l
a
corruption, à savoir la corruption qualifiée de "passive", celle des
corrompus. Les pays du tiers monde ont fait observer, non sans
raison, qu'il donne d'eux une image moins flatteuse que celle des
pays industrialisés, qui pourtant participent à la corruption en tan
t
que corrupteurs.
Tenter de mesurer la corruption dite "active" est une
entreprise particulièrement délicate. Alors que la corruptio
n
passive fait l'objet d'un certain nombre de sondages réalisés pa
r
divers instituts et qui servent de base à la confection de l'IPC, il
n'existe rien de comparable en matière de corruption active. Pour
b
âtir un indice de corruption des pays exportateurs (ICPE), reflétant l
a
façon dont est jugée la propension à corrompre de leurs entreprises, il
fallait entreprendre les enquêtes primaires requises, réunir pour cela les
financements nécessaires et concevoir une nouvelle méthodologie. Ce
projet a abouti cette année.
Procédant de deux méthodologies bien distinctes, les deux indices ne
sont pas comparables. Mais ils appellent une remarque commune : ils
p
rocèdent, l'un comme l'autre, de la collecte de jugements et non de
l'observation de données objectives. Ils ne mesurent donc pas
directement le phénomène de corruption, active ou passive, mais l
a
p
erception que l'on en a. Il n'a pas paru possible de comparer le nivea
u
de corruption dans différents pays à partir d'éléments factuels. Le
nombre de poursuites pénales, par exemple, reflète généralement moins
ce niveau que l'efficacité de l'appareil judiciaire et policier. Les indices
p
roduits à partir de sondages n'en sont pas moins significatifs, mais il
faut, lorsqu'on les cite, ne pas manquer d'en rappeler la véritable portée.
Les efforts visant à mesurer la corruption, telle qu'elle est perçue par le public, ont étendu leur champ en
1999. L'indice de perception de la corruption, publié chaque automne depuis quatre ans, parvient à couvri
r
cette année 99 pays. Il s'accompagne surtout d'un nouvel indice de la corruption des pays exportateurs. L
a
p
resse en a assez largement rendu compte. Il paraît néanmoins utile de reproduire ici ces chiffres e
t
quelques commentaires qui ont accompagné cette publication. Ils soulignent la portée limitée de ces indices
et en
p
récisent le mode d'élaboration
,
en donnant les sources où trouver des ex
p
lications
p
lus com
p
lètes.
La connaissance de la corruption s'élargit
2 La Lettre de Transparence 1er trimestre 2000

Australie 8,7 0,7 8
13 Royaume-Uni 8,6 0,5 11
14 Allemagne 8,0 0,5 10
15 Hong-Kong 7,7 1,6 13
Irlande 7,7 1,9 10
17 Autriche 7,6 0,8 11
18 Etats-Unis 7,5 0,8 10
Cameroun
Le premier ministre se di
t
surpris et frustré de constate
r
que, pour la seconde année,
son pays est considéré comme
le plus corrompu, tout e
n
relevant l'insistance de TI
à
rappeler qu'il ne s'agit que
d'un indice de perception. Il
déplore que l'effort actuelle-
ment engagé par son gouver-
nement pour combattre l
a
corruption n'ait pas été pris e
n
compte.
Nigeria
Le gouvernement considère
que l'avant-dernière place
qu'occupe son pays, juste
avant le Cameroun, constitue
un défi pour un renouveau.
Kenya
Le journal The Nation qualifie
le classement kenyan de
maudit jugement, tout e
n
reconnaissant que l'indice n'
a
fait que refléter une situatio
n
connue de tous.
Malaisie
Le ministre de l'industrie
trouve ridicules les classe-
ments et met en cause l
a
méthode déployée pour mene
r
les sondages.
Corée du Sud
Une agence d'information, e
n
réaction au mauvais classe-
ment du pays, a mené u
n
sondage d'opinion su
r
Internet. 90% des 4 600
réponses valident les résultats.
Allemagne
Le président de la Confé-
dération patronale affirme
qu'un grand nombre d'entre-
p
rises allemandes ignoren
t
toujours l'existence de l
a
convention de l'OCDE.
4,9 0,7 4
11
Quelques réactions
L'indice 1999 de
p
erce
p
tion de la corru
p
tion
Lorsqu'il est fait référence à ces indices, il convient de n'en perdre de vue ni les limites ni l'intérêt.
Ils sont fondés, on doit constamment le rappeler, sur des opinions, non sur des faits. Il serait donc erroné de dire que le dernier pays de la liste est le
pays le plus atteint par la corruption. Au demeurant, sur plus de 200 pays souverains, l'IPC n'en vise que 99 et l'ICPE 19.
En outre, s'ils ne retiennent aucune donnée antérieure aux trois dernières années, ces indices ne peuvent pas toujours tenir compte des
développements les plus récents intervenus ici ou là, tels que des réformes en cours dont l'impact n'est pas encore ressenti dans le public.
Par ailleurs, centrés l'un sur le comportement des exportateurs, l'autre sur celui des représentants des Etats, les deux indices ne prennent pas en
compte la place éminente que tiennent certains pays dans la corruption mondiale en abritant ses produits derrière leur secret bancaire ou dans leurs
places offshore.
Mais une fois leurs limites clairement posées, ces indices sont un précieux instrument de connaissance. Dans le champ qu'ils s'assignent, ils sont
établis avec le maximum de rigueur. Les méthodes utilisées sont périodiquement réexaminées et affinées par un comité directeur composé de
spécialistes qualifiés.
L'utilité de cet outil ne fait, d'autre part, aucun doute.
L'IPC a, dans les années récentes, notablement contribué à faire prendre conscience de l'ampleur de la corruption et a poussé certains
gouvernements à engager des mesures de redressement.
L'ICPE, à son tour, arrive au moment où entre en vigueur la convention de l'OCDE de 1997 sur la lutte contre le corruption d'agents publics
étrangers. Il offrira un nouvel outil pour apprécier les progrès qui seront réalisés dans les années à venir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés soit à Transparence-International (France), soit à l'une des adresses suivantes :
A Berlin : Carel Mohn A Washington D.C. : Frank Vogel A Londres : Jeremy Pope
Tél.: +49-30-343 8200 Tél.: +1-202-331 8183 Tél.: +44-171-610 1400
Fax:+49-30-3470 3912 Fax:+1-202-331 8187 Fax:+44-171-610 1550
0,7 5
90 Kenya 2,0 0,5 4
Paraguay 2,0 0,8 4
Yougoslavie 2,0
cmohn@transparency.de Voglcom@aol.com ti@transparencyintl.demon.co.uk
Pour les questions d’ordre technique concernant la méthodologie des indices de TI adressez-vous pour l’ICPE à Fredrik Galtung, Université de Cambridge, Grande-
Bretagne par E-mail : galtung@ibm.net ou par fax: 44-1223-33 45 50, et pour l'IPC à Johann Graf Lambsdorff, Université de Goettingen, Allemagne, par E-mail:
[email protected] ou par fax: 49-551-392054.
Vous
pouve
z
auss
i
co
n
su
lt
e
r l
e
s
it
e
Int
e
rn
e
t
de
TI
:
www.
tr
a
n
spa
r
e
n
cy.de
1,1 6
93 Tanzanie 1,9 1,1 4
94 Honduras
R
ang Pays Note Ecart
type
Nbre de
sondages
1 Danemark 10,0 0,8 9
2 Finlande 9,8 0,5 10
3 Nouv. Zélande 9,4 0,8 9
Suède 9,4 0,6 10
Canada 9,2 0,5 10
Islande 9,2 1,2 6
7 Singapour 9,1 0,9 12
8 Pays-Bas 9,0 0,5 10
9 Norvège 8,9 0,8 9
Suisse 8,9 0,6 9
11 Luxembourg 8,8 0,9 8
12
19 Chili 6,9 1,0 9
20 Israël 6,8 1,3 9
21 Portugal 6,7 1,0 10
22 France 6,6 1,0 10
Espagne 6,6 0,7 10
24 Botswana 6,1 1,7 4
25 Japon 6,0 1,6 12
Slovénie 6,0 1,3 6
27 Estonie 5,7 1,2 7
28 Taiwan 5,6 0,9 12
29 Belgique 5,3 1,3 9
Rang Pays Note Ecart-
type
Nbre de
sondages
50 Lituanie 3,8 0,5 6
Corée du Sud 3,8
Namibie 5,3 0,9 3
31 Hongrie 5,2 1,1 13
32 Costa Rica 5,1 1,5 7
Malaisie 5,1 0,5 12
34 Afrique du Sud 5,0 0,8 12
Tunisie 5,0 1,9
0,9 13
53 Rép.Slovaque 3,7 1,5 9
54 Philippines 3,6 1,4 12
Turquie 3,6 1,0 10
56 Mozambique 3,5 2,2 3
Zambie 3,5 1,5 4
3
36 Grèce 4,9 1,7 9
Île Maurice
58 Biélorussie 3,4 1,4 6
Chine 3,4 0,7
38
3,4
Italie 4,7 0,6 10
39 Rép. Tchèque 4,6 0,8 12
1,3 7
Mexique 3,4 0,5 9
40 Pérou 4,5 0,8 6
41 Jordanie
Sénégal 3,4 0,8 3
63 Biélorussie 3,3 1,4
4,4 0,8 6
Uruguay 4,4 0,9 3
43 Mongolie 4,3 1,0 3
8
64 Egypte 3,3 0,6 5
65 Ghana 3,3 1,0 4
66
44 Pologne 4,2 0,8 12
45 Brésil 4,1 0,8 11
Macédoine 3,3 1,2 5
67 Roumanie 3,3 1,0 6
68 Guatemala 3,2
Malawi 4,1 0,5 4
Maroc 4,1 1,7 4
Zimbabwe 4,1 1,4 9
49 El Salvador 3,9 1,9 4
50 Jamaïque 3,8 0,4 3
2,5 3
Thaïlande 3,2 0,7 12
70 Nicaragua 3,1 2,5 3
71 Argentine 3,0 0,8 10
72 Colombie 2,9 0,5 11
Inde 2,9 0,6 14
74 Croatie 2,7
Lettonie
0,9 5
75 Côte d'Ivoire 2,6 1,0 4
Moldavie 2,6 0,8 5
Ukraine 2,6 1,4 10
Venezuela 2,6 0,8 9
Vietnam 2,6 0,5 8
80 Arménie 2,5 0,4 4
Bolivie 2,5 1,1 6
82 Equateur 2,4 1,3 4
Russie 2,4 1,0 13
84 Albanie 2,3 0,3 5
Géorgie 2,3 0,7 4
Kazakhstan 2,3 1,3 5
87 Rép. Kirghize 2,2 0,4 4
Pakistan 2,2 0,7
Portée de ces indices
3
Ouganda 2,2
1,8 0,5 3
Ouzbékistan 1,8 0,4 4
96 Azerbaïdjan 1,7 0,6 5
Indonésie 1,7 0,9 12
98 Nigeria 1,6 0,8 5
99 Cameroun 1,5 0,5 4
La Lettre de Transparence 1er trimestre 2000 3

Les collectivités territoriales : deux
p
oints de vue
Les collectivités locales ont compté, dans beaucoup de pays, au nombre des institutions fréquemment touchées par les affaires
de corruption. C'est le cas de la France, qui a connu en deux décennies une mutation accélérée. A la loi du silence de jadis
correspondait un large silence de la loi. Les textes, les usages, étaient mal adaptés à l'Etat de droit. Ce dernier a connu, avec une
profonde décentralisation au milieu des années 1980, un transfert majeur de pouvoirs vers les élus locaux. Les tentations, les
risques, les soupçons ont été accrus. La loi a été modernisée, donnant du même coup à la vie publique un encadrement plus
judiciaire. La corruption n'est pas le seul enjeu : c'est l'appréciation de maintes responsabilités, de type pénal mais aussi civil, voire
comptable, économique et financier, qui a été transférée au juge pénal ou financier. Même en l'absence d'intention coupable, ce qui
brouille parfois l'écoute de notre message sur la prévention de la corruption.
La Lettre de Transparence a sollicité le point de vue des principales associations d'élus locaux sur les mesures de prévention e
t
d'information à développer au sujet de la corruption. Deux d'entre elles ont bien voulu s'exprimer dans nos colonnes. Le balancie
r
et l'application du code pénal sont-ils allés trop loin ? Un excès de loi répressive peut-il devenir paralysant ? Le Parlement et le
gouvernement français s'apprêtent, face à de telles interpellations, à légiférer à nouveau pour clarifier plus encore les financements,
les compétences, les responsabilités, tout en sauvegardant une présomption d'innocence souvent malmenée. Le souci de l
a
prévention doit retrouver sa place à côté de procédures toujours plus contraignantes. Ces deux contributions sont à verser au débat.
Elles montrent à
q
uel
p
oint de nouvelles initiatives sont
,
en aval de la loi
,
indis
p
ensables
p
our accroître la trans
p
arence et l'é
q
uité.
6 La Lettre de Transparence 1er trimestre 2000
Selon la Ministre de la Justice, Madame Elisabeth GUIGOU,
Garde des Sceaux, le nombre de condamnations de décideurs publics
prononcés pour délit intentionnel est de 114 en 1997. Ce chiffre doit
être rapproché de celui du nombre d'élus locaux en France. Ils sont
plus de 500 000.
La médiatisation de ces faits est cependant telle qu'elle tend de
p
lus en plus à accréditer l'idée selon laquelle ces dérives se
diffuseraient largement. Cette perception en forme de généralité est
totalement fausse, comme le sont toutes les généralités. Toutefois, elle
ne doit pas être négligée, car ce sentiment traduit le malaise de chaque
citoyen par rapport à son exigence naturelle de probité vis-à-vis de ses
élus. Il est l'écho d'une attente déçue. A l'inverse, pour les élus, elle
induit un découragement manifeste et j'en veux pour preuve celui des
sondages récents qui expriment ce malaise.
Il ne faut pas, comme les médias le laisseraient souvent penser,
que l'arbre de quelques affaires cache la forêt de la bonne volonté, de
la compétence et de l'honnêteté de la quasi totalité des élus. Ce
sentiment mérite d'être analysé rationnellement, ne serait-ce que pour
mieux cerner les contours réels de la corruption et mieux la combattre.
Bien que spectaculaires, les affaires fondées sur l'infraction
intentionnelle ne constituent donc que la partie émergée de l'iceberg. Il
faut, en effet, distinguer le manquement à la probité, des fautes
personnelles, des erreurs d'interprétation dues le plus souvent à la
complexité de la règle ou de la méconnaissance de la loi.
On s'aperçoit ainsi que sur le plan quantitatif, même s'il y a encore
trop d'affaires liées à un manquement de probité des élus, elles
demeurent un phénomène très minoritaire. En revanche, il est vrai que
les mises en examen et condamnations d'élus locaux pour des faits
d'imprudence, de négligence, et de méconnaissance d'une
réglementation de plus en plus complexe, sont en augmentation
constante.
Toutefois, on ne peut pas s'arrêter à la distinction entre
manquement de probité et faute non intentionnelle et dresser un
constat d'ordre purement quantitatif. Il convient d'aller un peu plus
loin dans l'analyse.
Les infractions intentionnelles, inscrites au livre IV du nouveau
Code Pénal, ont pour objet de réprimer les manquements au devoir de
p
robité, dans un but de moralisation de la vie publique. Cet objectif ne
souffre aucune contestation. Les infractions visées dans le Code sont
notamment la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise
illégale d'intérêt, le favoritisme ou le détournement de biens publics. Il
faut cependant être conscient du fait que ces infractions définies
récemment dans le nouveau Code Pénal n'ont pas fait l'objet d'une
jurisprudence complète et engendrent une certaine insécurité. C'est,
p
ar exemple, le cas du délit du favoritisme aux contours trop
complexes et imprécis.
Le juge pénal considère, en effet, bien souvent ce délit comme
constitué dès l'existence "d'un acte contraire au code des marchés
p
ublics" sans qu'il soit nécessaire que les élus aient eu la volonté
d'accorder à l'entreprise retenue un "avantage injustifié".
Le délit de favoritisme devient un délit purement matériel pouvant
sanctionner une simple erreur administrative. La forme prévaut sur le
fond, l'intégrité et la probité de l'élu s'apprécient par rapport à la forme
de l'acte et non par rapport à l'acte lui-même.
Il paraît pourtant capital de ne pas confondre manquement et
maladresse. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire, aujourd'hui, que
certaines des règles instaurées pour lutter contre la corruption soient
réécrites, afin de leur permettre de mieux atteindre les objectifs qu'ont
leur a fixés.
Par ailleurs, le fait que les infractions non intentionnelles soient
les plus nombreuses, mérite également une certaine attention. Le
législateur n'est pas étranger à ce problème. La prolifération des
normes, leur complexité et leur enchevêtrement, posent de réels
p
roblèmes. Le besoin de clarté et de certitude juridique s'avère
nécessaire pour les collectivités locales et leurs dirigeants. Les élus
locaux, auxquels sont confiées des missions spécifiques dans
l'application des réglementations, attendent que celles-ci soient claires
dans leur formulation et facilement accessibles. Aujourd'hui, une
simplification du droit s'impose.
Enfin, il est vrai que dans un contexte de judiciarisation accrue des
rapports humains qui font que de plus en plus on recherche, sinon des
coupables, du moins des responsables, l'élu local peut être tenu
responsable de beaucoup de choses. La responsabilité pénale des élus,
compte tenu du volume de leurs responsabilités, peut, en effet, très
facilement être engagée. …………………
L'élu local est, par essence, un homme de bonne volonté désigné
p
ar ses concitoyens pour diriger la collectivité locale. Or, il a souvent
le sentiment d'être responsable de tout. Il a le sentiment que dès qu'il
p
rend une initiative, on en vient à le soupçonner de sa bonne foi et de
son honnêteté. Cette réalité-là doit également être prise en compte.
Car à terme, c'est la démocratie locale qui est en danger, avec un
risque de désaffection des citoyens à l'égard des mandats électifs.
La collectivité publique a besoin de citoyens qui s'engagent à son
service. Il faut distinguer la responsabilité pénale non intentionnelle,
qui est en augmentation, de la responsabilité pénale pour des faits
intentionnels qui doit être énergiquement combattue. Mais les deux
méritent une réflexion approfondie sur notre droit.
Le trouble vient sans doute de la croissante inflation juridique à
laquelle nous assistons depuis trente ans. Le droit, règle de conduite
sociale devant assurer l'ordre dans la société, cède peu à peu la place à
la "réglementation", toujours plus complexe et normative, et trop
rapidement évolutive.
*6, Rue Duguay-Trouin 75006 Paris
Jean Puech
,
Président de l'Assemblée des dé
p
artements
De plus, pour l’élu décideur – situé au point d’articulation entre la
Michel La
p
e
y
re
,
Directeur de la Fédération nationale des collectivités
Pour une collectivité locale, vouloir la transparence dans le
domaine des marchés et des concessions ne suffit pas. Il faut aussi
qu’elle ait les moyens concrets de la mettre en œuvre.
Ce n’est pas techniquement chose facile, en partie parce que l
a
production législative récente a été abondante : transposition de trois
directives européennes en 1991 et 1992, quatre lois sur les concessions
de service public de 1992 à 1995, cinq lois sur le financement des
partis politiques de 1988 à 1995 ; sans compter de nombreux décrets e
t
circulaires…
collectivité publique locale et les citoyens – les problèmes à résoudre
aujourd’hui sont marqués par une grande complexité sociétale. Celle-
ci est du reste en partie à l’origine des lois récentes qui – dans u
n
premier temps toutefois – augmentent encore la complexité des
problèmes.
En outre, avoir raison sur le fond – autrement dit dans l’intérê
t
tangible de la population représentée – ne suffit plus : pour tout élu, il
convient aussi – et peut-être surtout estimeront certains – de respecte
r
rigoureusement la forme. La circulaire du 14 février 1996 du ministère
de la Justice – par exemple – ne rappelle-t-elle pas que la notion de

délit de favoritisme doit être comprise dans un sens très large, c’est-à-
dire même sans intention frauduleuse et sans intérêt personnel de l’élu ?
Avant la décentralisation, les choses étaient bien entendu plus
simples. L’élu bénéficiait du confort de la tutelle qui plaçait le préfet,
le directeur départemental de l’équipement ou le directeur départe-
mental de l’agriculture dans une position de co-décideur. Cette
responsabilité partagée était, de surcroît, accompagnée d’u
n
formalisme peu contraignant
Depuis la décentralisation, l’organisation du contrôle s’es
t
complexifiée, conduisant à de nombreuses formalités nouvelles,
évidemment indispensables, mais génératrices de faux pas e
t
constituant un frein à l’initiative.
Ajoutons à cela que des affaires retentissantes ont conduit à u
n
climat de suspicion. Celui-ci aurait bien pu conduire les élus à l
a
p
aralysie, s’ils avaient véritablement craint de se trouver devant u
n
risque permanent de critiques – de type populiste – chaque fois que
serait contracté un marché ou une concession. Dans les faits, sau
f
quelques assez rares exceptions, il n’en a rien été, en raiso
n
p
robablement de l’enthousiasme naturel de la majorité des
responsables des collectivités locales dans l’exercice de leur missio
n
au service de leurs concitoyens. Après une réélection, ce sentimen
t
l’emporte et efface tout ce qui avait pu être considéré comme
p
aralysant, injuste ou vexatoire dans les multiples contrôles auxquels
l’élu est désormais soumis. Des encouragements viennent aussi du fai
t
que des sondages d’opinion montrent que nombreux sont nos
concitoyens qui, certes, jugent défavorablement la classe politique
dans son ensemble mais, en même temps, gardent leur confiance à leu
r
maire et à leur député, dont ils connaissent la probité – cette opinio
n
étant rendue possible par la proximité de ces élus.
Que faut-il faire aujourd’hui ? Tout d’abord, à l’évidence, une
pause législative et réglementaire est nécessaire.
Une profusion de détails de procédure existent maintenant, qu’o
n
imaginait mal il y a peu de temps encore et dont – pour certains d'entre
eux – l’utilité n’est pas encore entièrement comprise.
Il faut donc prendre le temps nécessaire à ce que ces nouvelles règles
soient apprises peu à peu. Des dizaines de milliers d’élus et de
fonctionnaires sont concernés, dont il convient de perfectionne
r
l’information et la formation. Sinon, certains trébucheront toujours su
r
des questions de forme, ce qui conduira à des critiques réitérées
formulées par les contrôleurs, et parfois même à des mises en exame
n
– dont on sait l’effet dévastateur, en particulier sur l’opinion publique.
Le moment de la pédagogie est donc venu. Non seulement pou
r
l’apprentissage rigoureux des procédures, mais aussi pour l’acquisitio
n
d’un nouveau savoir-faire dans le domaine de la communication avec
le public – qu’il s’agisse par exemple de la publication de rapports
annuels ou de l’animation de commissions consultatives d’usagers.
Les élus doivent par conséquent développer des capacités
techniques internes à leurs collectivités, à la fois en matière d’audit e
t
de communication. Ils doivent avoir également recours, en tant que
besoin, à des consultants extérieurs. Mais, aussi bien pour les collecti-
vités à vocation générale (comme les communes) que pour les petites
collectivités spécialisées (des syndicats de distribution d’eau par
exemple), la complexité des moyens à mettre en œuvre pour rendre
effective l’indispensable transparence requise aujourd’hui dans le
domaine des services publics de réseaux rend très souhaitable une
coopération – au moins technique – entre collectivités, et cela sur des
ensembles géographiques suffisamment vastes.
L’expérience montre que, pour de nombreux services publics
industriels et commerciaux de réseaux, la dimension départementale
(ou même supra-départementale) est souvent à retenir pour cette mise
en commun de moyens. Ainsi des élus spécialisés – assistés d’une
p
etite équipe comprenant par exemple un juriste, un ingénieur et un
économiste –, agissant au nom de plusieurs collectivités compétentes
p
our un même service, peuvent avoir le poids politique et technique
indispensable à la passation d’importants marchés de travaux et,
surtout, à la négociation et au contrôle de contrats de concession de
service public. Il convient donc d’inciter les collectivités locales à
coopérer entre elles dans des établissements publics spécialisés afin de
renforcer leurs moyens techniques et, éventuellement, politiques.
Il semble que, de leur côté, les entrepreneurs et les concession-
naires aient compris pour la plupart d’entre eux que le charme de
contrats déséquilibrés – résultant directement de l’impuissance
structurelle de très nombreuses collectivités – n’était que de court
terme et que leur intérêt durable passait en fait par des contrats pour
lesquels chaque partie y trouvait simultanément et véritablement son
compte. On ne peut que souhaiter que soit restaurée ainsi une telle
confiance indispensable à l’efficacité de tout système économique et
financier. On peut d’ailleurs noter que cette confiance en France
même est favorable au développement des grands groupes français de
travaux publics et de services collectifs non seulement dans notre
pays, mais aussi à l’international.
Cependant, la pédagogie nécessaire à l’apprentissage de cette
nouvelle donne politique et économique ne concerne pas seulement
les responsables des collectivités publiques et ceux des entreprises.
Elle doit aussi s’adresser à l’ensemble de nos concitoyens.
Bien sûr, grâce notamment à la presse, l’opinion publique connaît – de
manière souvent très détaillée – divers circuits financiers
condamnables. Mais ne conviendrait-il pas de passer à l’étape
suivante, consistant – à partir de ces informations en leur possession –
à développer une certaine prise de conscience de nos concitoyens ? Il
ne suffit pas de laisser l’opinion se délecter à la lecture de sortes de
romans policiers ; il faut également la convaincre du fait que la
corruption s’installe d’autant plus facilement dans un pays qu’elle a la
possibilité d’y épouser des mœurs constituant un terreau qui lui est
favorable. Cette éducation du public est l’affaire de tous.
* La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) regroupe
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération. Elle est
spécialisée dans les services publics industriels et commerciaux (eau, gaz,
électricité…) qu’ils soient gérés directement (régies) ou délégués (concessions).
20, Bd de Latour Maubourg 75007 Paris.
Un des volets du débat en France sur la transparence de la gestion des collectivités locales vise les juridictions
financières. En novembre 1999, quelques sénateurs ont une nouvelle fois proposé une loi tendant à réformer les
compétences des Chambres régionales des comptes et leurs procédures. L'effet réel serait en partie, selon certains
observateurs, de réduire la transparence, nouvelle depuis dix ans, des gestions locales. Une de leurs propositions mérite
toutefois de retenir l'attention en termes de prévention : ce serait la création d'un "Gouvernement pour l'aide à la gestion
des collectivités territoriales, chargé de renforcer l'information juridique et financière des collectivités territoriales et de
leurs groupements et de leur apporter, sur leur demande, une aide à la gestion [avec], dans chaque département, une
mission juridique chargée de répondre aux demandes d'avis des autorités territoriales et des responsables des organismes
de coopération sur les conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires ou sur des projets d'actes
soumis à l'organe délibérant". Ce dispositif, certes onéreux, serait de nature à faciliter la prévention de la corruption - s'il
est lui-même su
p
ervisé avec trans
p
arence…
(
htt
p
://www.senat.fr :
p
ro
p
osition de loi n° 84 du 18 novembre 1999
)
.
Suite :
Transparence juridique et financière : une nouvelle proposition de loi
Argentine
Un maire élu Président
Ancien maire de Buenos Aires, Fernando de
La Rua, activement engagé dans la lutte
contre la corruption, est sorti vainqueur de
l'élection présidentielle du 24 octobre. Duran
t
la campagne, après le chômage, le comba
t
contre les malversations a été le thème
dominant. Dès sa prise de fonction, le 10
décembre, le nouveau Président s'efforcera de
concrétiser sa promesse de création d'une
unité anti-corruption au sein du ministère de
Justice. El Pais (Espagne) du 20 octobre 1999
la
The Economist du 30 octobre 1999
Grèce
Une mairie plus transparente
Le nouveau maire de la ville du Pirée projette
de mettre en place une série de mesures
destinées à rendre plus transparents le
fonctionnement et les activités de s
a
municipalité. La section nationale grecque de
Transparency International, en collaboratio
n
avec diverses associations et organisations de
la société civile, a soumis au conseil
municipal des recommandations et des
modalités de mise en oeuvre de cette
initiative.
Transparency International, novembre 1999
Micronésie
La repentance d'un élu
Un ancien sénateur des îles Marianne a donné
sa démission après avoir admis être coupable
de malversation et tenté d'influencer un juré.
Alors qu'il était maire de la capitale Tinian, il
avait accepté des pots-de-vin de la part d'une
entreprise locale en échange de la locatio
n
d'équipements bureautiques à un prix
anormalement élevé. Trois autres personnes
sont également impliquées dans cette affaire.
L'ancien élu risque jusqu'à 20 ans de prison e
t
un demi million de dollars d'amende.
Australian Broadcasting Corporation, 22 septembre 1999
4 La Lettre de Transparence 1er trimestre 2000
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%