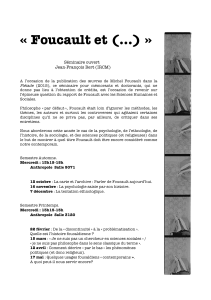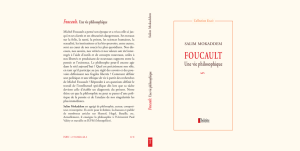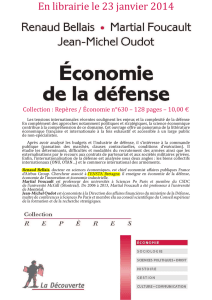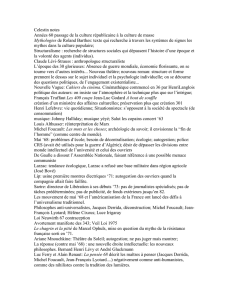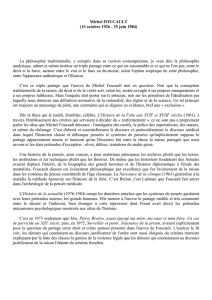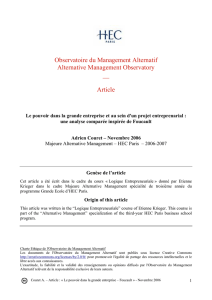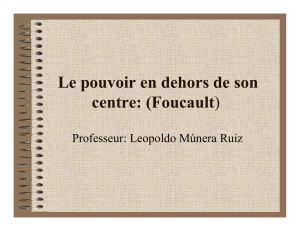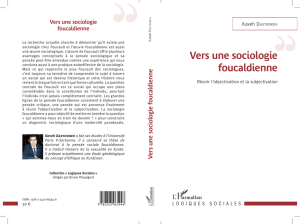Position de thèse - Université Paris

1
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
ÉCOLE DOCTORALE V
Laboratoire de recherche EA 3552
T H È S E en cotutelle
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE et
DE L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Discipline : Philosophie
Présentée et soutenue par :
Mariangela PELLEGRINI
le : 26 Septembre 2015
L'ontologie critique de nous-mêmes. Michel Foucault et la constitution du sujet dans une
trame historique
Sous la direction de :
M. Jean-François COURTINE – Professeur, Université Paris-Sorbonne
Mme. Maria Cristina FORNARI – Professeur, Università del Salento
Membres du jury :
M. Jean-François COURTINE – Professeur, Université Paris-Sorbonne
Mme. Maria Cristina FORNARI – Professeur, Università del Salento

Mme. Judith REVEL – Professeur, Université Paris-Ouest Nanterre
M. Vincenzo SORRENTINO – Professeur, Università degli Studi di Perugia

Position de thèse
L'ontologie critique de nous-mêmes. Michel Foucault et la constitution du sujet
dans une trame historique
1. État de la question
Si même Husserl considérait comme risqué l’usage de l’expression « ontologie » qui était
« devenue choquante pour diverses raisons historiques
1
», on peut facilement comprendre quel choc
produit Foucault lorsqu’en 1983 il prononce pour la première fois, durant une leçon au Collège de
France, le syntagme « ontologie critique de nous-mêmes ». Une telle dénomination s’ajoute aux
autres termes choisis rétrospectivement par Foucault pour définir sa démarche philosophique :
durant ces années quatre-vingts il utilise à la fois « ontologie historique de nous-mêmes »,
« ontologie de l’actualité », « ontologie du présent », « ontologie de la modernité » et enfin
« ontologie de nous-mêmes ». Cette série de formules synonymiques renferme l’objectif premier de
ma thèse : expliciter ce qu’est l’ontologie critique de nous-mêmes. L’enjeu fondamentale de ce
travail consiste en fait d’une part à interroger et comprendre le syntagme en question, de l’autre à
évaluer la possibilité de la construction d’une genèse de cette idée dans le cadre global de la
philosophie foucaldienne. L’interprétation du parcours intellectuel de Foucault à partir du concept
de l’ontologie offre ainsi un horizon d’enquête sur l’être comme objet de connaissance, le concept
d’homme, le statut de la vérité, les critères de rationalisation, les modalités de validité de la
connaissance, le rôle de la critique et de l’histoire, la production du pouvoir, la formation des
déterminations historiques et des processus éthiques de subjectivation. Ces considérations, couvrant
l’arc temporel qui s’étend de la première à la dernière période du cheminement foucaldien,
conduisent à formuler l’hypothèse d’une interrogation constamment nourrie qui, dans une approche
toujours renouvelée avec les thématiques de la subjectivité, trouve un débouché dans les analyses
du soi, dans la stylistique de l’existence, et dans l’ontologie du présent. Et ce sont, à mon sens, ces
mêmes perspectives qui fourniraient un apport tout à fait nouveau au concept d’ontologie dont la
philosophie moderne est l’héritière. La contribution de Foucault au panorama ontologique
contemporain n’a pas encore été reconnue dans sa juste mesure, aussi ce travail se propose-t-il
d’esquisser un premier pas vers cette reconnaissance.
1 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. fr. P. Ricœur, Paris, Gallimard, 1950, p. 42.

Foucault se réfère peu, voire rarement de manière explicite aux philosophes ou aux systèmes
philosophiques avec lesquels il communique C’est surtout dans la dernière période qu’il tente de
reconstruire le cadre historique des penseurs impliqués dans « son » débat bien que cette attitude
émerge parfois dans ses premières articles. Essayons donc de retracer les composantes de la
réflexion foucaldienne autour du statut de la réalité et du sujet, c’est-à-dire l’ontologie, et les points
de contact avec divers questionnements concernant la critique et l’histoire.
Le débat philosophique en question se joue entièrement entre l’Allemagne et la France, entre
des penseurs allemands et des interprètes français. Le milieu philosophique français des années
trente est hégélien, phénoménologique et existentialiste, et la triade Hegel, Husserl et Heidegger est
étudiée canoniquement durant la formation universitaire. Husserl a d’abord été introduit et
commenté par Levinas, enseigné par Merleau-Ponty et repensé par Sartre. La diffusion de la pensée
d’Husserl avec celle d’Heidegger (même si le Heidegger qu’on lisait à celle époque était
principalement celui de Sein und Zeit
2
), avait donné naissance à l’existentialisme, mis en vogue par
Sartre. Le débat était principalement basé sur la question de l’être et de la métaphysique, sur le
rapport entre l’homme et le monde, l’être, et la vérité. Dans l’introduction à On the Normal and
Pathological de Canguilhem, Foucault avance que la philosophie contemporaine prend pied en
France précisément 1930 avec l’introduction de la phénoménologie. Foucault considère alors deux
types de courants phénoménologiques : la philosophie de l’expérience, basée sur la question de
l’homme et du sujet (Sartre et Merleau-Ponty), et la philosophie du concept, focalisée sur les
questions de la rationalité et du savoir (Husserl, Canguilhem, Bachelard). Quels sont les éléments
puisés ou rejetés par Foucault dans ces deux courants et quelles questions ces derniers lui ont-elles
permis de poser ?
2. Méthodologie
Préparer une thèse de doctorat sur Foucault signifie se confronter à vingt-cinq années d’une
démarche philosophique très riche, dynamique et manifestement in fieri, qui, outre cela, n’a pas
atteint de « conclusion » en raison de la mort précoce du philosophe. S’il est vrai, d’une part, que
l’on peut retrouver des pivots conceptuels et des thématiques toujours présentes chez le « premier »
et le « second » Foucault, de l’autre il faut aussi affirmer que la clé d’interprétation de ces mêmes
2 Cf .B. Sichère, Cinquante ans de philosophie française, vol. 2, Paris, Ministère de l'affaire étrangère, 1997 p. 13.

pivots et thématiques est très rarement la même. La pensée foucaldienne s’articule donc en
« variations sur thèmes », autrement dit son travail n’est pas un système de pensée structuré suivant
une idée initale (thèse, hypothèse, principe) et le développement d’une argumentation pour la
soutenir. La philosophie de Foucault s’invente, se crée, se produit – pour utiliser une triade de
verbes chère au philosophe – : elle se dirige toujours vers de nouvelles problématisations et de
nouveaux terrains interprétatifs. En dépit de la particularité d’un tissage philosophique opéré par
variations sur thèmes, la philosophie foucaldienne n’a rien de « fragile », au contraire. Donc, la
première astuce méthodologique consistera à repérer les susdites variations, afin d’observer
l’édification de cette pensée et d’en respecter la cohérence philologique. En deuxième lieu, quant au
sujet de cette thèse, il s’agira de réaliser une enquête génétique enserrant le parcours philosophique
de Foucault selon un ordre chronologique.
À ce propos, une des attitudes les plus fréquentes au sein, pour ainsi dire, de la communauté
de chercheurs foucaldiens, consiste à s’interroger sur l’existence d’un fil rouge persistant dans tous
les ouvrages du philosophe
3
. Je n’insisterai pas sur ce point, mais mon choix de parcourir
l’éventuelle parabole conduisant Foucault à formuler l’ontologie de nous-mêmes et de repérer,
justement, la persistance des problématiques liées à ce sujet, laisse, il est vrai, la question du fil
rouge traverser la trame des développements.
La deuxième précaution méthodologique émerge de l’histoire éditoriale des ouvrages de
Foucault qui n’ont pas été édités en ordre chronologique. En outre, lorsqu’au début de l’année 2012,
j’ai commencé à rédiger ma thèse de doctorat, des textes restaient encore à publier : le cours qui n’a
pas été prononcé au Collège de France mais à l’Université de Louvain, Mal faire, dire vrai (1981)
paru en septembre 2012, Du gouvernement des vivants (Cours au Collège de France 1979-80) paru
en novembre 2012. L’année suivante voit la publication chez Vrin de La société punitive, (Cours au
Collège de France 1972-1973), de L’origine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à
Dartmouth Collège, 1980, et enfin de La grande étrangère : à propos de littérature, aux éditions de
l’EHESS suite à un travail sur les transcriptions inédites de cours, conférences et émissions
radiophoniques de Foucault. En 2014 paraît Subjectivité et vérité, (Cours au Collège de France
1980-1981) et en 2015 Vrin publie Qu’est-ce que la critique ? Suivie de La culture de soi : il s’agit
respectivement des conférences de 1978 prononcée devant la Société française de Philosophie –
3 Je renvoie par exemple aux analyses de Hubert L. Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault: beyond Structuralism
and Hermeneutics (1982) qui formulent une non univocité du travail de Foucault. Une autre voix, opposée, est
représentée par J. Revel, Michel Foucault. Une pensée du discontinu (2010) avec l’hypothèse d'une recherche
unitaire du philosophe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%