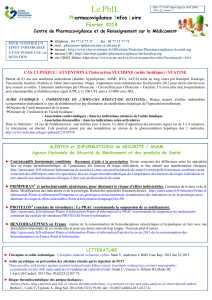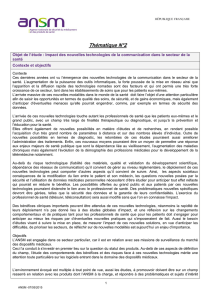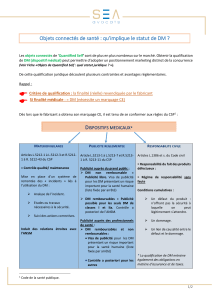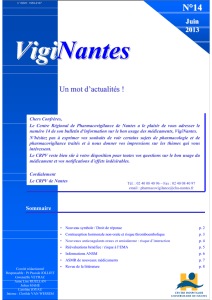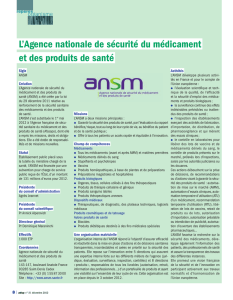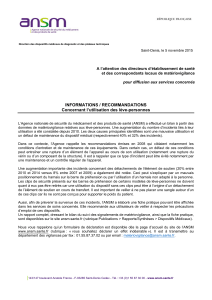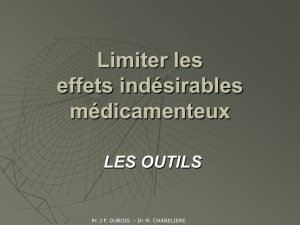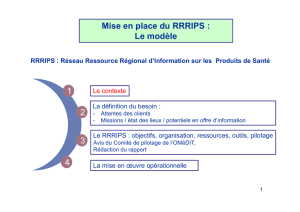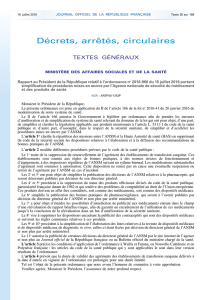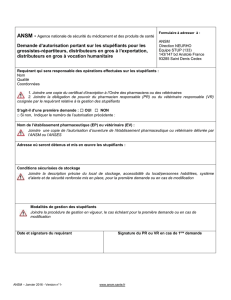Interaction d`issue fatale entre acide fusidique et statine

VigiNantes
n° ISSN : 1959-2167 N°17
Juin
2014
•Le CRPV de Nantes en chiffres – Année 2013 p. 2
• Interaction d’issue fatale entre acide fusidique et statine p. 3
•Le réveil du sarcopte p. 4
•Informations ANSM p. 5
• Réévaluations du bénéfice/risque par l’EMA p. 6
•ASMR de nouveaux médicaments p. 7
•Revue de la littérature p. 8
Sommaire
Comité rédactionnel
Responsable : Pr Pascale JOLLIET
Gwenaëlle VEYRAC
Anne Lise RUELLAN
Julien MAHE
Caroline JOYAU
Interne : Nicolas SERANDOUR
Chers Confrères,
Le Centre Régional de Pharmacovigilance de Nantes a le plaisir de vous adresser le
numéro 17 de son bulletin d’information sur le bon usage des médicaments, VigiNantes.
N’hésitez pas à exprimer vos souhaits de voir certains sujets de pharmacologie et de
pharmacovigilance traités et à nous donner vos impressions sur les thèmes qui vous
intéressent.
Le CRPV reste biensûr à votre disposition pour toutes vos questions sur le bon usage du
médicament et vos notifications d’effets indésirables.
Cordialement
Le CRPV de Nantes Tél. : 02 40 08 40 96 – Fax : 02 40 08 40 97
email : pharmacovigilance@chu-nantes.fr

VigiNantes 2014 (17) – p2
Le CRPV de Nantes en chiffres – Année 2013
57%
9%
29%
1%
1% 3%
Médecins spécialistes
Médecins généralistes
Pharmaciens
Infirmières
Autres professionnels de
santé
Patients et Associations de
patients
51%
10%
33%
3% 1% 2%
CHU
Hôpitaux secondaires
Libéral
Clinique
Institutionnel
Autres
29%
9%
15%
47%
0% Praticiens CHU
Praticiens autres
hospitaliers
Industrie
Professionnels de
santé libéraux
Patients et
associations patients
40%
6%
7%
1%
45%
Effets indésirables
Grossesse
Interactions
Allaitement
Autres (cinétique, mécanisme
d'action, identification, conseils
de bon usage …)
Au cours de l’année 2013, 1496 nouveaux signalements d’effets indésirables médicamenteux (soit + 39% par rapport à
2012) ont été rapportés au CRPV de Nantes et transmis à l’ANSM, avec une forte progression des notifications émanant
du CHU.
Les médecins spécialistes et les pharmaciens sont à l’origine de la majorité des déclarations. Plus de la moitié des
signalements proviennent du CHU (Graphiques 1 et 2). Environ 40 % des notifications concernent des effets graves.
Graphique 1 : Répartition des notifications par type
déclarants sur l’année 2013 Graphique 2 : Répartition des notifications par affiliation
sur l’année 2013
•Bilan des notifications
•Bilan des demandes de renseignements
Graphique 3 : Nature des demandes de renseignements
(2013)
Graphique 4 : Répartition des Questions par affiliation
(2013)
Au cours de l’année 2013, 633 questions ont été posées au CRPV de Nantes provenant en majeure partie des
professionnels de santé libéraux. Environ 21% des demandes de renseignements ont abouti à une notification d’effet
indésirable. Les questions posées sont d’ordre divers (grossesse, interactions, allaitement…), ou en lien avec un effet
indésirable (Graphiques 3 et 4) dans la plupart des cas.
Le CRPV de Nantes est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le médicament (prescription,
interaction, effet indésirable, population à risque, grossesse, allaitement,…), recueillir et analyser les
suspicions d’effet indésirable médicamenteux et pour vous aider dans le diagnostic et la prise en charge des
effets indésirables médicamenteux.
Dr Caroline JOYAU

VigiNantes 2014 (17) – p3
Interaction d’issue fatale entre acide fusidique et statine
Les effets indésirables à type de myalgies, crampes,
élévation des CPK sont fréquents avec les statines.
Plusieurs facteurs favorisent leur survenue comme
l'âge supérieur à 70 ans, l'insuffisance rénale et/ou
hépatique, la pratique intensive d'un sport, la
posologie élevée ou encore certaines associations
médicamenteuses. Le RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit) de l'acide fusidique
indique à la rubrique des effets indésirables un risque
de survenue de rhabdomyolyse et le Thésaurus des
interactions de l'ANSM indique que la toxicité
musculaire des statines est favorisée par la colchicine,
les fibrates et l'acide fusidique. Pour ce dernier, le
niveau d'interaction est différent selon l'indication :
l'association est contre-indiquée avec les statines
dans les indications cutanées de l'antibiotique et
déconseillée dans les indications ostéo-articulaires.
L’arrêt prolongé d’un traitement par statines n’est en
effet pas recommandé. En 2011 au Royaume-Uni,
l'agence nationale de sécurité des médicaments
(MHRA) recommandait de ne pas utiliser l'acide
fusidique per os avec les statines en raison de
l'augmentation du nombre et de la sévérité des cas de
rhabdomyolyse survenant dans ce contexte. Vingt-huit
cas décrivant la survenue d'une rhabdhomyolyse lors
d'une co-prescription sont retrouvés dans la littérature,
dont 8 sont associés à une issue fatale. (1-15)
Homme de 67 ans aux antécédents de fibrillation auriculaire, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Le
traitement habituel de ce patient comporte entre autres de la pravastatine (40 milligrammes par jour) depuis 2007. En
février 2014, une infection à Staphylococcus aureus méticilline sensible est mise en évidence, nécessitant un traitement
antibiotique avec de l'acide fusidique per os (500 milligrammes 2 fois par jour) et de la lévofloxacine (750
milligrammes par jour). Dix jours après cette instauration, un bilan biologique met en évidence une insuffisance rénale.
Le patient est hospitalisé six jours plus tard pour syncope avec insuffisance rénale aigue sévère. La pravastatine est
arrêtée et l'acide fusidique poursuivi. Neuf jours après le début de son hospitalisation un dosage de CPK est effectué,
mettant en évidence une rhabdomyolyse (confirmée par la biopsie musculaire) avec des CPK à 4587 UI/L. Le patient
s'aggrave rapidement vers une défaillance multiviscérale et décède quelques jours plus tard. Les dernières valeurs des
CPK étaient à 160 000 UI/L. (VN 15 - 130 UI/L).
Les statines majoritairement retrouvées sont
l'atorvastatine et la simvastatine laissant supposer en
premier lieu à un mécanisme impliquant l'inhibition
de l'isoenzyme CYP3A4, ces deux statines étant
partiellement métabolisées par cette voie. Cependant,
les cas rapportés avec la rosuvastatine et notre cas
impliquant la pravastatine, ne peuvent pas trouver
d'explication à travers cette hypothèse : la pravastatine
n'est pas métabolisée par le cytochrome P450 et la
rosuvastatine est partiellement métabolisée par
l'isoenzyme 2C9. D'autres auteurs (Kearney et al.,
Gabignon et al.) avancent une compétition entre la
statine et l'acide fusidique au niveau de la
glucuronidation hépatique intervenant dans le
métabolisme de ces deux molécules.
Ces cas de rhabdomyolyses impliquant
l'interaction entre statine et acide fusidique
suggèrent donc un effet de classe. Les prescripteurs
et les pharmaciens doivent donc être alertés quant
au risque d'apparition de complications sévères
voire fatales. Pour les indications cutanées dans
lesquelles l'antibiotique est prescrit sur une courte
période, la contre-indication suppose un arrêt
temporaire de la statine. Mais dans les indications
nécessitant une durée de traitement prolongée avec
l'acide fusidique, la conduite à tenir pour
améliorer la prise en charge est discutée au niveau
de l'ANSM.
Dr Julien MAHE
Références bibliographiques :
1- Dromer C et al. Rhabdomyolysis due to simvastatin. Apropos of a case with review of the literature. Rev Rhum Mal Osteoartic1992;59:281-3.
2- Wenisch C et al. Acute rhabdomyolysis after atorvastatin and fusidic acid therapy. Am J Med2000;109:78.
3- Kotanko P et al. Rhabdomyolysis and acute renal graft impairment in a patient treated with simvastatin, tacrolimus, and fusidic acid. Nephron2002;90:234-5.
4- Yuen SL et al. Rhabdomyolysis secondary to interaction of fusidic acid and simvastatin. Med J Aust2003;179:172.
5- Kahri J et al. Rhabdomyolysis in a patient receiving atorvastatin and fluconazole. Eur J Clin Pharmacol2005;60:905-7.
6- O’Mahony C et al. Rhabdomyolysis with atorvastatin and fusidic acid. Postgrad Med J2008;84:325-7.
7- Burtenshaw AJ et al. Presumed interaction of fusidic acid with simvastatin. Anaesthesia 2008;63:656-8.
8- Herring R, et al. Rhabdomyolysis caused by an interaction of simvastatin and fusidic acid. BMJ Case Rep2009
9- Saeed NT et al. Rhabdomyolysis secondary to interaction between atorvastatin and fusidic acid. BMJ Case Rep2009
10- Magee CN et al. Severe rhabdomyolysis as a consequence of the interaction of fusidic acid and atorvastatin. Am J Kidney Dis2010;56:e11-5.
11- Collidge TA et al. Severe statin-induced rhabdomyolysis mimicking Guillain-Barre syndrome in four patients with diabetes mellitus treated with fusidic
acid. Diabet Med 2010;27:696-700.
12- Teckchandani S et al. Rhabdomyolysis following co-prescription of fusidic acid and atorvastatin. J R Coll Physicians Edinb 2010;40:33-6.
13- Kearney S et al. Northern Ireland Neurology Network. Rhabdomyolysis after co-prescription of statin and fusidic acid. BMJ. 2012 Oct 9;345:e6562.
14- Gabignon C et al. Rhabdomyolysis following the coprescription of atorvastatin and fusidic acid Rev Med Interne. 2013 Jan;34(1):39-41.16
15- Cowan R et al. A timely reminder about the concomitant use of fusidic acid with statins. Clin Infect Dis. 2013 Jul;57(2):329-30.

C Le réveil du Sarcopte
VigiNantes 2014 (17) – p4
Dr Domitille DARNIS
La gale, ce parasite humain obligatoire, fait un retour
fracassant sur le territoire français.
Alarmé par les signaux émis par nombre de
professionnels de santé, l’InVS a tenté de réaliser un état
des lieux de l’épidémie. Les résultats de plusieurs
enquêtes menées entre 2008 et 2010 montrent une
augmentation des signalements d’épisodes de gale en
collectivités (écoles, établissements médico-sociaux,
etc…). Un autre indicateur confirme la recrudescence des
épisodes de gale : l’accroissement des ventes des anti-
parasitaires externes (+ 11% par an) et de l’ivermectine
(+ 24% par an). Ces estimations ont permis de calculer
l’incidence de la gale en France, située dans une
fourchette de 330 à 352 cas et contacts pour 100000
habitants par an, soit une moyenne de 220000 nouveaux
cas par an.
Cette maladie contagieuse revêt un caractère ubiquitaire :
elle atteint les personnes des deux sexes et de tout âge.
Longtemps considérée comme affection des personnes à
mauvaise hygiène, la gale touche actuellement tous les
milieux sociaux. Les conditions de promiscuité et les
collectivités restent des facteurs favorisants à la
propagation. La transmission du parasite (Sarcoptes
scabiei) se fait généralement de façon directe (peau à
peau) et indirecte par le linge et la literie infestés. Un
signe spécifique : le sillon scabieux, localisé
généralement au niveau des mains, poignets et coudes et
à l’origine d’un intense prurit nocturne. L’absence de
lésions spécifiques et de prurit peut rendre le diagnostic
clinique difficile, comme chez les jeunes enfants. La
dermatose se présente alors comme une pustulose
palmoplantaire atteignant le dos des mains et des pieds, le
dos, les aisselles et même le visage et le cuir chevelu, ces
deux zones restant indemnes chez l’adulte. Une
confirmation par examen parasitologique est ainsi
indiquée.
DE LA NÉCESSITÉ DE TRAITER
Il n’existe aucune guérison spontanée de la gale. Seule
une prise en charge efficace permet de détruire le parasite
et de limiter le risque de transmission. En 24 heures, le
sujet traité n’est plus contaminant pour son entourage.
Le Haut Conseil de Santé Publique privilégie deux
formes de traitements : un traitement local, associé ou
non à un traitement systématique, renouvelable entre J8
et J15 (tableau 1). Parmi les topiques scabicides,
l’ASCABIOL® est aujourd’hui indisponible, en raison de
l’arrêt de fabrication du sulfiram. L’ANSM recommande
l’utilisation de la spécialité SPREGAL®, associant
l’esphallédrine et le butoxyde de pipéronile. Cette lotion
est à pulvériser sur tout le corps, excepté le visage et le
cuir chevelu. Une seconde application est conseillée si les
signes cliniques sont toujours présents au bout de 15
jours. L’absence de données expérimentales et cliniques
en cas de grossesse et d’allaitement restreint l’utilisation
du produit qu’en cas de nécessité. D’autres traitements
topiques à base de malathion, crotamiton ou soufre sont
jugés peu efficaces, voire toxiques comme le lindane.
L’ivermectine est le seul traitement oral ayant une AMM
pour la gale. Il s’agit d’une molécule non ovicide,
provoquant la mort des parasites par paralysie
neuromusculaire. Une seconde administration, 8 à 15
jours après la première dose, est conseillée. Bien tolérée,
les effets indésirables retrouvés sont bénins et peu
fréquents (céphalées, vertiges, vomissements,
diarrhées…). Depuis le début de l’année 2014, le CRPV
de Nantes a recueilli trois déclarations d’effets
indésirables. L’ivermectine était suspecte pour deux
réactions d’hypersensibilité et une réaction de
gynécomastie. Malgré l’arsenal thérapeutique
disponible, des échecs de traitements surviennent lorsque
la gale est compliquée (gale crouteuse ou gale profuse).
Traiter pour freiner le regain de la maladie scabieuse,
cela commence par le diagnostic précoce de la maladie.
La prise en charge doit ensuite être adaptée au malade et
à son entourage proche, sans omettre les mesures
obligatoires pour l’environnement.
SPECIALITE COMPOSITION AMM DISPONIBLE
EN
PER OS STROMECTOL® Ivermectine Adulte, enfant, nourrisson de plus de 15
kg (CI : femmes enceintes, allaitantes)
Officine
LOCAL SPREGAL® Esdépalléthrine / butoxyde de pipéronyle
Adulte, enfant, nourrisson (CI :
asthmatiques)
Officine
PERMETHRIN
5%®
Perméthrine 5% Adulte, enfant, nourrisson de plus de 2
mois
Hôpital avec
demande d’ATU
ANTISCABIOSUM
®
Benzoate de benzyle Adulte, enfant, nourrisson de plus de 1 an
Hôpital
(importation
d’Allemagne)
ASCABIOL® Benzoate de benzyle / sulfiram Adulte, enfant, nourrisson Non disponible
ÉVITER LA TRANSMISSION
Linge et literie lavés à plus de 60°C.
Objets non lavables isolés dans un sac plastique fermé
pendant 4 jours.
Acaride de type A-PAR® pulvérisé sur la literie et les
textiles non lavables à haute température.
Tableau 1 : Les traitements de la gale disponibles en France

12/02/2014 :
Contraceptifs hormonaux
combinés : rester conscient des
différences entre les spécialités
face au risque
thromboembolique, de
l'importance des facteurs de
risque individuels et être attentif
aux manifestations cliniques
01/04/2014 :
FURADANTINE® 50
mg gélule
(nitrofurantoïne) :
Rappels sur le bon usage
(indications et durée de
traitement)
04/03/2014 :
Spécialité à base de
métoclopramide :
actualisation des indications
et de la posologie pour
diminuer le risque
(principalement
neurologique) d’effets
indésirables
24/03/2014 :
PROTELOS®
(ranélate de strontium) :
nouvelles restrictions
d'indication et
recommandations
concernant la
surveillance du
traitement
17/02/2014 :
PERIOLIMEL N4E /
OLIMEL N7, N7E, N9 et
N9E (produits pour nutrition
parentérale) - Réduction du
débit maximal de perfusion
par heure chez les enfants
âgés de 2 à 11 ans
22/04/2014 :
Actualisation du
rapport sur les
anticoagulants en
France : état des lieux
en 2014 et
recommandations de
surveillance
10/04/2014 :
GARDASIL® :
actualisation des
données de sécurité
sur le vaccin contre
les papillomavirus
humains
26/02/2014 :
SORIATANE®
(acitrétine) :
Informations
importantes sur le bon
usage et sa sécurité
d'emploi
03/04/2014 :
VERCYTE® 25 mg,
comprimé (pipobroman) :
restriction de l'indication,
information sur la sécurité
et arrêt de
commercialisation fin
2014
03/04/2014 :
PIXUVRI®
(pixantrone) 29 mg,
poudre à diluer pour
solution de perfusion
: risque d'erreur de
posologie
03/04/2014 :
L'ANSM publie une
recommandation
temporaire d'utilisation
(RTU) concernant la
spécialité
ROACTEMRA®
(tocilizumab) dans la
maladie de Castleman
28/02/2014 :
Insuline glargine et
risque de cancer :
conclusion de
l'évaluation des
nouvelles données de
sécurité
14/03/2014 :
Une
recommandation
temporaire
d'utilisation (RTU)
est accordée pour le
baclofène
27/03/2014 :
L'ANSM rappelle le
risque
d'entéropathies
graves chez certains
patients traités par
l'olmésartan
28/03/2014 :
Risque de fuite capillaire
associé au lenograstim
(GRANOCYTE®) chez
les patients atteints d'un
cancer et chez les
donneurs sains
02/04/2014 :
Spécialités contenant du
thiocolchicoside
administrées par voie
générale : information
importante relative aux
indications, modalités de
traitement, contre-
indications et mise en
garde
08/04/2014 :
Attention aux risques d'erreurs
médicamenteuses : mise à
disposition d'un nouveau
dispositif d'administration de
la spécialité KANEURON®
5,4 %, solution buvable en
gouttes (phénobarbital)
07/05/2014 :
PRAZINIL® 50 mg
(carpipramine), comprimé
pelliculé : retrait de son
autorisation sur le marché
à compter du 02/09/14
Informations ANSM
Dr Caroline JOYAU
En cliquant sur le nom du
médicament, vous serez
automatiquement dirigés vers la
page du site ANSM concernée
avec toutes les informations.
VigiNantes 2014 (17) – p5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%