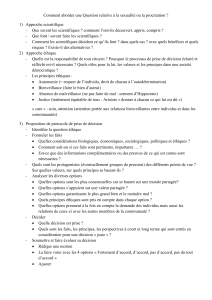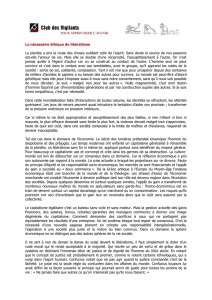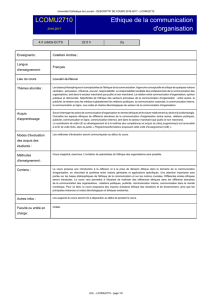1. L`homme, le fondement de l`économie

PEUT-ON ESPERER AU 21ème SIECLE RECONCILIER ECONOMIE ET
HUMANISME ?
PARTIE 1 : H>E – L’économie au service de l’homme.
1. L’HOMME, LE FONDEMENT DE L’ECONOMIE ................................................... 2
1.1. SES ORIGINES ET INFLUENCES ...................................................................................... 2
1.1.1. La religion : guide spirituel de l’homme et de ses comportements .................... 2
1.1.2. Culture ................................................................................................................ 7
1.1.3. Les pensées pensées, fondement de la société On distingue trois périodes : ... 10
1.2. ACTIONS ET CONSEQUENCES ..................................................................................... 14
1.2.1. La politique ...................................................................................................... 14
1.2.2. L’éthique ........................................................................................................... 17
PARTIE 2 : E>H – L’homme au service de l’économie.
introduction
I – Culture, société, Politique, Religion
1 – Religion et économie
1.1 – Le protestantisme
1.2 – Le catholicisme
1.3 – L’islam
2 – Les droits de l’homme
3 – Europe
4 – Mondialisation économique et financière
II - L’économie et l’éthique
1 – La responsabilité sociale et les normes
2 - Capitalisme et libéralisme
3 - L’économie « solidaire » ou l’éthique au service du marketing financier

PARTIE 1 : H>E – L’économie au service de l’homme.
1. L’homme, le fondement de l’économie
1.1. Ses origines et influences
1.1.1. La religion : guide spirituel de l’homme et de ses
comportements
1.1.1.1. Les origines de la société
La religion permet à l’individu de créer et développer ses fonctions sociales, ce qui est à
l’origine même de l’avènement du concept de société.
La réalité collective qui est mise en œuvre par la religion a été démontrée par Durkheim
dans la distinction qu’il opère entre le sacré et le profane, c’est-à-dire entre ce qui relève du
quotidien et ce qui est différent par nature. Ainsi, l’épanouissement personnel ne peut passer
que par le respect et l’adoration de l’autorité morale accordée à la religion, par le biais de la
société.
La religion a un rôle de régulateur, puisqu’elle gère les rapports entre les hommes et le
surnaturel. De ce fait, pour Weber, elle s’appuie sur la notion de charisme, personnalisée par
un chef, et induite dans les institutions de la société. Ainsi, le lien existant entre le capitalisme
et le protestantisme met en évidence que la réussite sociale fonctionne comme un antidote au
doute spirituel, et donc oriente l’activité sociale.
Ainsi, la religion doit donc être considérée comme un guide intellectuel mais aussi
quotidien, qui impose les normes et les valeurs à respecter, à chacun de ses disciples.
Le philosophe Louis de Bonald va plus loin dans le raisonnement en affirmant que tout
mouvement religieux participe à l’avènement d’une société civile et que cette dernière
s’impose à l’homme. Selon lui, l'autorité n'émane pas de la volonté populaire, car la société
est antérieure à l'individu. Elle est un fait qui s'impose à lui. L'Homme serait donc un produit
de la société. Cette pensée vient en directe contradiction avec le notion de « contrat social «
développée par Jean-Jacques Rousseau, qui établit que toute légitimité politique se fonde sur

la communauté et la volonté générale. Ainsi, si nul n'a le droit d'aliéner au profit d'un autre sa
liberté morale et civique, il est souhaitable que les hommes concluent entre eux un pacte, un
contrat : l'individu renonce à une liberté absolue et se soumet aux règles dictées par l'intérêt
général. En échange, la communauté garantit la sécurité de chacun et le respect des règles et
des droits ainsi établis.
Cette observation se rapproche de la conception positiviste élaborée par Auguste
Comte : la religion ne participe que pour une courte période à la définition des conceptions
intellectuelles et des comportements humains. En effet, il reconnaît, à travers des études
empiriques de l’histoire, que trois états régissent le développement humain :
- Le stade théologique est caractérisé par une explication immature des
phénomènes, renvoyés à la volonté des dieux ou de Dieu. ( notion de droit divin des
rois).
- Le stade métaphysique, qui montre que l'explication des phénomènes fait appel
à des catégories philosophiques abstraites. ( concepts de contrat social, d'égalité des
citoyens et de souveraineté populaire).
- Le stade final de l'évolution, le stade scientifique ( rejet de toute explication
causale).
Ainsi, s'il rejetait toute croyance dans un être transcendant, Comte n'en reconnaissait pas
moins la contribution de la religion à la stabilité sociale.
En conclusion, la religion est l’essence de toute société humaine.
1.1.1.2. L’impact de la religion sur la vision économique
Toutes les religions ont été amenées à traiter de la question du rapport à l’argent et au
travail, et donc à se positionner par rapport à eux.
Les religions orientales se veulent distantes de ces concepts ou tout du moins, ont cherché
des compromis pour les intégrer dans la vie quotidienne, sans pour autant empêcher le
développement de la spiritualité.

Tout d’abord, le bouddhisme implique une élévation spirituelle contournant certains
poisons de l’existence comme l’avidité, convoitise, désir. Cette élévation passe par
l’acceptation de quatre propositions essentielles :
- Il y a une existence omniprésente de l’insatisfaction, c’est-à-dire la souffrance,
la douleur et la misère. Les désirs comblés apparaissent comme suscitant de nouveaux
besoins.
- L’origine de l’insatisfaction est créée par un désir de possession.
- La cessation de l’insatisfaction intervient en abandonnant désir et soif.
- Il faut accomplir les étapes menant à la sagesse.
Ainsi, l’objectif est de contourner plusieurs obstacles, c’est-à-dire la convoitise, le
mauvais vouloir ou les doutes.
Ensuite, l’islamisme considère que tout homme reçoit de la bonté divine la subsistance, ce
qui fait qu’il ne travaille que pour sa subsistance et s’il en tire profit, doit pratiquer l’aumône
légale, qui sera redistribuée aux nécessiteux. Ainsi, le prêt à intérêt est prohibé. Au niveau
commercial, la Sunna ou rapport de toutes les actions de Prophète, a avancé le principe que
les forces des échangistes devraient être équilibrées, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir bénéfice
ou domination entre eux. Il en va de même pour la marge commerciale réalisée par la
différence entre le prix de vente et le prix d’achat : le commerce ne consiste pas à prendre le
bien d’autrui sans compensation, mais Dieu laisse chacun face à sa conscience pour la marge
qu’il prélève.
Ainsi, les religions orientales reconnaissent la nécessité de l’échange pour subsister, mais
prennent une position de retrait par rapport au fait d’en tirer avantages et bénéfices.
Les courants religieux occidentaux ont influencé l’activité économique, en se positionnant
par rapport au concept de liberté individuelle ou collective, dû au concept de prédestination
existant tant au niveau catholique que protestant.
Tout d’abord, la prédestination est une notion théologique qui se réfère à l'idée que Dieu a
prévu et fixé de toute éternité le destin des hommes dans l'au-delà, soit comme élus, soit
comme réprouvés, quels que soient les mérites ou les fautes qu'ils pourront accomplir durant
leur vie. Ainsi, par fidélité à l'enseignement de Saint Augustin qui combattait le moine Pélage,
défenseur de la liberté de l'homme face au salut, l'Église catholique a conservé l'idée de
prédestination tout en affirmant simultanément le libre-arbitre (position médiane dite du semi-
pélagianisme). Pour Saint Augustin, toute l'humanité souffre du péché, depuis Adam, et seule
la grâce de Dieu peut conduire vers la guérison sa nature qui est viciée par cette faute

originelle. La liberté de l'homme, en elle-même, est impuissante. Ainsi la véritable liberté,
confirmation de la volonté dans le Bien par la grâce, tend-elle à une perfection réservée aux
bienheureux dans l'au-delà.
Alors que les protestants, ont intégré, d’après Max Weber, que la rationalité dont ils
doivent faire preuve se traduit par la mise en œuvre de la doctrine de la prédestination
élaborée par Calvin, qui énonce que le jugement spirituel de l’individu dépend de son
appartenance au peuple élu : « l’humanité est donc partagée entre les élus destinés au salut et
les autres qui seront damnés. Mais le fait d’appartenir à une communauté chrétienne donnerait
une certitude d’être élu ». Ainsi, une application pratique de ce précepte a pu être constaté en
Allemagne, où le capitalisme s’est exprimé comme étant avant tout une éthique, une manière
de considérer et de vivre sa vie, qui passe concrètement par l’augmentation du capital.
Cependant, c’est un moyen en soi, et non une fin, car c’est un labeur, un devoir dont il ne faut
pas profiter matériellement : le calvinisme condamne la jouissance des richesses, qu’il
s’agisse de thésaurisation ou de dépenses, comme étant dangereuse pour le salut de l’âme.
De cette concept de prédestination va découler la notion de libéralisme, et plus
particulièrement de libéralisme économique. Ce libéralisme se situe à deux niveaux :
Le libéralisme politique, qui est basé sur une réflexion philosophique autour de laquelle
la liberté est naturelle : « l’homme règle son action sur la morale naturelle grâce à sa
raison »
1
. Donc, elle dépend de l’homme lui-même et non de son souverain, principe qui sera
confirmé par la révolution française.
Le libéralisme économique, reconnu par Thomas Malthus en Angleterre, puis Jean-
Baptiste Say en France, dont les propositions conduisent à élargir les libertés économiques -
liberté d'entreprendre, liberté de la propriété et des échanges - en réduisant autant que possible
les interventions de l'Etat.
Cependant, même si les différents courants religieux reconnaissent l’existence de la liberté
qui appartient à chaque homme, leurs points de vue divergent quand il s’agit de définir cette
même liberté. Pour les protestants, le libéralisme politique signifie une totale distinction des
préceptes de l’Etat et ceux liés à la pensée religieuse, puisque selon Calvin, « toute l’existence
est soumise aux exigences du christianisme », tout en « critiquant les prétentions des
princes ». Alors que les catholiques demandent le respect de ces derniers, pour conserver une
vision hiérarchisée de la société, et dans les limites de la loi divine. De ce fait, le libéralisme
1
John Locke, 1689 : « Du gouvernement civil ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%