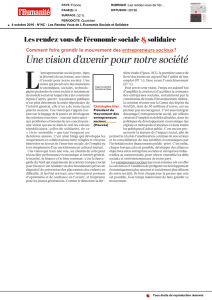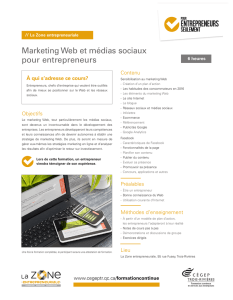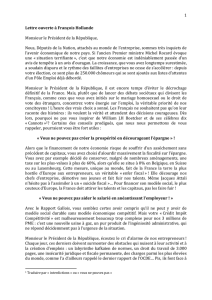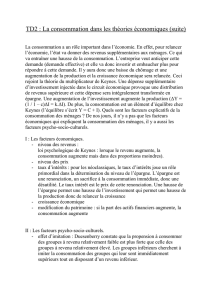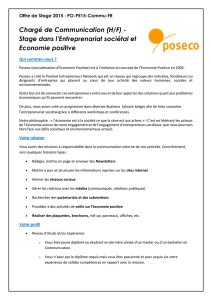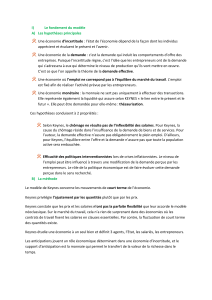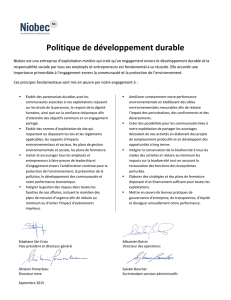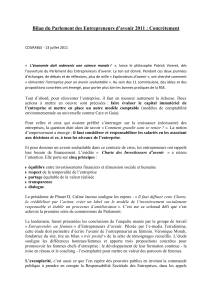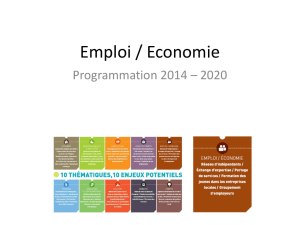L`équilibre macroéconomique keynésien

L’équilibre macroéconomique keynésien.
Œuvre principale = théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie.
Chez Keynes, on s’intéresse aux grandes fonctions économiques, au niveau
macroéconomique. Le but est l’emploi.
L’approche keynésienne privilégie la production et l’emploi. Le but est
d’analyser leurs facteurs qui déterminent leur volume et d’analyser leur
variation.
Alain Barère définit l’économie de Keynes comme une économie monétaire de
production.
La monnaie est introduite dans le modèle dès le début du processus de
production (dès le départ).
Analyse en terme de circuit → on prend en compte les relations entre les
agrégats.
L’environnement est considéré comme incertain et non probabilisable.
Les évènements futurs ne peuvent être qu’escomptés et anticipés.
Les agents économiques face à cette incertitude ont un comportement
d’anticipation. Keynes parle d’anticipation conventionnelle.
Les agents ont tendance à conformer leur décision à celle de l’opinion publique,
commune telle qu’ils la pressentent.
Les volumes de la production et de l’emploi sont déterminés par la demande
globale escomptée qui est l’anticipation des recettes attendues de la vente de la
production
L’ajustement de l’offre et de la demande globale, dans ce modèle, est réalisé
quand les anticipations sont confirmées par le comportement des agents.
Section 1 : Les ajustements de la théorie keynésienne.
Le principe de la demande effective.
Pour Keynes, l’emploi n’est pas déterminé sur le marché du travail par
confrontation de l’offre et de la demande de travail. L’emploi résulte de
l’équilibre sur le marché des biens et services.
I : Définition de la demande effective De.
La demande effective est la somme des dépenses en monnaie effectuées pour
l’achat des biens de consommation et d’investissement tels que les entrepreneurs
les prévoient lorsqu’ils décident de la production à entreprendre et du volume de
l’emploi à mettre en œuvre.

La demande effective est le montant du produit attendu au point de la courbe du
prix de la demande globale déterminé par l’intersection de cette courbe avec
celle du prix de l’offre globale.
II : Le principe.
Le prix de l’offre globale est la valeur monétaire de l’offre.
Le prix de la demande globale est la valeur monétaire de la demande.
On est en équilibre anticipé = équilibre ex-ante c’est-à-dire au moment des
anticipations.
∗ La fonction de l’offre globale (prix de l’offre globale) :
Elle exprime la relation entre le prix de l’offre de la production (Z) et de
l’emploi de N personnes.
Z = f(N)
Ce prix de l’offre globale comprend les dépenses en monnaie nécessaire à la
mise en œuvre de la production telles que les prévoient les entrepreneurs.
Le prix de l’offre comprend : - le salaire en monnaie
- le profit Π (risque suffisant)
- sommes versées aux autres (entrepreneurs,
fournisseurs)
⇒ Y distribuée
⇒ Anticipation d’un certain montant de recettes
La courbe de l’offre globale est croissante en fonction de N (nombre de
personnes).
- le prix de la production (valeur monétaire) augmente quand le volume global
(quantité) augmente.
- Keynes admet l’hypothèse des rendements décroissants. Le coût unitaire de la
production (coût moyen) augmente lorsque la production augmente.
∗ La fonction (prix) de la demande globale :
Elle exprime le montant des produits c’est-à-dire l’ensemble des recettes D
escomptées de l’emploi de N personnes.
D = f(N)
Pour déterminer le montant des produits, les entrepreneurs vont s’efforcer
d’anticiper la dépense que la communauté serait disposée à effectuer pour
l’achat de différents volumes de production.
On est dans le domaine de l’anticipation de la part des entrepreneurs. Ce sont
eux qui anticipent les recettes. Les recettes prévues se basent sur les revenus

distribués ; elles dépendent de la dépense des revenus distribués à partir de
l’offre globale.
Les recettes sont prévues sur la base de comportements conventionnels.
Dans cette analyse apparaît la demande potentielle.
Pour effectuer cette dépense il faut de la monnaie.
Cette demande potentielle ne peut devenir réelle que dans la limite des moyens
monétaires mis à la disposition de la communauté.
⇒ La demande potentielle peut être différente de la demande réelle.
Question que se pose les entreprises :
Existe-t-il des cas (volume d’emplois) où la communauté serait tentée de
dépenser plus si on distribuait plus de revenus ?
Dans ce cas là, l’espoir de profit augmente.
Dynamique du principe
Chez Keynes, on se rend compte que les deux courbes sont liées car les
entrepreneurs font des avances monétaires pour rémunérer les facteurs de
production et aussi car les entrepreneurs peuvent également procéder à des
avances de dépenses d’investissement par le moyen du crédit.
Les avances forment des revenus avec lesquels les agents peuvent dépenser et
les entrepreneurs tentent de prévoir la dépense globale de la communauté.
⇒ D est liée à Z mais pas égale.
Sauf en un point : DE
Il existe une différence de prévision qui entraîne une différence entre les deux
courbes.
Les prévisions concernant la demande globale sont incertaines.

Pour ce volume d’emploi N2, on a D2 > Z2.
En N2, les entrepreneurs estiment que les agents économiques seraient prêts à
dépenser D2 (demande potentielle) alors qu’ils ne disposent que de Z2 en tenant
compte des avances monétaires.
En N2, D potentielle > D réalisable
Les entrepreneurs vont s’efforcer de satisfaire les désirs de dépenses qu’ils
prévoient et donc ils vont augmenter le volume de l’emploi et de la production et
donc ils augmentent le montant des avances.
Au fur et à mesure que les entrepreneurs augmentent le volume de l’emploi, on
remarque que le montant des avances augmente, on voit que le montant de la
demande potentielle augmente mais de moins en moins vite.
On remarque aussi que l’excès entre la demande potentielle et la demande
réalisable (écart entre Z et D) diminue.
⇒ DG = C + I
La demande globale comprend la dépense en biens de consommation et la
dépense d’investissement.
Pour Keynes, le comportement de consommation est déterminé par la loi
psychologique fondamentale.
⇒ l’emploi et la production ne peuvent continuer d’augmenter que si la dépense
d’investissement augmente.
Pour Keynes, il n’y a pas de mécanismes automatiques qui assurent la hausse de
l’investissement. La dépense de l’investissement dépend du taux d’intérêt et
surtout de l’efficacité marginale du capital c’est-à-dire des prévisions des
entrepreneurs.

Puisque la demande potentielle augmente moins vite que l’emploi, les deux
courbes vont forcément se rencontrer en un point d’équilibre prévu par les
entrepreneurs : la DE.
Au-delà de ce point, D < Z c’est-à-dire que demande potentielle < demande
réalisable. Dans ce cas-là, les entrepreneurs ne sont plus incités à augmenter le
volume de l’emploi.
⇒ tant que D > Z, il existe un mobile qui incite les entrepreneurs à augmenter le
volume de l’emploi. Le mobile est l’espoir de profit maximum.
L’équilibre, ainsi établi, au point de la demande effective, fixe le volume
d’emploi N et le revenu national Y qui maximise l’espoir de profit des
entrepreneurs. L’espoir de profit maximum ne coïncide pas forcément avec
l’emploi maximum.
⇒ On peut être en équilibre de sous-emploi.
Cet équilibre anticipé ne sera effectif que si les anticipations sont confirmées par
le comportement des agents économiques.
Section 2 : Les conditions d’équilibre sur le marché des biens et
services.
Chez Keynes, à la différence des néoclassiques, le niveau d’équilibre de la
production globale dépend de la demande en biens de consommation et en biens
d’investissements à travers le principe de la demande effective.
I : Concepts et conditions d’équilibre.
• Hypothèses du modèle keynésien simplifié :
On considère que :
- modèle sans état
- économie fermée
- tous les bénéfices sont distribués c’est-à-dire que seuls les ménages épargnent
- l’investissement autonome net est une donnée c’est-à-dire que la décision
d’investir est exogène
- les grandeurs sont exprimées en unité monétaire constante.
• On doit établir une distinction entre expost et exante.
Un équilibre expost est un équilibre a posteriori c’est-à-dire que les
grandeurs avaient été réalisées. Dans ce cas-là, l’équilibre est une identité
comptable. Cet équilibre est tel que la demande globale est égale à la production
globale.
⇒DG = C + I
Comme tout le produit national est le revenu disponible :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%