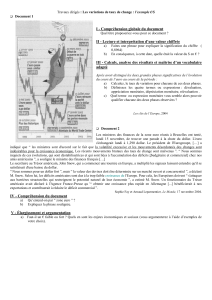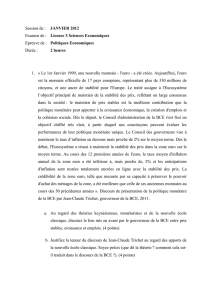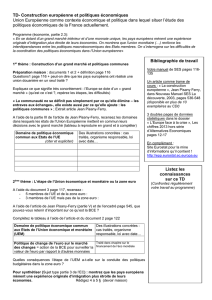Séance 8 - cours

1
La parité euro/dollar, une fatalité ?
Intro
Accroche :
“M. Euro, c’est moi !” Wim Duisenberg
“Je suis M. Euro” Jean-Claude Trichet
Définitions :
La zone euro : 15 pays de l’UE
la parité euro/dollar : le taux de change de l’euro par rapport au dollar.
L’euro et le dollar fluctuent librement sur le marché des changes.
La zone euro se caractérise par un double régime de change :
- irrévocablement fixe en interne,
- librement flottant vis-à-vis du reste du monde.
Fatalité : grave (fatal) ou inéluctable (hasard et obligation : malchance).
La supériorité de l'euro par rapport au dollar est perçue comme durable.
Comparaison entre les politiques de change de l'Union Européenne et des Etats-Unis.
En quoi la politique de change de l’Union Européenne est-elle néfaste ? en quoi le taux de change de
l’euro serait-il inchangeable ?
Intérêts :
La disparition des devises clés a rendu nécessaire le choix d'un régime de taux de change, et a importé
des chocs des États-Unis.
La question du choix du régime de change prend de l’importance lorsque les économies nationales entrent
en concurrence les unes avec les autres pour conquérir des parts d’un marché mondial ou régional de plus en
plus intégré.
Les cas de la Chine et de l’Allemagne illustrent bien ces dernières années cette vérité simple :
- la chine maintient le yuan sous-évalué par rapport au dollar, en dépit de fortes pressions américaines dans le
sens d’un flottement libre
- l’Allemagne a un taux de change nominal élevé, compensé par une baisse des salaires et une contraction de la
demande intérieure.
Les pays de la zone euro sont directement concernés par la question du taux de change.
La question de la politique de change est de première importance macroéconomique dans la zone euro compte
tenu de son impact sur l’inflation, la croissance et la cohésion régionale.
- l’euro flotte vis-à-vis des autres monnaies du monde, en particulier le dollar et le yen, et influence
donc les importations et exportations de la zone.
- les pays de la zone euro peuvent déployer des stratégies réelles de concurrence sociale pour
améliorer leur position compétitive à l’intérieur de la zone, le commerce intra-UE représentant
environ 2/3 du commerce total dans l’UE.
L’évolution de l'euro par rapport au dollar est inattendue et a provoqué des controverses théoriques.
Les deux objectifs de l'euro étaient :
- l'indépendance monétaire
- la croissance.
Aucun de ces objectifs n'a été satisfait.

2
Pb : La parité euro/dollar est-elle un problème insoluble ?
La parité euro/dollar, une fatalité ? ................................................................................................. 1
Intro ........................................................................................................................................................... 1
I – La parité euro/dollar est un problème insoluble dans la configuration économique et institutionnelle
actuelle ...................................................................................................................................................... 3
A – une politique de change critiquée pour ses effets négatifs ............................................................. 3
1. Un euro fort est un piège à croissance faible, en comparaison avec la forte croissance des
États-Unis .......................................................................................................................................... 3
2. La configuration actuelle provoque des inégalités régionales qui poussent à des politiques
non coopératives ............................................................................................................................... 4
B - Un taux de change inchangeable et imposé ................................................................................... 4
1. Un taux décidé arbitrairement par la BCE ................................................................................ 4
a. Indépendante, elle suit une politique inutile ................................................................... 4
b. Dépendante des États-Unis, elle suit délibérément la Fed ......................................... 7
2. Un taux imposé par la Fed ........................................................................................................ 8
a. La dépendance de la zone euro aux chocs en provenance des États-Unis ............. 8
b. Le poids de la régulation américaine repose sur l’euro ............................................... 9
II – La parité euro/dollar pourrait être modifiée par une volonté politique ............................................ 11
A – la BCE pourrait intervenir sur le marché des changes et affirmer l’autonomie de l’euro ........... 11
1. La nécessité d’une politique de relance budgétaire dans la zone euro .................................... 11
2. Coordination de la politique budgétaire et monétaire : deux solutions opposées ....................... 12
B - le contrôle de la parité euro-dollar est impossible sans concertation ........................................... 13
1. La nécessité de la concertation dans la zone euro ................................................................... 13
2. La nécessité de concertation entre les banques centrales ........................................................ 14
Conclusion .............................................................................................................................................. 14

3
I – La parité euro/dollar est un problème insoluble dans la
configuration économique et institutionnelle actuelle
A – une politique de change critiquée pour ses effets négatifs
Un euro fort est-ce grave ?
Quel devrait-être la valeur de l’euro ? une valeur d’équilibre
Un euro faible et souhaitable en récession ou ralentissement économique.
Un euro fort est préférable dans le cas inverse.
Quelle est la valeur d'équilibre de l'euro ?
- à long terme : l'inflation. taux de change de pouvoir d'achat.
- à court terme : l'équilibre de la balance commerciale. taux change d'équilibre fondamental (en fonction de la
balance commerciale et de la production potentielle)
1. Un euro fort est un piège à croissance faible, en comparaison avec la forte
croissance des États-Unis
Le rattrapage des États-Unis a été interrompu :
Dans les années 60, les « 30 glorieuses » avaient contribué au rattrapage des États-Unis.
Depuis les années 90, l'écart entre les États-Unis et l'Union Européenne s'est creusé en dépit de
l'émergence de nouveaux pays industrialisés :
- croissance faible
- chômage
- endettement
Le taux de croissance est inférieur à 2 % depuis les années 90.
Le PIB par tête de la zone euro stagne à 70 % environ de celui des Etats-Unis depuis les années 80.
En 2003, le chômage atteignait presque 9 %, contre 6 aux États-Unis et 5 au Royaume-Uni.
Sur la période 2000-2007 : il y a eu inflation et faible croissance dans la zone euro.
L’euro fort freine la croissance :
1. pertes de parts de marché par dégradation de la compétitivité - prix
2. comportement de marge dans les échanges avec les États-Unis, diminution du profit
3. diminution de l'investissement et de la demande interne : affecte aussi les échanges internes à la zone euro
Étude empirique :
- très grande corrélation entre taux de change et exportation
- les efforts de marge sont réels mais ne compensent pas les pertes de parts de marché
- pas d'effet désinflationniste.
Paradoxalement, les résultats concernant l'inflation sont moins bons qu'aux États-Unis (baisse de 2 à
1,7 %, contre de 2 à 1,1 %).
Cela pourrait être nuancé par des effets bénéfiques de l'appréciation du taux de change. Mais cela n'est pas le
cas dans la zone euro en raison de ses caractéristiques structurelles :
- diminution du taux d'intérêt (mais pas avec la politique restrictive de la BCE)
- diminution du prix des importations, désinflation importée (mais donc limite le développement de l'offre
interne de la zone euro) : affecte aussi les échanges internes à la zone euro
- compensé par la croissance mondiale (nouveaux pays industrialisés) mais pas totalement
- monnaie forte, qui en ferait devenir une monnaie internationale (mais pas dans le cas de l'union
européenne à cause de ses faiblesses intrinsèques)
Raisons des moindres effets bénéfiques de l'appréciation du taux de change : les importations sont surtout intra

4
européenne, et donc inertie ; à la différence d'une pénétration forte des produits asiatiques aux États-Unis.
En conclusion, cela met en évidence les faiblesses structurelles de la zone euro.
Si la croissance est plus faible en Europe, cela est du à d’autres facteurs, notamment :
- domination de la technologie par les Etats-Unis (essentielle en économie mondialisée de concurrence imparfaite)
- rigidité des prix et des salaires : la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale.
- Demande interne
Cela relève de la politique budgétaire.
L’euro ne sert pas la croissance de la zone euro
L’inadaptation de la valeur du taux de change s’est aggravée après l’institution de la monnaie unique.
2. La configuration actuelle provoque des inégalités régionales qui poussent
à des politiques non coopératives
Les effets sont différents selon les pays membres.
Par exemple : L’appréciation nominale de l’euro par rapport au dollar revêt des avantages pour
l’Allemagne : elle réduit le coût en euros des importations extra-européennes (60 % des importations
allemandes), baisse de l’inflation et maintien voire augmentation des marges des entreprises. Le gel des
salaires
La fixité du taux de change nominal entraîne des politiques de concurrence des taux de change réel entre les
pays de la zone euro : concurrence sociale (salaires, prix) et fiscale.
Dans ce cadre, les petits pays sont avantagés : dans l'ensemble, ils font mieux que les États-Unis.
Le faible dynamisme économique de l’Europe peut même s’expliquer par l’anémie des trois grands pays de la
zone euro (Allemagne, France, Italie).
L’émergence d’une maîtrise souveraine de l’euro devient essentielle pour la cohésion régionale.
Ces divergences constituent une des principales difficultés auxquelles est confrontée la BCE. Elles sont une
source potentielle de déséquilibre à terme dans une zone où la mobilité du travail est limitée.
B - Un taux de change inchangeable et imposé
en quoi la politique de change des Etats-Unis influence-t-elle les performances de la zone euro ?
1. Un taux décidé arbitrairement par la BCE
Les instruments de politique de change (intervention sur les marchés, interventions verbales, et taux
d'intérêt) sont concentrés dans la zone euro dans les mains de la Banque centrale européenne et utilisés pour
servir l’objectif de stabilité des prix.
a. Indépendante, elle suit une politique inutile
a) La BCE indépendante : un « hold-up tranquille »
Le taux de change relève normalement du Conseil Européen
Article 111
1. Par dérogation à l’article 300, le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission,
après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix et
après consultation du Parlement européen, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de
change.
2. En l’absence d’un système de taux de change, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations
générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif
principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

5
Les autorités européennes avaient conscience des effets désastreux de leur « cacophonie » sur la « crédibilité »
de la zone euro.
Plutôt que de formaliser la création d’une instance entre la BCE et le Conseil sur la politique de change, les
gouvernements européens ont préféré créer en 1997 une non-institution, l’Eurogroupe, subdivision informelle
du Conseil ECOFIN.
L’Eurogroupe incarne les deux lacunes de la zone euro depuis sa création : un défaut d’autonomie et un défaut
de souveraineté, abandonnée à la BCE.
Conseil européen de Luxembourg 1997 précise la portée de l’Article 111 :
« En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à la politique de change, il est entendu
que des orientations générales de politique de change ne seront formulées que dans des circonstances
exceptionnelles à la lumière des principes et politiques définis par le traité ».
Exemple : Le consensus de Turku : Conseil informel de l’Eurogroupe et du SEBC, Finlande, 1999 :
- le SEBC décidait du moment, du niveau et des montants de réserve consacrés à l’intervention.
- interventions menées après que l’Eurogroupe eut manifesté son accord préalable
- la BCE devait informer les ministres des finances de l’Eurogroupe de l’intervention était en cours.
- déclaration officielle conjointement par la BCE, le Comité économique et financier et l’Eurogroupe.
La politique de change est donc bien une compétence partagée entre le Conseil et la BCE. , la zone euro ne se
distingue pas de la situation américaine, japonaise.
L'objectif principal de l'euro système à la stabilité des prix
Le traité instituant l’Union européenne et une politique monétaire unique dans la zone euro assigne à
l’Eurosystème un objectif principal : la stabilité des prix
Les missions fondamentales de l’Eurosystème consistent à : (Article 105)
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro,
- conduire les opérations de change, détenir et gérer les réserves de change officielles des États
membres,
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement
Le SEBC comprend la BCE et les banques centrales nationales (BCN) de l’ensemble des États membres de l’UE.
La stabilité des prix serait l'unique contribution de la politique monétaire à la croissance économique, à la
création d’emplois et à la cohésion sociale (article 2 du Traité sur les objectifs de la Communauté : « un niveau d’emploi
(...) élevé, une croissance soutenable et non inflationniste, un degré élevé de compétitivité et de convergence des
performances économiques »).
À long terme, l’offre de monnaie affecterait le niveau général des prix mais pas la production réelle ou l’emploi.
L’inflation est fondamentalement un phénomène monétaire.
Le pouvoir de la BCE porte donc principalement sur une politique monétaire (masse monétaire et taux d'intérêt)
- masse monétaire : gérer la liquidité sur le marché monétaire
- taux d'intérêt : influer sur les taux d’intérêt de ce marché
La banque centrale est la seule émettrice de billets de banque et la seule pourvoyeuse de réserves bancaires.
Elle détient donc le monopole de l’approvisionnement de la base monétaire et peut ainsi agir sur les évolutions
économiques.
Outils d'action :
- taux d’intérêt en gérant la liquidité,
- signaler au marché monétaire l’orientation de sa politique monétaire.
- opérations d’open market : refinancement et facilités, pour veiller au bon fonctionnement du marché monétaire
et d’aider les établissements de crédit à satisfaire leurs besoins de liquidité
Principaux instruments :
Les opérations d’open market : à l’initiative de la banque centrale, sur le marché monétaire. La banque
centrale achète des actifs ou accorde un prêt contre des actifs. Permet un refinancement pour une durée
limitée.
Pour contrôler les taux d’intérêt à court terme sur le marché monétaire et de limiter leur volatilité :
facilités de prêt et de dépôt
Le taux d’intérêt appliqué à la facilité de prêt marginal est supérieur au taux du marché, le taux d'intérêt
pour la facilité de dépôt est inférieur au taux du marché. Les établissements de crédit n’utilisent donc ces
facilités que s’il n’existe pas de solutions alternatives.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%