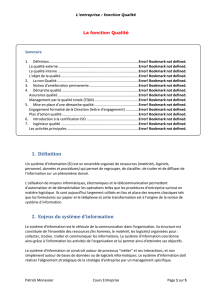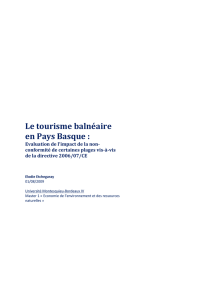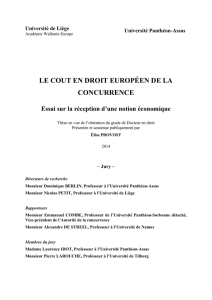I. La construction de l`objet de recherche

SEMINAIRE DE RECHERCHE "SPECIAL SANTE" DU RECEMAP
12, 13, 14 décembre 2002
Les figures de la qualité des soins
Rationalisations et normalisation dans une économie de la qualité
Magali ROBELET
Présentation de thèse en sociologie (soutenance le 17 décembre 2002, au LEST)
"Un effort doit être fait pour assurer la publicité, auprès de la clientèle, des résultats
obtenus par le professionnel qui accepte de se soumettre à l'évaluation de ses pratiques"
1
.
Une telle proposition, émise par la récente "Mission de concertation pour la rénovation des
soins de ville", vient troubler quelque peu l'image classique d'une profession cultivant le goût
du secret.
En employant le terme "publicité", entendu dans son sens le plus littéral de "rendre public",
les auteurs semblent reconnaître ici que le diplôme ne fournit pas une information suffisante
pour fonder la confiance sur laquelle doit reposer toute relation entre un médecin et son
patient. De fait, le diplôme ne fait que renseigner sur les compétences virtuelles du médecin.
Le patient use alors d'autres moyens pour compléter cette information, mobilisant en
particulier son réseau relationnel, puis, une fois la relation engagée avec le médecin,
formulant une appréciation personnelle sur "les" qualités du médecin. Ici, il s'agirait pour le
médecin de rendre public le fait que ses pratiques médicales ont été évaluées par ses pairs,
donc de donner un gage supplémentaire de confiance pour le patient. On peut alors
comprendre cette proposition comme un simple assouplissement des règles déontologiques
concernant l'information publique sur la compétence du médecin
2
. La diffusion d'une
information nouvelle sur la qualité du médecin serait à la fois un moyen de rééquilibrer
l'asymétrie d'information qui règne entre le médecin et le patient et une incitation, au nom de
l'intérêt général, à améliorer les pratiques médicales.
Ce nouveau gage de confiance est en même temps un nouveau "signal de qualité", dont
pourrait disposer le médecin pour se différencier de ses confrères. Il est alors tentant
d'attribuer à la "publicité" un sens proche de "la promotion à des fins commerciales" que lui
donne le marketing. En effet, la publicité dont il est question ici ne s'adresse pas au patient
1
Bernard Brunhes, Bernard Glorion, Lise Rochaix, Stéphane Paul, Mission de concertation pour la rénovation
des soins de ville. Rapport, 5 juillet 2001, p. 7.
2
Rappelons que la transformation de l'information (ville d'obtention du diplôme et qualification dans une ou
plusieurs spécialités) sur la compétence du médecin en message publicitaire est condamnée par le Code de
Déontologie au nom de la nature "non commerciale" de la médecine. On trouve dans les articles du Code et dans
les commentaires qu'en fait le Conseil National de l'Ordre des Médecins la critique répétée de toute "dérive
commerciale" ou "dérive publicitaire". Des règles strictes de signalisation du cabinet sont ainsi mentionnées aux
articles 81, 19 et 25 du Code de Déontologie.

individuel du "colloque singulier" mais à une "clientèle", entité collective abstraite capable de
faire des choix parmi une offre de médecins. Cette proposition pourrait alors être lue comme
la reconnaissance de l'existence d'un marché sur lequel évolueraient à la fois des médecins et
des "clientèles". Finalement, la diffusion d'une information "labellisant" les médecins qui ont
été évalués par leurs pairs, tout en fournissant au patient un nouveau gage de confiance, donne
au médecin un rôle actif dans la construction de cette confiance, en produisant des signaux de
qualité sur un marché. Pour autant, l'importance de cette proposition ne saurait être
surestimée, la qualité des soins dont il est question à travers "l'évaluation des pratiques" est
toujours assimilée à la compétence individuelle du médecin, mesurée ici par la conformité du
comportement du médecin avec les règles préétablies de la "bonne médecine".
D'autres perspectives sont ouvertes lorsque, à la compétence du médecin s'ajoutent de
nouveaux critères de qualité. Ainsi peut-on lire dans l'un des ouvrages "best-sellers" du
management de la qualité dans les établissements de santé : "Gérer la qualité, c'est mettre en
place un processus de type managérial qui implique l'ensemble des acteurs de l'organisation
afin d'assurer la qualité de la prestation et la satisfaction du consommateur de service"
3
. Ici,
c'est moins l'information sur la qualité qui est mise en avant qu'une conception nouvelle de la
qualité des soins. Pour les promoteurs du "management de la qualité", la qualité finale des
soins ne dépendrait plus uniquement de la seule intervention technique (ou relationnelle) du
médecin sur le patient mais de l'action organisée d'un ensemble d'acteurs parmi lesquels
figurent à la fois les managers hospitaliers et les autres professionnels de santé. Dans cette
perspective, l'activité médicale est une prestation de service, visant à répondre aux diverses
aspirations d'un consommateur de soins, qui jugerait la qualité non seulement au regard de la
seule "guérison" mais également en fonction de l'accueil, du sentiment de sécurité ou encore
des délais d'attente. Ici, le "consommateur", cherchant à maximiser la combinaison d'un
certain nombre d'attributs prédéfinis de la "qualité des soins" pourrait être en mesure
d'imposer ses choix aux multiples intervenants de l'organisation des soins.
Ces deux propos ne sont que des illustrations parmi d'autres de discours contemporains
tenus par des médecins, des membres de l'administration de la santé ou des consultants en
management de la qualité des soins. Tous ces discours se parent des attraits de la nouveauté,
du changement ou de la modernité pour promouvoir des méthodes d'évaluation et/ou
d'amélioration de la qualité des soins (l'évaluation des pratiques médicales ou le management
de la qualité). On peut s'étonner de la mobilisation de tant d'efforts de rhétorique pour
convaincre d'un objectif, l'amélioration de la qualité des soins, qui apparaît au premier abord
comme la visée commune et incontournable des médecins, des soignants, des pouvoirs
publics et des usagers de la médecine. C'est que les méthodes en question convoquent de
nouveaux acteurs (l'évaluateur, le consommateur, le manager, l'organisation) au cœur de la
relation entre le médecin et le patient et pourraient bien venir brouiller les rapports entre ces
mêmes médecins, les pouvoirs publics et les usagers.
3
Pierre Anhoury, Gérard Viens, Gérer la qualité et les risques à l'hôpital. Paris : ESF Éditeur, 1994.

I. La construction de l'objet de recherche
La qualité des soins : comment faire d'un lieu commun un objet de
recherche sociologique?
Ces discours sur la qualité des soins viennent d'abord nous rappeler que la "qualité" est
bien ce que recherche en priorité le patient, à titre individuel, lorsqu'il s'adresse à un médecin
ou à une institution de soins. L'activité médicale ne paraît pas assimilable à un marché réglé
par les prix. Du fait de leur caractère administré, les prix ne sont pas des indicateurs fiables de
la qualité de l'activité médicale. Le patient recherche alors la qualité, tout en ne disposant que
de très peu d'information sur elle. Il ne peut se fier qu'au diplôme du médecin, aux jugements
de son réseau relationnel et aux garanties fournies par les règles déontologiques, censées
éviter les abus (l'exploitation de la situation de pouvoir dans laquelle se trouve le médecin) et
garantir le dévouement du médecin auprès de chaque cas particulier. Enfin, le patient n'a pas à
sa disposition de jugements publics sur la qualité établissant une hiérarchie des qualités des
professionnels, qui lui permettraient de choisir "en connaissance de cause". Le diplôme de
docteur en médecine a en effet une valeur unique et ne permet pas (sauf éventuellement
lorsqu'il est fait mention d'une spécialisation du médecin) d'opérer un classement entre les
médecins. Ce mode de relation entre un producteur et un usager définit une forme particulière
d'organisation de la vie économique que Lucien Karpik appelle "économie de la qualité",
réglée par le jugement sur la qualité et non par la connaissance du prix
4
. Ce type de relation
d'échange fait une grande part à la confiance (dans le sens de jugement personnel du patient
sur le médecin) et à l'expression des talents propres du médecin. La qualité des soins est par
ailleurs l'une des finalités naturelles du métier de médecin. Parmi les règles déontologiques,
des injonctions du type "le médecin fait tout son possible pour" ou le célèbre primum non
nocere ("d'abord ne pas nuire") tiennent lieu d'affirmation de la préoccupation pour la qualité
des soins. L'objectif de qualité des soins serait ainsi inscrit d'emblée dans la compétence
(comprise à la fois comme une expertise scientifique et comme un ensemble de savoir-faire
pratiques issus de l'expérience) et le statut du médecin. Si la qualité est au cœur de la relation
d'échange entre le médecin et le patient, comment expliquer que l'expression "qualité des
soins" n'ait fait que récemment l'objet de déclarations publiques ?
Le second enseignement à tirer des discours ambiants sur la qualité des soins tient en effet
dans le constat de leur prolifération sous forme de déclarations, ouvrages, textes de loi, et
actions sur une période récente que l'on peut faire débuter dans le milieu des années soixante-
dix. Cela ne signifie pas que l'activité médicale était jusque-là dépourvue de toute
préoccupation de qualité, mais que dans un contexte particulier, l'amélioration de la qualité
des soins est apparue comme un "nouveau paradigme de l'action collective"
5
, autrement dit
comme une réponse possible à certains problèmes publics. Les problèmes publics pouvant
appeler une réponse en termes d'amélioration de la qualité des soins sont nombreux et d'ordre
divers. On peut penser aux mauvais résultats de santé de la population (mesurés par des taux
de mortalité et de morbidité), à la déshumanisation des hôpitaux, aux erreurs médicales, aux
effets iatrogènes de l'usage de certains médicaments (affaires du talc Morhange ou du
4
Lucien Karpik, "L'économie de la qualité", Revue française de sociologie, 1989, vol. 30, p. 187-210.
5
Michel Setbon, "La qualité des soins, nouveau paradigme de l'action collective?", Sociologie du travail, 2000,
vol.42, n°1, p.51-68.

distilbène dans les années soixante-dix
6
) ou de produits d'origine biologique (scandales du
sang contaminé ou de l'hormone de croissance) ou encore à des problèmes d'efficience du
système de santé (constat d'un surcoût par rapport à des résultats attendus), mis en avant dès
le milieu des années soixante-dix. Derrière la bannière commune de l'amélioration de la
qualité des soins pourraient donc se retrouver plusieurs perspectives d'action, associées à
d'autres mots d'ordre mobilisateurs comme l'équité, la sécurité ou l'efficience. Cette diversité
se retrouve (mais en partie seulement) dans les outils visant explicitement l'évaluation et
l'amélioration de la qualité apparus depuis le début des années quatre-vingt : audits cliniques,
conférences de consensus, production de recommandations de pratiques cliniques, références
médicales opposables (RMO), référentiels de management de la qualité, procédure
d'accréditation ou de certification… Le constat de la diversité des perspectives possibles
associées à l'objectif d'amélioration de la qualité des soins laisse déjà entrevoir que, loin de
faire l'objet d'une définition universelle, la qualité des soins relève bien d'un travail de
construction sociale auquel peuvent participer différents acteurs, et impliquant des choix et
des arbitrages entre plusieurs options.
Les opérations intellectuelles nécessaires à l'élaboration des outils de la qualité des soins
donnent une idée de la nature de ces arbitrages. La décomposition de cette qualité en un
ensemble d'attributs ou de composantes est une opération incontournable de l'élaboration d'un
outil d'amélioration. Elle conduit à privilégier certaines composantes par rapport à d'autres
(par exemple, la bonne exécution de gestes techniques plus que le résultat collectif de
l'activité médicale), sur lesquelles devront porter les efforts d'amélioration et à identifier des
acteurs responsables de cette amélioration. Cette opération permet alors de formuler une
"bonne façon de faire" propre à toute entreprise de normalisation. Tous les outils d'évaluation
et d'amélioration de la qualité reposent en effet sur un constat d'hétérogénéité des
comportements, qu'il s'agisse des comportements individuels du médecin dans ses actes
techniques ou des comportements organisationnels des équipes de soins, qu'ils prétendent
réduire en les rapprochant de comportements de référence. Du coup, on comprend que
certains outils, en fonction des attributs de la qualité qu'ils privilégient et du type de norme de
bonne pratique qu'ils proposent, pourraient porter atteinte à l'autonomie du professionnel dans
son travail quotidien, entendue comme sa capacité à exercer sa liberté de jugement (les anglo-
saxons disent "discretion") sur chaque cas particulier qu'il rencontre. L'ampleur de cette
atteinte à l'autonomie dépendra toutefois de la nature de ces bonnes pratiques (qui les a
élaboré et sur quoi elles portent).
L'élaboration des outils suppose une seconde opération qui consiste à trouver des moyens
pour inciter les acteurs identifiés comme "responsables de la qualité" à améliorer la qualité
des soins. Parmi ces incitations figurent des sanctions en cas de non qualité mais également
l'émission de jugements publics sur la qualité des soins, pouvant conduire à une hiérarchie
publique des qualités offertes par les "producteurs" (qu'il s'agisse de producteurs individuels
ou d'organisations de soins). Dans tous les cas, l'amélioration de la qualité des soins suppose
une plus grande transparence de l'activité médicale et légitime l'intrusion du regard extérieur
sur cette activité. Qu'ils soient ou non associés à des dispositifs publics de jugement de la
qualité, les outils d'amélioration de la qualité des soins seraient donc susceptibles d'accroître
le pouvoir des "régulateurs" (l'État, l'assurance maladie, mais aussi les managers hospitaliers)
et/ou celui des patients face aux médecins.
Les outils combinent ainsi, chacun à leur manière, des critères différents de qualité et une
transparence plus ou moins forte, en fonction de la représentation que leur promoteurs se font
6
Dans le premier cas, plusieurs nourrissons sont décédés à la suite de l'utilisation d'un produit d'hygiène
comportant un composant dont l'innocuité n'avait pas encore été démontrée. Dans le second, une étude a montré
au début des années soixante-dix le caractère cancérigène, pour la descendance féminine, d'un médicament censé
lutter contre la prématurité et distribué depuis les années cinquante.

de l'activité médicale et de l'utilisation qui est attendue de l'outil : diminuer la mortalité,
maîtriser les dépenses de santé, limiter la survenue d'incidents, fournir une meilleure
information du patient qui pourrait alors faire des choix plus efficients, améliorer la
performance des établissements de santé… Autrement dit, les outils d'amélioration de la
qualité des soins sont bien des construits sociaux, reposant sur une représentation parmi
d'autres de la réalité (ici l'activité médicale) et lui donnant sens, tout en proposant diverses
façons d'agir sur elle
7
. Il convient donc, si l'on veut comprendre les mutations dont ils seraient
porteurs, de rapporter ces outils à leurs conditions sociales de production et à l'identité de
leurs promoteurs.
L'amélioration de la qualité des soins pourrait conduire, par des voies diverses, à la fois à
l'introduction de nouveaux jugements sur la qualité des soins et à la transformation des
pratiques médicales et organisationnelles. Le constat de ces bouleversements potentiels
nous conduit à formuler le projet général de notre travail en ces termes : il s'agit de
prendre la mesure des changements dont le paradigme de la qualité des soins peut être
porteur, à la fois quant à l'exécution et l'organisation du travail médical et quant aux
rapports qui lient les médecins aux pouvoirs publics et aux usagers de la médecine.
Pour mener à bien ce projet, nous proposons d'inscrire le développement des
préoccupations pour l'amélioration de la qualité des soins dans un processus plus général de
rationalisation des activités médicales. Le fait que l'ambition d'améliorer la qualité des soins
passe par des exigences de normalisation et de transparence, nous autorise en effet à
l'interpréter comme une composante d'une entreprise de rationalisation. Nous ne voulons pas
dire par là que les activités médicales ne seraient pas rationnelles. L'histoire de la médecine
est, de fait, marquée par des vagues de rationalisation. La médecine cherche à fonder
rationnellement (sur la science, en particulier sur la méthode expérimentale) son action sur les
corps et elle se dote pour cela d'instruments de diagnostic (depuis le stéthoscope jusqu'à
l'imagerie médicale) et d'instruments de classification des maladies dans des nosographies et
des tableaux cliniques. Le mouvement de spécialisation de la médecine ou l'intégration des
progrès techniques peuvent également être considérés comme des formes de rationalisations.
Dans tous les cas, l'activité médicale se trouve décomposée, classifiée et les processus de
décision simplifiés.
Il s'agit plutôt ici de poser l'hypothèse selon laquelle la rationalisation dont il est
question avec l'apparition d'outils d'amélioration de la qualité est d'un autre ordre et
comporte une dimension d'inédit. Ces outils partagent avec d'autres, comme les outils de
codage des activités médicales hospitalières dans des "groupes homogènes de malades",
associant à chaque prise en charge type un coût de référence, ou l'informatisation des dossiers
de soins, mais également, à un niveau plus macro-économique, les mouvements de
restructurations de l'offre de soins (regroupements d'établissements de soins et/ou
fonctionnement en réseau), le souci de la mesure, de la transparence et de l'efficience.
Autrement dit, l'apparition de ces outils n'est pas dictée par la seule évolution des savoirs
scientifiques mais également par des exigences de productivité, d'efficience, de performance,
de standardisation de la production, propres aux activités industrielles et par des exigences
d'adéquation fine avec une "demande", propres à une représentation "marchande" de l'activité
médicale
8
. En ce sens, les activités médicales seraient engagées dans le même type de "grande
7
Comme l'ont bien montré à propos des outils statistiques Alain Desrosières dans La politique des grands
nombres. Histoire de la raison statistique. Paris : La Découverte, 1993 et Laurent Thévenot, par exemple dans
"Statistique et politique. La normalité du collectif", Politix, 1994, n°25, p. 5-20.
8
Les dimensions multiples de cette rationalisation de l'activité médicale sont traitées dans les articles réunis dans
le numéro spécial de Sociologie du travail (n°1, 2000) consacré à "Les acteurs de la santé publique et les
réformes", et sont présentées de façon synthétique par Catherine Paradeise, en introduction de ce numéro
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%