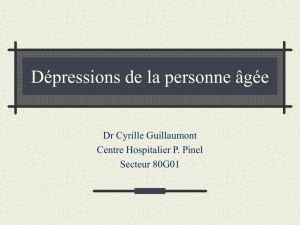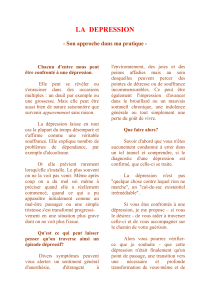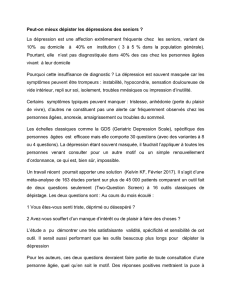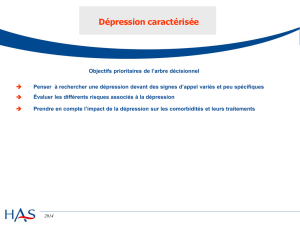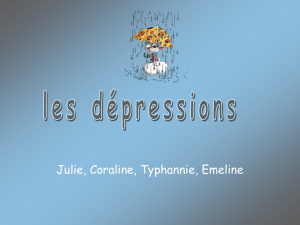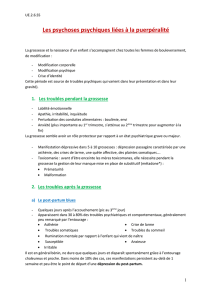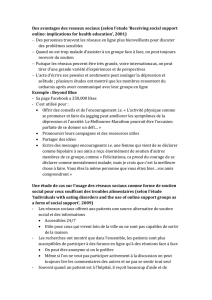Dépressions sévères : gènes et environnement

© L’Encéphale, Paris, 2009. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2009) Supplément 7, S306–S309
Disponible en lignesur www.sciencedirect.com
journalhomepage: www.elsevier.com/locate/encep
Dépressions sévères : gènes et environnement
Severe depression: genes and the environment
P. Gorwood(a), (b)
(a) Inserm U894, Centre Psychiatrie et Neurosciences. 2 ter, rue d’Alésia, 75014 Paris, France
(b) CME, Hôpital Sainte-Anne, 100 rue de la Santé, 75014 Paris
Résumé Les patients souffrant d’un épisode dépressif avec des antécédents familiaux sont généralement
considérés comme plus endogènes, de sévérité plus marquée, et donc de plus mauvais pronostic (par
exemple pour le risque de récurrence). L’opposition classique entre les dépressions « névrotico-
réactionnelles » et les dépressions « endogènes » est ici remise en question, du fait des aspects
confusionnants de l’âge de début et des biais de sélection. L’existence d’une interaction entre les gènes
de vulnérabilité (G) d’une part, et des facteurs de risque tels les événements de vie stressants (E)
d’autre part, est considérée comme particulièrement intéressante, évitant une opposition bien artificielle
entre ces deux sources de vulnérabilité. L’approche G*E requiert des échantillons encore plus importants
et accroît encore un peu plus le risque de faux positifs, mais ne peut que séduire du fait d’être plus
proche de la réalité des mécanismes impliqués dans la dépression.
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
L’auteur n’a pas signalé de conits d’intérêts.
MOTS CLÉS
Trouble de l’humeur ;
Dépression ;
Vulnérabilité
génétique ;
Environnement ;
Interaction
gène*environnement
KEYWORDS
Mood disorder ;
Depression ; Genetic
vulnerability ;
Environment ;
Gene*environment
interaction
Abstract Depressed patients with a familial history of depression are usually considered as more endogenous,
with higher severity, therefore with a worst prognosis (regarding for example recurrence risk). The opposition
between « neurotic-stress linked depression » and « endogeneous-genetically related depression » is being
challenge in the present review. Indeed, differences in age at onset and selection bias are probably important
confusing factors. The existence of an interaction between the involved vulnerability genes (G) and the
triggering stressful events (E) was considered as providing meaningful insight for the respective parts of
genetics and the environment. Although this approach is even more fragile regarding required sample sizes
(larger) and the problem of false positive results (increased), the G*E approach is seducing as closer to reality,
the onset of complex disorders being usually explained by those two risk factors.
La dépression des sujets génétiquement
vulnérables est-elle plus sévère ?
La psychiatrie française a cette particularité d’aimer la
richesse sémiologique, la distinction de tableaux originaux
et de sous-types spéciques, c’est-à-dire de favoriser la
reconnaissance de spécicités qui permettent de reéter la
grande diversité de la clinique des dépressions. Elle s’op-
pose en cela assez franchement à l’approche anglo-saxonne
dont les maîtres mots sont efcacité et simplicité, parfois
au prix de simplications abusives.
La distinction de deux pathologies dépressives distinc-
tes, névrotico-réactionnelles versus endogènes, est parti-
culièrement ancrée dans nos pratiques. On oppose ainsi

Dépressions sévères : gènes et environnement S307
l’idée d’une organicité à forte sévérité (au fort poids géné-
tique, par exemple) à une psychogénécité (de sévérité
moindre, et très liée aux événements stressants de la vie).
Ainsi les dépressions endogènes (mélancoliques) sont mar-
quées par les signes somatiques (anorexie, amaigrisse-
ment), l’importance du risque suicidaire et la réponse à
des traitements plus lourds (électroconvulsivothérapies et
antidépresseurs tricycliques). Dans le même sens, plusieurs
études retrouvent, chez les « mélancoliques », des modi-
cations neuro-endocriniennes plus importantes que dans
les dépressions non endogènes. Lors du test à la dexamé-
thasone, l’absence de freinage du cortisol s’avère par
exemple plus marquée. On a aussi pu relever à l’enregistre-
ment polysomnographique du sommeil une latence plus
courte à l’apparition du sommeil paradoxal (REM) dans les
dépressions endogènes [10].
L’ensemble de ces données semblent clairement indiquer
que les dépressions pour lesquelles le poids des facteurs
génétiques est plus important (dépressions endogènes) sont
plus sévères. Et pourtant… il n’en est probablement rien.
La réfutation du rôle des facteurs génétiques dans la
sévérité des dépressions tient sur plusieurs arguments.
Les risques de se tromper de conclusion à partir des
analyses portant sur les dépressions endogènes sont impor-
tants. En effet, ce sont essentiellement les caractéristi-
ques de mélancolie selon les critères internationaux qui
sont utilisées dans les études portant sur la dépression
endogène. Or les dépressions mélancoliques sont avant
tout plus sévères, et ont donc logiquement des anomalies
plus franches aux tests biologiques (du fait de leur plus
grande sévérité) et une réponse thérapeutique souvent de
meilleure qualité (du fait de leur plus grande homogé-
néité). Seule la mesure parallèle des marqueurs biologi-
ques dans les deux groupes de patients déprimés, en
maîtrisant la sévérité de la dépression, pourrait permettre
de valider une réelle dichotomie.
Si le concept de dépression endogène est licite, et si les
dépressions endogènes ont effectivement un enracinement
plus explicite dans la vulnérabilité génétique, on doit retrou-
ver une homotypie. L’homotypie est la probabilité accrue
(par rapport au hasard) de retrouver, chez des apparentés
atteints, le même type de dépression que celui observé chez
le sujet index. Plus évident encore, on s’attend à ce que le
sujet qui fait une récurrence thymique présente le même
tableau endogène (trait et non état). Cela ne semble claire-
ment pas le cas, les dépressions ayant toutes une tendance
à s’aggraver avec le temps (essentiellement par la répétition
des épisodes), et donc à être bien peu stables chez un même
individu. Cette aggravation acquise est d’ailleurs bien en
accord avec le concept de « kindling » (embrasement, ou
vulnérabilité acquise), et renvoie au concept souvent déve-
loppé de la neurotoxicité des épisodes dépressifs per se [5].
Il est amusant que cette homotypie soit aussi mise à mal du
côté de l’autre facteur de risque essentiel, c’est-à-dire les
événements de vie stressants. Dans une ancienne et large
étude portant sur l’analyse du poids des événements de vie
dans la dépression, Brown & Harris [2] ne retrouvent pas de
différence de nombre et de sévérité des événements de vie
stressants chez les sujets ayant fait un premier épisode
dépressif quand on distingue le type endogène versus non
endogène.
Avec l’intention d’authentier deux types étiologiques
de dépression, l’une génétique et l’autre non, l’équipe de
Peter McGufn [1] a étudié la prévalence familiale de la
dépression chez des jumelles monozygotes concordantes
ou non pour la dépression. Séparant les familles où les deux
vraies jumelles sont atteintes toutes les deux (en faveur de
facteurs génétiques importants) de celles ou une seule des
deux jumelles est atteinte (plutôt en faveur de facteurs
environnementaux non génétiques, seuls facteurs de risque
singularisant les vraies jumelles). Une différence étiologi-
que devrait être associée à une différence nette de préva-
lence dans les familles des jumelles concordantes (nombreux
apparentés atteints, puisque ce serait une forme généti-
que-endogène de dépression) par rapport aux jumelles dis-
cordantes (faible nombre d’apparentés atteints, puisque ce
serait une forme réactionelle-non endogène de dépres-
sion). Or les résultats inrment cette hypothèse puisque le
risque de dépression n’est pas supérieur dans les familles
des jumelles concordantes. Ceci va à l’encontre d’une
hétérogénéité génétique et suggère qu’il n’existe pas deux
formes étiologiques distinctes, mais que les différentes for-
mes de dépression seraient plutôt liées à un poids plus ou
moins fort des facteurs de risque (dont ceux liés à la géné-
tique), une répartition variable de l’importance respective
des facteurs génétiques et environnementaux.
Une autre étude réalisée par Kendler [7] s’est penchée
plus directement sur la nature de la distinction entre
dépression endogène et dépression exogène. Sur un groupe
de 2 000 jumelles, extraites de la population générale, le
diagnostic de dépression majeure et de mélancolie a été
recherché. La relation entre mélancolie et risque de
dépression majeure chez l’autre jumelle est alors évaluée.
Dans ce travail, il n’est pas retrouvé de concordance pour
la mélancolie entre les jumelles, contrairement à la dépres-
sion dans son ensemble, ce qui va clairement à l’encontre
de l’existence de deux étiologies distinctes. De plus,
l’étude retrouve une forte prévalence de dépressions dans
les familles de sujets ayant une dépression sévère, c’est-à-
dire ayant les caractéristiques mélancoliques.
Au total, il paraît donc important de souligner que les
facteurs de vulnérabilité génétique participent à toutes les
formes de dépressions, quelque soit le niveau de sévérité.
Lorsque ces facteurs sont très apparents (lourds antécé-
dents familiaux par exemple), le sujet est d’abord porteur
d’une diathèse plus forte (génétique ou non), la dépression
sera donc potentiellement plus sévère. Cela ne constitue
pas un rationnel sufsant pour conclure que ce sont les fac-
teurs génétiques qui déterminent la sévérité du trouble.
La question de la place des facteurs génétiques dans la
sévérité dépressive s’est longtemps contentée de considé-
rer les gènes d’une part, et les événements de vie stres-
sants de l’autre, comme si ces deux entités étaient
parfaitement indépendantes. Cette opposition de facto
répond à une certaine cohérence. En effet, la peau des
petits pois de Mendel était peu sensible à la rigueur de
l’hiver ou au niveau d’humidité (stress environnemental),
et c’est en partie cela qui a servi à Mendel pour poser les

P. GorwoodS308
lois de l’hérédité, c’est-à-dire de deviner la distribution
des pois à peau lisse versus fripée en fonction des lignées
parentales d’origine. Néanmoins, la génétique des patholo-
gies polyfactorielles se dénomme aussi « non-mende-
lienne », puisque justement un seul gène ne peut à lui tout
seul comprendre l’ensemble des phénomènes en jeu. Cette
génétique plus complexe rend mieux compte de la variabi-
lité phénotypique (de présentation), et s’est récemment
rapprochée, encore un peu plus, de la réalité (complexe)
de l’ensemble des facteurs impliqués, en incluant la possi-
bilité d’une interaction entre les facteurs génétiques et les
facteurs environnementaux.
La vulnérabilité innée (génétique)
doit elle s’opposer à la vulnérabilité
acquise (environnementale) ?
Les études portant sur l’interaction gène-environnement,
le plus souvent dénommé dans la littérature « GxE », cher-
chent à décrire comment les facteurs génétiques et envi-
ronnementaux modulent conjointement le risque de
développer une pathologie donnée (Fig. 1). Elles nécessi-
tent donc de connaître les informations sur ces deux fac-
teurs. La vulnérabilité génétique peut être évaluée par
l’histoire familiale ou donnée par une analyse directe de la
séquence d’ADN. Les facteurs environnementaux sont
mesurés par les études épidémiologiques à partir d’infor-
mations rapportées par le sujet ou repérées systématique-
ment par des enquêteurs. Différents modèles (Fig. 1)
rendent compte de ces interactions selon la manière dont
les facteurs environnementaux modient l’expression de la
vulnérabilité génétique, selon l’intensité de l’exposition à
ces facteurs environnementaux, et enn selon le mode de
transmission supposé des facteurs génétiques [4].
L’étude faisant référence dans l’interaction entre les
facteurs génétiques et environnementaux pour expliquer
un épisode dépressif est probablement celle de Caspi et al.
[3]. Dans cette étude, il est fait l’hypothèse qu’un poly-
morphisme fonctionnel situé dans le promoteur du gène
codant pour le transporteur de la sérotonine (5-HTTLPR)
pouvait moduler l’impact des événements de vie stressants
sur la vulnérabilité à la dépression. En dehors de l’élégance
du protocole global, cette étude avait l’énorme avantage
d’une population large (plus de 1 000 sujets) et d’un suivi
prospectif de très grande qualité puisque l’évaluation a
porté de la naissance jusqu’à plus de 20 ans, avec des éva-
luations au moins annuelles (Fig. 2).
Le gène codant pour le transporteur de la sérotonine
est un gène candidat de choix pour la dépression, cette
protéine étant la cible des antidépresseurs. L’allèle court
(ou s pour short) du polymorphisme 5-HTTLPR, étudié
comme facteur de risque génétique dans cette étude, dimi-
nue l’expression du transporteur de la sérotonine (muta-
tion fonctionnelle), augmenterait (modestement) le risque
de dépression, et serait associé à moins de chance de
réponse aux antidépresseurs.
Dans leur cohorte, l’effet propre du génotype du poly-
morphisme 5-HTTLPR n’était pas signicatif pour expliquer
la dépression, alors que lorsque l’on limite les analyses aux
sujets qui ont été récemment exposés à un stress majeur
l’allèle s était fortement prédictif. En effet, les sujets por-
teurs d’une ou deux copies de l’allèle court du gène 5-HTT
développent plus de symptômes dépressifs ou de syndrome
dépressif caractérisé ou encore de conduites suicidaires
dans les suites d’événements de vie difciles que les sujets
homozygotes pour l’allèle long. Cette interaction entre le
gène 5-HTT et les événements de vie difciles dans le ris-
que de dépression a été plusieurs fois répliquée mais avec
quelques résultats négatifs. Une méta-analyse de ces étu-
Figure 1
A = Les facteurs de susceptibilité génétique peuvent surexposer des individus à des facteurs de risque environnementaux
(corrélation gène*environnement).
B = Des facteurs de risque précoce peuvent modier l’accès à des gènes de vulnérabilité (épigénétique).
A’ & B’= Le même type d’interaction peut se retrouver pour des facteurs de protection et de résilience.
C & D = Une partie non négligeable de la vulnérabilité est acquise du fait même de la présence du trouble (C-neurotoxicité de la
dépression), mais ce handicap peut se révéler une nouvelle source de renforcement pour d’autres (D).
Facteurs environnementaux précipitants
Facteurs environnementaux de résilience
Gènes de vulnérabilité
Gènes de protection Épisode
dépressif
B'
A'
A
BC
D

Dépressions sévères : gènes et environnement S309
Conclusions
Percevoir le rôle des facteurs génétiques dans la compré-
hension du niveau de sévérité de la dépression requiert de
commencer par distinguer plusieurs concepts. Sont en effet
impliqués l’effet temps (aggravation naturelle des épisodes
avec leur répétition, comme en témoigne par exemple la
réduction de l’intervalle inter-critique pour les épisodes
récurrents), l’effet du nombre de facteurs de vulnérabilité
repérés (leur quantité bien plus que le type de facteur en
question) et quelques caractéristiques cliniques potentiel-
lement confondantes (l’âge de début précoce, par exem-
ple, traditionnellement associé à la présence d’antécédents
familiaux, semble être un facteur de risque majeur pour le
nombre total d’épisodes sur la vie, essentiellement du fait
d’un temps d’exposition plus long). Ces distinctions prises
en compte, il ne semble pas possible d’associer, pour la
dépression, vulnérabilité génétique et sévérité. L’existence
d’une interaction entre les différents facteurs de risque,
comme les gènes de vulnérabilité et les événements stres-
sants, montre de manière heuristique qu’il est important
d’appréhender tous les facteurs de risque potentiellement
impliqués, quelle que soit leur origine, an de comprendre
l’émergence d’un épisode, sa répétition ou son type de
présentation, ou son niveau de sévérité.
Références
[1] Andrew M, McGuffin P, Katz R. Genetic and noon-genetic sub-
types of major depressive disorder. Br J Psychiatry 1998 ;
175 : 523-526.
[2] Brown GW, Harris TO, Hepworth C. Life events and endoge-
nous depression. A puzzle re-examined. Arch Gen Psychiatry
1994 ; 51 : 525-34.
[3] Caspi A, Sugden K, Moffitt TE et al. Influence of life stress on
depression : moderation by a polymorphism in the 5-HTT
gene. Science 2005 ; 301 : 386-389.
[4] Dubertret C, Gorwood P. Interaction Gène-Environnement en
psychiatrie. In : Manuel de Psychiatrie. Edited by Julien-Da-
niel Guelfi & Frédéric Rouillon. Masson Paris France : Elsevier ;
2007 ; pp. 91-97.
[5] Gorwood P, Corruble E, Falissard B et al. Toxic effects of
depression on brain function : Impairment of delayed recall
reflects the cumulative length of the depressive disorder in a
large sample of depressed out-patients. Am J Psychiatr 2008 ;
165 : 731-739.
[6] Hariri AR, Mattay VS, Tessitore A et al. Serotonin transporter
genetic variation and the response of the human amygdala.
Science 2002 ; 297 : 400-3.
[7] Kendler KS. The diagnostic validity of melancholic major
depression in a population-based sample of female twins.
Arch Gen Psychiatry 1997 ; 54 : 299-304.
[8] Pezawas L, Meyer-Lindenberg A, Drabant EM et al. 5-HTTLPR
polymorphism impacts human cingulate-amygdala interac-
tions : a genetic susceptibility mechanism for depression. Nat
Neurosci 2005 ; 8 : 828-34.
[9] Risch N, Herrell R, Lehner T et al. Interaction between the
serotonin transporter gene (5-HTTLPR), stressful life events,
and risk of depression : a meta-analysis. JAMA 2009 ; 301
(23) : 2462-71.
[10] Young MA, Keller MB, Lavori PW et al. Lack of stability of the
RDC endogenous subtype in consecutive episodes of major
depression. J Affect Disord 1987 ; 12 : 139-43.
des n’est pas favorable, mais à ce niveau de complexité
(deux facteurs en jeu plus leur interaction), la réplication
stable et homogène est peu attendue [9].
Plus récemment encore, l’équipe de Weinberger [8] a
montré que les sujets porteurs de l’allèle court du 5-HTT
avaient plusieurs particularités qui pourraient permettre
de comprendre cette vulnérabilité dépressive face aux évé-
nements de vie. En effet, à partir d’une IRM structurale et
fonctionnelle réalisée chez plus de 200 sujets sains, cette
équipe a trouvé :
a) des modications anatomiques de l’amygdale et du
cortex cingulaire,
b) une interaction altérée entre certaines structures
sous-corticales (complexe amygdalo-hippocampique) et
corticales (préfrontale et cingulaire) essentielles dans la
gestion des émotions,
c) des modications fonctionnelles du traitement de
l’information (hyperactivation amygdalienne en situation
d’anxiété).
Ces résultats proposent donc un chaînon manquant
entre la vulnérabilité génétique et les mécanismes neuro-
biologiques impliqués dans la dépression. Cela permet de
rappeler que les facteurs de vulnérabilité génétique ne
peuvent coder pour une pathologie aussi complexe, un
sous-type spécique ou un niveau de sévérité. De manière
bien plus cohérente, ce type de protocole montre que cer-
tains facteurs génétiques de vulnérabilité ont un (petit)
rôle dans la « manière d’être au monde » (tempérament)
qui renvoie (aussi) à une mécanique spécique du traite-
ment de l’information par notre cerveau. Les sujets por-
teurs de l’allèle s ont ainsi moins de capacité à la maîtrise
cognitive (complexe et différée) des émotions négatives
(simples et rapides). Il faut alors sélectionner des sujets
exposés à des facteurs de stress récents [3], ou les confron-
ter à un équivalent émotionnel [6] pour repérer le rôle
(génétique) de l’allèle court du 5-HTT, qui serait resté
inapparent sans cette exposition (environnementale).
Figure 2 Effet synergique de la présence d’un allèle de
vulnérabilité (ici l’allèle court-s pour short- du gène
codant pour le transporteur de la sérotonine) et du
facteur précipitant « événement de vie stressant » an
d’expliquer pourquoi certains sujets (mais pas tous) font
des dépressions au décours d’un événement de vie
stressant (modèle de la cohorte de Caspi et al. 2003) [3].
Événement
de vie stressant
Allèle « s »
du 5-HTT
Allèle « I »
du 5-HTT
EDM
pas EDM
1
/
4
100%