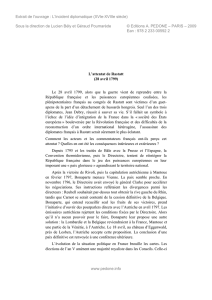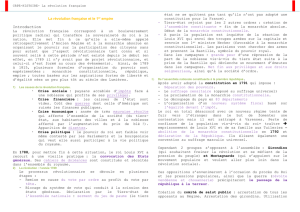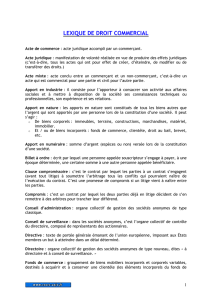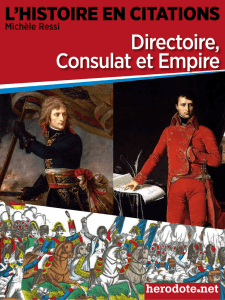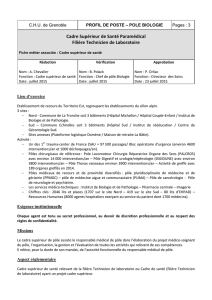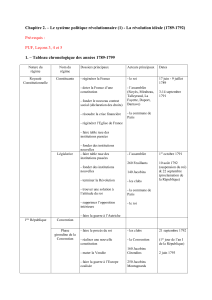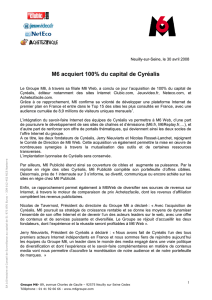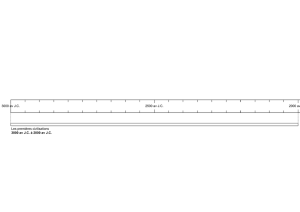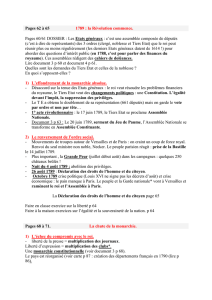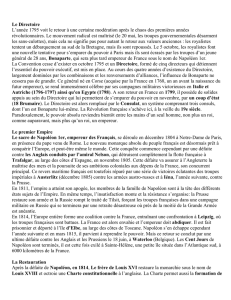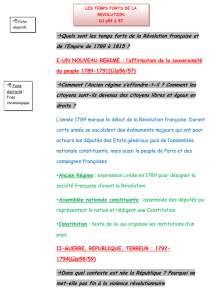directoire

DIRECTOIRE
Le Directoire a duré à peine plus de quatre ans (26 octobre 1795 – 10 novembre 1799):
brève période dans la vie d’un homme, dans celle d’un peuple. Entre la Convention et
l’époque napoléonienne, le Directoire est souvent présenté comme une transition: liquidation
des espoirs révolutionnaires, préparation du pouvoir personnel. Il faut se garder pourtant de
l’illusion historique qui juge une époque par rapport à un avenir, aujourd’hui connu, mais dont
elle ne savait rien: il faut considérer le Directoire en lui-même, c’est dans la perspective de la
fin de 1795 que l’on doit se placer pour essayer de comprendre la France et les Français
face à leur avenir immédiat. De ce point de vue, le régime qui s’instaure est essentiellement
une tentative pour stabiliser et consolider la situation du moment, pour remettre un peu
d’ordre, et un ordre durable, après six ans et demi de révolution. C’était, à vrai dire, la
seconde tentative de ce genre. Mais la première – la Constitution de 1791 – s’était soldée
rapidement par un échec. Après la révolution du 10 août 1792, il avait fallu en venir à un
régime d’exception, nécessité par la guerre, extérieure et intérieure. Mais, en 1795, après la
pacification de l’Ouest, après la dislocation de la coalition ennemie, le moment paraît venu
de revenir à un régime normal, défini par un ensemble de lois votées par la Convention
finissante (la Constitution de l’an III et les décrets annexes). Par réaction contre les trois
années précédentes, pour écarter les contraintes subies, on essaye d’organiser une
république modérée et libérale, avec le souci de la rendre acceptable pour tous les Français.
1. Situation territoriale et démographique
La France de 1795 est plus grande que celle de 1789. Aux acquisitions qui datent déjà de
quelques années (Avignon, la Savoie, Nice, les anciennes enclaves allemandes, l’évêché de
Bâle devenu département du Mont-Terrible) viennent de s’ajouter les ex-Pays-Bas
autrichiens, occupés depuis 1794 et incorporés à la République française par la loi du
1er octobre 1795: quelque 580 000 km2 dans les «limites constitutionnelles». Le territoire
national est libre de toute présence étrangère, à l’exception de la Corse que les Anglais
n’évacueront qu’en 1796. Bien plus, les troupes françaises occupent, outre quelques hautes
vallées piémontaises, la majeure partie de la rive gauche du Rhin, dont certains dirigeants
envisagent l’annexion, lorsqu’une paix victorieuse aura été signée avec l’Autriche et l’Empire:
agrandissements qui accroissent sensiblement la part des populations non francophones.
La République compte environ 32 millions d’habitants, dont 28 millions sur le territoire de
l’ancien royaume. C’est dire que le bilan démographique des six dernières années, malgré
l’émigration, malgré la guerre et la Terreur, malgré le «creux» de 1795, est positif, avec des
taux, pour 1 000, de 34,5 (natalité), 32 (mortalité), 10 (nuptialité). La population est donc
nombreuse, et jeune: 11,5 millions de Français ont moins de dix-neuf ans, 14 millions ont
entre vingt et soixante-quatre ans. Enfin, elle est en grande majorité rurale, dense surtout au
nord de la Loire: le chiffre de la population urbaine n’est guère que de 5 millions d’habitants,
répartis dans trois grandes agglomérations de plus de 100 000 âmes (Paris 640 000), dans
quelques centres d’importance moyenne (Toulouse 60 000, Strasbourg 50 000) et dans de
nombreuses petites villes.
2. Difficultés économiques et financières
Du point de vue économique, la France a très peu changé depuis 1789. Elle reste un pays
essentiellement rural, dans lequel les travaux des champs n’ont pas été modifiés par les
bouleversements politiques et sociaux. La «révolution agricole» amorcée vers le milieu du
siècle sous l’influence des physiocrates se poursuit lentement. La jachère recule à peine, les

prairies artificielles se heurtent à une méfiance tenace; seule la culture de la pomme de terre
rencontre quelque succès. Le pays continue de vivre dans la crainte de la disette, toujours
possible en cas de mauvaise récolte: c’est ce qui se produisit en 1795, mais les récoltes de
1796, 1797 et 1798 furent excellentes, et celle de 1799 à peine moins bonne. Dans
l’industrie, c’est toujours le type artisanal qui domine, sans qu’on puisse faire état, depuis
1789, d’inventions techniques marquantes. Le nombre de machines à vapeur n’augmente
pas, non plus que celui des métiers dans l’industrie textile. La production industrielle est,
dans l’ensemble, inférieure à ce qu’elle était en 1789. On distingue bien quelques chefs
d’industrie actifs et entreprenants: Oberkampf, Ternaux, Richard et Lenoir, Chaptal. Le
gouvernement, en la personne de François de Neufchâteau, ministre de l’Intérieur s’efforce
d’encourager ces novateurs par l’exposition industrielle qui s’ouvre à Paris en septembre
1798. Mais il ne s’agit que d’initiatives isolées, d’entreprises pilotes, dirait-on actuellement,
qui ne reflètent nullement l’ensemble de l’activité industrielle sous le Directoire.
Cette vie économique, encore très liée au passé, est gênée par deux circonstances:
mauvais état des communications, difficultés financières et monétaires qui ne seront
surmontées que postérieurement au régime directorial. Tous les témoignages concordent
pour signaler l’état déplorable des routes, mal entretenues et, de plus, peu sûres en raison
du développement du brigandage. Les canaux ne sont pas en meilleur état. Les ports
supportent les conséquences de la guerre maritime. Les Anglais occupent une partie des
colonies et capturent les vaisseaux français qui se risquent sur les mers. En 1797, la flotte
marchande française représente environ le dixième de ce qu’elle était en 1789. Les ports de
l’Atlantique et de la Manche sont les plus atteints, le commerce méditerranéen se maintenant
mieux de 1796 (signature de l’alliance franco-espagnole) à 1798 (expédition d’Égypte): mais
la prise d’Aboukir redonne aux Anglais la maîtrise de la Méditerranée. Le Directoire prohibe
l’entrée des marchandises anglaises, préfigurant ainsi le blocus continental napoléonien;
cependant, la guerre gêne l’exportation qui, malgré les victoires continentales, a diminué de
moitié par rapport à 1789.
Bien plus grave est la crise financière, qui revêt successivement deux aspects. Le
Directoire avait hérité de la Convention une énorme quantité de papier-monnaie. Ne valant
presque plus rien (moins que le prix du papier), l’assignat fut supprimé le 18 février 1796 et
remplacé un mois plus tard par des mandats territoriaux gagés sur les biens nationaux non
encore vendus. Démentant l’espoir mis en lui, le nouveau papier s’effondre encore plus vite
que l’assignat: le 4 février 1797, le mandat est démonétisé, les impôts devant être acquittés
en numéraire. Cette mesure énergique n’assainit pas la situation: le numéraire était rare
(300 millions peut-être, contre 2 milliards à la fin de l’Ancien Régime). À l’inflation succédait
la déflation, génératrice de baisse des prix. Dans cette France rurale, elle touche surtout les
cultivateurs, qui doivent payer en numéraire fermages et impôts, alors que la vente de leurs
produits au marché local ne leur procure qu’une faible quantité de ce numéraire. Ainsi
s’explique que la conjoncture économique de la période soit celle d’une dépression, dont le
creux se situe en 1798-1799, et qui ne prendra fin qu’en 1801-1802.
3. La nouvelle société
Si l’on compare la société du Directoire à celle de l’Ancien Régime, un trait retient avant tout
l’attention: la disparition des ordres privilégiés, clergé et noblesse. «La loi est la même pour
tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.» Celles qui frappent les prêtres réfractaires et
les émigrés sont des mesures de circonstance, rigoureuses certes, mais destinées à
disparaître lorsque la paix sera revenue et que les ennemis de la République, cessant de
compter sur l’appui de l’étranger, pourront être réintégrés, comme citoyens, dans la
communauté nationale. Les anciens nobles qui n’ont pas émigré et qui ont survécu à la
Terreur ont conservé leurs propriétés foncières et, s’ils ne perçoivent plus de droits

seigneuriaux, en touchent néanmoins les fermages. Par leurs revenus, par leur genre de vie
(sinon par leur mentalité), ils se rapprochent de la classe dominante, la bourgeoisie.
Celle-ci est en plein essor. Mais elle est loin de former un bloc homogène. Des bourgeois
ont souffert de la Révolution, tandis que d’autres en profitaient. Parmi les premiers, on
compte ceux qui ont émigré et dont les biens ont été confisqués, les «officiers» et (en partie)
les hommes de loi, les rentiers ruinés par l’inflation. Par contre, ont tiré profit des
événements ceux qui possèdent de la terre ou des maisons (biens nationaux ou non); ceux
qui ont placé leurs capitaux dans des banques étrangères; ceux qui se consacrent à
l’industrie, au commerce ou à la banque, et dont le plus représentatif est le Grenoblois
Claude Perier. Dans ce monde bourgeois du Directoire, deux traits sont à noter. C’est
d’abord l’ascension d’une petite bourgeoisie issue des artisans ou des commerçants.
Enrichis par les affaires, ils achètent des biens nationaux et font donner à leurs enfants une
éducation qui leur permettra de devenir fonctionnaires ou – mieux – de s’orienter vers les
professions libérales. C’est aussi l’apparition, non d’une classe, mais d’un milieu: les
«nouveaux riches», qui ont fait une rapide fortune par des moyens plus ou moins honnêtes.
Tels les fournisseurs aux armées, souvent groupés en compagnies: Hainguerlot, Rochefort,
Flachat, Ouvrard. L’«immoralité» du Directoire est celle de ces nouveaux riches et de leurs
protecteurs politiques, Barras et Talleyrand; ses ridicules aussi: « merveilleuses » et
«incroyables» tiennent plus ou moins à ces milieux où la richesse s’allie volontiers à la liberté
de mœurs et à l’excentricité de la tenue. Écume peu nombreuse et superficielle, à laquelle il
serait tout à fait injuste de réduire la bourgeoisie de l’époque. Il y a parmi celle-ci, aussi bien
à Paris qu’en province, une grande majorité de familles honnêtes et solides qui formeront les
cadres de la nation pendant tout le XIXe siècle.
On est assez mal renseigné sur les ouvriers des années 1795-1799. Le mot recouvre
deux types de travailleurs: d’une part les artisans (libres par la suppression des
corporations), de l’autre les ouvriers des «manufactures» encore peu nombreuses. Dans
l’ensemble, les salaires sont plus élevés qu’en 1789. Mais on redoute le chômage, toujours
menaçant en cas de marasme des affaires, et – au moins au début, du fait de la mauvaise
récolte de 1795 – la famine. Au printemps de 1796, des émeutes éclatent dans les villes
d’une certaine importance, comme Amiens ou Rouen. Les pouvoirs publics essayent d’y
remédier en créant des bureaux de bienfaisance et en distribuant des vivres. La situation
s’améliore après 1797, année de bonne récolte et de pain bon marché, alors que les salaires
baissent moins vite que les prix.
Les paysans représentent la grande masse de la population française. Le nombre de ceux
qui sont propriétaires est plus grand qu’en 1789, par la mise en vente des biens nationaux:
mais ce sont surtout les paysans riches qui peuvent acheter de la terre, car les
administrations de la période directoriale mettent en vente des lots étendus, afin d’éviter le
morcellement excessif de la terre. Au début de la période, les fermiers ont profité de
l’inflation qui leur permet de payer en papier des fermages fixés en numéraire, et de se
libérer à meilleur compte des dettes hypothécaires; mais on a déjà indiqué quelle gêne leur
apporta le retour à la monnaie métallique. Il faut enfin signaler un trait caractéristique des
campagnes à cette époque: l’insécurité, du fait des bandes de « chauffeurs » plus ou moins
déguisés en chouans: telle la «bande d’Orgères», l’une des plus redoutables, qui jusqu’à sa
capture, en 1798, terrorisa le sud de l’Eure-et-Loir.
4. Mentalités et attitudes
Ce qui définit l’attitude des Français à l’automne de 1795, c’est moins le jugement qu’ils
portent sur tel ou tel article de la Constitution (combien l’ont lue?) que le souvenir laissé par
six années de troubles, les craintes et les espoirs devant un avenir bien incertain.

Le catholicisme en question
Leur préoccupation majeure est d’ailleurs d’ordre religieux plus que politique. Sans vouloir
nier la déchristianisation déjà poussée de certaines régions, il reste que le catholicisme
demeure «la religion de la majorité des Français», comme le constatera le concordat de
1801. Or, après la destruction de l’ancienne Église de France en 1790, après les
persécutions de 1791 à 1794, après la séparation de l’Église et de l’État découlant de la loi
du 18 septembre 1794, l’an III de la République (1794-1795) est marqué par un renouveau
religieux: réouverture des églises, reprise du culte. Mais quel culte? Les catholiques sont
divisés. L’ancien clergé constitutionnel essaye de se reconstituer sous la direction d’Henri
Grégoire, ex-conventionnel et évêque du Loir-et-Cher, qui parvient à réunir un synode à
Paris en 1797. Mais cette Église «gallicane» est en porte à faux, car elle ne se conçoit
qu’appuyée par l’État. Quant aux réfractaires, qui se sont maintenus dans le pays même
pendant la Terreur, leur position est renforcée par le retour plus ou moins clandestin en
1795, 1796 et 1797 des prêtres émigrés. Mais ils n’adoptent pas une attitude unanime à
l’égard du pouvoir: les «soumissionnaires» acceptent de prêter le serment (exigé par la
Constitution) de soumission et obéissance aux lois de la République, tandis que leurs
adversaires, suivant les directives des évêques émigrés, persistent à identifier catholicisme
et royalisme. Un nouveau serment de «haine à la royauté et à l’anarchie», exigé par le
Directoire après Fructidor (1797), introduit encore une division au sein des soumissionnaires.
Fructidor marque d’ailleurs une reprise de la persécution religieuse qui provoque chez les
catholiques lassitude et désarroi, d’autant que la destruction de l’État pontifical en 1798, la
mort de Pie VI en 1799 semblent annoncer la disparition prochaine du catholicisme.
Un royalisme équivoque
Catholicisme, royalisme: l’équivoque subsiste chez beaucoup d’ecclésiastiques. Mais chez
les fidèles? L’existence d’un courant royaliste en France n’est pas niable (il n’avait jamais
cessé depuis 1792): la reprise de la chouannerie dans l’Ouest en 1795-1796, l’insurrection
parisienne du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), les élections aux Conseils du nouveau
régime sont là pour le prouver. Mais de quelle royauté s’agit-il? La grande erreur des
émigrés (sauf quelques esprits avisés) est de s’être imaginé que le pays accepterait
facilement le retour à l’Ancien Régime à peine corrigé par le programme royal du 23 juin
1789. Or s’il était un point sur lequel tous les Français se trouvaient d’accord, c’était bien la
volonté de ne pas revenir à l’ancien régime social fondé sur l’existence d’ordres privilégiés,
et à ses conséquences financières qui s’appellent, pour les paysans, dîmes et droits
seigneuriaux. Beaucoup souhaitaient une monarchie constitutionnelle du type 1791,
partageant le pouvoir entre le roi et la nation – une nation dont les «honnêtes gens»
formeraient la classe dirigeante. Mais pas plus que Louis XVI, son successeur en exil,
Louis XVIII, n’était disposé à accepter une telle solution. On voit dès lors l’équivoque des
élections de l’an V (printemps 1797): les Français qui donnèrent leurs voix aux adversaires
du Directoire espéraient bien contraindre les «triumvirs» à démissionner; mais si leurs
représentants étaient entrés en pourparlers avec Louis XVIII en vue d’une restauration de la
monarchie, leur tentative aurait sûrement échoué devant l’intransigeance du roi «légitime».
Ou, si ce dernier avait consenti à faire quelques concessions, ce n’aurait été là qu’une
tactique dilatoire, en attendant de rétablir la royauté telle qu’elle était en 1789.
Pour une république bourgeoise
Il est difficile d’évaluer le nombre des royalistes. Mais chez beaucoup de Français
l’attachement à la république est un fait, et on n’a pas de raisons de mettre en doute leur

sincérité, quels qu’en soient les mobiles. Mais là aussi une question se pose. Quelle
république veut-on? Si la Terreur blanche, la chouannerie, l’expédition de Quiberon, le 13
vendémiaire ont renforcé l’idée républicaine, le souvenir détestable laissé par les années
1793-1794 est un des traits de psychologie collective qu’il serait dangereux de sous-estimer.
On désire une république modérée, sans atteinte à la liberté et à la propriété, un régime
réparateur qui puisse faire rapidement l’unanimité de la nation. C’est le programme du
Directoire et des députés qui le soutiennent. Il a contre lui (malgré la politique de
«ralliement» de la fin de 1796) les royalistes, mais aussi une «opposition de gauche»:
anarchistes, jacobins, exclusifs, comme les qualifie le Directoire. En réalité, ce sont des
«nostalgiques de l’an II» pour qui tout n’était pas à blâmer dans la façon dont la Convention
et le Comité de salut public ont gouverné. Ce courant persiste pendant toute la durée de la
période directoriale: clubistes du Panthéon et babouvistes en 1795-1796, jacobins des
élections de l’an VI (1798), patriotes de l’été de 1799. Mais le pays ne les suit pas. La
république bourgeoise satisfait les vœux de la majorité des Français.
5. La classe politique
Les auteurs de la Constitution de l’an III avaient visé à éviter tout retour aux pratiques de
1792-1794: pas de gouvernement direct, pas de suffrage universel; élections censitaires
donc, et à deux degrés. À la base il doit y avoir un cens très large: il suffit, pour élire juges de
paix et administrateurs communaux, de payer une contribution directe. Mais les électeurs,
choisis par les citoyens pour désigner les membres des tribunaux, les administrateurs de
département et les députés aux Conseils, devaient être propriétaires, usufruitiers ou
locataires de biens fonciers dont la valeur, évaluée en journées de travail, variait suivant les
cas de cent à deux cents de ces journées: on comptait en tout quelque 30 000 électeurs (sur
3 millions et demi de citoyens réunissant les qualités requises), sensiblement moins que
sous le régime de la Constitution de 1791; mais, à la différence de celle-ci, il n’était pas exigé
de cens pour être nommé aux diverses fonctions judiciaires, administratives ou politiques.
Il ne fut pas facile de mettre en place l’organisation prévue. Peu sont candidats à des
fonctions publiques dont les responsabilités, tant matérielles que morales, apparaissent
comme singulièrement lourdes. Les démissions sont fréquentes et les remplacements de
plus en plus difficiles. Le Directoire s’est fait donner le droit de destituer les administrateurs
jugés douteux ou incapables, mais là aussi le problème du remplacement se pose. Si l’on
élimine les crypto-royalistes, il ne reste que les républicains modérés ou les «jacobins»: les
«coups de barre» à gauche ou à droite qui marquent la politique du Directoire à l’échelon
national se font sentir également dans les départements, non sans engendrer incohérence et
lassitude.
Tout dépend donc, en définitive – et en dépit des précautions contre leur «despotisme»
inscrites dans la Constitution – de la personnalité des cinq directeurs auxquels est confié le
pouvoir exécutif. Tous les ouvrages consacrés à la période exposent les oscillations de leur
politique: arrestation des babouvistes (10 mai 1796) et essai pour rallier une partie de la
droite; coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) qui entraîne des mesures
rigoureuses contre les royalistes et les réfractaires; coup d’État (cette fois sans appui de
l’armée) du 22 floréal an VI (11 mai 1798) qui élimine des Conseils les députés jugés trop «à
gauche». Ces ouvrages insistent également sur la stabilité dont bénéficie le Directoire
pendant un an (mai 1798-mai 1799), et qui lui permet de faire voter d’importantes lois,
notamment en matière fiscale et militaire.
Directeurs, ministres, hauts fonctionnaires, députés membres du Conseil des Anciens et
de celui des Cinq-Cents, commissaires du Directoire auprès des administrations
départementales constituent une «classe politique» assez homogène, en dépit des nuances
tenant aux options individuelles. Beaucoup viennent des administrations mises en place en
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%