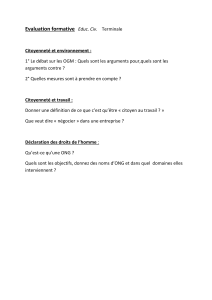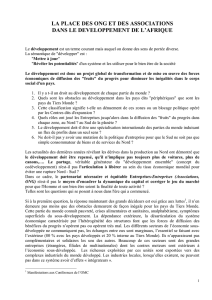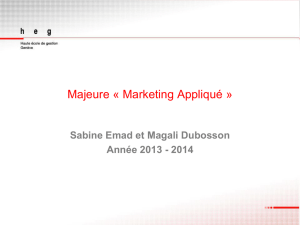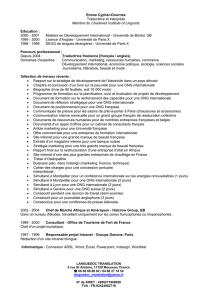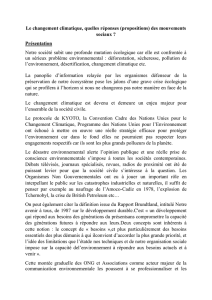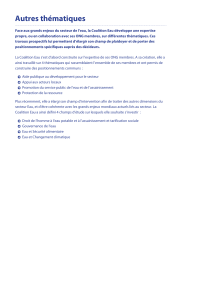des initiatives locales aux plans de villes

1
DES INITIATIVES LOCALES AUX PLANS DE VILLES
SYNTHESE REGIONALE
AFRIQUE DE L’OUEST
A PARTIR DES ETUDES DE CAS ET DES DISCUSSIONS
DEMBELE Ousmane
ONG Cités – Urbaines
Quelles sont les leçons que nous avons apprises en Afrique de l’ouest au sein du réseau HEC
dans la gestion de l’environnement urbain ? Comment les ONG et les organisations de bases
ont coopéré avec les administrations gestionnaires des villes pour assurer la qualité du cadre
de vie dans les milieux urbains en Afrique de l’ouest ? Quels sont leurs succès qui peuvent
être présentés comme du chemin parcouru dans la quête de méthodes de gestion participative
plus durables de l’environnement urbain ? Quelles sont en Afrique de l’ouest, au stade de
deux années de lancement du programme HEC de gestion de l’environnement urbain, les
difficultés qui subsistent dans l’effort du passage de l’échelle de gestion environnementale des
quartiers, à une échelle urbaine globale intégrant les ONG et les organisations de bases
comme des partenaires institutionnels des plans d’assainissement des villes ?
Ce sont là des questions fondamentales auxquels les études de cas appuyées des autres
expériences sous régionales de gestion de l’environnement urbain apportent des éclairages.
Des efforts de gestion de l’environnement urbain dans toutes les villes de la sous région
Les appels d’offres d’étude de cas lancés par ENDA Tiers Monde dans le cadre de
l’évaluation du présent cycle de projets HEC montre une diversité d’initiatives dans les
domaines suivant :
- Gestion des eaux usées,
- Gestion des ordures ménagères,
- Equipement en bornes fontaines des quartiers,
- Construction et gestion des latrines,
- Compostage des ordures ménagères.
Ces expériences dans les villes ont été conduites par les ONG qui y ont associé les
populations dans le cadre d’initiatives locales de gestion de l’environnement des quartiers. Les
trois études de cas donnant une idée de chacune des expériences citées plus haut et qui ne sont
pas limitative du champ de connaissances qui ont servi à la réalisation de cette synthèse
régionale sont :

2
Le cas de d’Avotrou. Dans les cas d’Avotrou au Bénin l’expérience initiée par le Centre pour
l’Education Environnementale est celle de l’assainissement de quartiers précaires qui consiste
en l’utilisation de motopompes et de chlore pour le traitement des inondations et en la collecte
puis le tri des ordures ménagères.
Le cas de Nouakchott. A Nouakchott en Mauritanie, l’ONG Terre Vivante en relation avec
l’Association Féminine pour la Salubrité et l’Hygiène (AFSHP) assure avec les femmes la
collecte des ordures ménagères dans les quartiers pauvres et riches de la capitale, le nettoyage
de la voirie envahie par le sable et les branchages, et l’évacuation des eaux usées.
Le cas de Yaoundé. La League for Woman and Child Education s’occupe dans le cadre du
PSU du nettoyage des rues de Yaoundé en faisant participer les femmes et les jeunes. Le cas
de Yaoundé illustre ce qui se fait en la matière dans la plupart des capitales africaines qui ont
eu de plus en plus recours aux ONG ou aux associations dans le cadre de travaux à haute
intensité de main d’œuvre, pour assurer certaines fonctions de nettoyage des villes que ne
remplissaient pas bien les sociétés concessionnaires d’ordures.
Des méthodes participatives communes à toutes les expériences de gestion de
l’environnement dans la sous-région
Les expériences de gestion participative de l’environnement dont font état ces cas, ont connu
des améliorations sensibles dans leur méthodologie notamment en ce qui concerne
l’établissement d'un partenariat entre toutes les parties prenantes à la question de la gestion
des quartiers et de la voirie. Les études de cas illustrent les précautions que les ONG prennent
de plus en plus pour identifier correctement les rôles des acteurs dans les projets de gestion de
l’environnement. Les cas d’échecs fréquents de projets dus à de mauvaises identifications et
évaluations des rôles des acteurs, et les procédures de choix des acteurs sont abondamment
discutés au cours des projets de sorte que, les risques de se tromper sur la qualité des associés
sont fondamentalement minimisés par les ONG. Celles-ci ont appris à bien connaître la
société civile et font une distinction nette entre les acteurs possibles des projets
environnementaux. Les distinctions femmes et jeunes dans les trois projets d’Avotrou, de
Nouakchott et de Yaoundé correspondent à des modes opérationnels dans les projets
d’assainissement que pilotent ces ONG. Les expériences de Yaoundé et de Nouakchott
mettent en relief la fonctionnalité des femmes dans tous ce qui touche au domaine de
l’assainissement. Les risques qui découlent de mauvais choix sont assez bien connus par les
ONG au travers des séminaires sous régionaux et nationaux.
Un meilleur montage institutionnel des projets d’assainissement
Les trois cas des études commandées en vue de faire le bilan de la gestion l’environnement
urbain sont des modèles quasi généralisés dans la sous région en ce qui concerne la manière
dont s’organisent ces types de projets. Le diagnostic de situation environnementale par
l’ONG, le sondage des partenaires civils, la prise de contact avec l’administration, les
arrangements de la structure opérationnelle et les montages institutionnels des projets ont
connu au travers de ces projets des améliorations sensibles. On observe par exemple que sur le
sujet sensible de la coopération avec les mairies et les administrations centrales chargées de la
gestion des villes, que les ONG parviennent à mieux faire valoir leurs actions et celles des
organisations de base. Dans les trois études de cas, la connexion ONG et mairie fonctionne
assez bien pour permettre de mieux apprécier les actions à la base entreprises par les
populations. A l’image de ces études de cas, il existe dans la sous région, suffisamment

3
d’ONG expérimentées pour réduire les erreurs dans le montage institutionnel des projets
d’assainissement. Cela n’exclut pas que des difficultés relationnelles ou des faiblesses
apparaissent soit au niveau des acteurs, soit au niveau des objectifs ou de l’organigramme du
projet. Mais les ONG sont assez averties et sont à l’écoute des points possibles de blocage
pour entreprendre des corrections par elles - mêmes ou faire appel à des compétences en vue
de les aider dans ce sens. Les discussions qui ont lieux à propos des études de cas, ont mis en
relief l’extrême vigilance que la plupart des ONG actives de la sous région mettent à vérifier
leur démarche dans la façon dont elles organisent leurs projets de gestion participative de
l’environnement.
Des résultats satisfaisants qui entraînent des changements d’échelle
Les trois cas de figurent de projets d’assainissement conduits par les ONG dans la sous région
illustrent le fait que les associations interviennent dans les villes au niveau d’un quartier, au
niveau de plusieurs quartiers et même au niveau de la ville entière. Ces différentes tailles
d’intervention méritent d’être présentés dans leur contexte pour les comprendre. L’implication
des ONG et des OCB dans le nettoyage des villes était une expérience novatrice dans les
années 1980 qui allait contre les pratiques habituelles d’assainissement de la ville. Bien que
les ONG défendent une pratique raisonnable de gestion de l’environnement urbain par la
participation de la société civile, il ne leur fut pas possible d’appliquer leur façon d’opérer à
l’échelle de la ville. Leur propre manque de pratique dans la gestion du fait urbain d’une part,
et les résistances des administrations d'autre part, sont principalement les causes d’expériences
qui se sont limitées aux échelles des îlots et du quartier. La démonstration de l’efficacité des
organisations populaires sous l’encadrement des ONG a confirmé leur place dans la gestion de
la ville ce qui leur a permis d’étendre progressivement leur champ d’action de l’îlots au
quartier (cas d’Avotrou), à plusieurs quartiers urbains, (cas de Nouakchott) et des parties
entières de la ville (cas de Yaoundé). Ces changements d’échelles s’accompagnent du passage
des OCB du stade de l’action bénévole à celui de l’activité lucrative dans le cadre d’une
économie populaire urbaine, c’est - à - dire d’une production et d’une rétribution de service
par la masse.
Les ONG et les OCB se conduisent bien face aux nouveaux challenges que constitue
l’encadrement des groupes associatifs à ces nouvelles échelles de la ville. Leur fonction
d’assainissement sont bien appréciées des populations et même des mairies. Des problèmes
spécifiques subsistent cependant lorsque l’efficacité de leurs actions les amène vers ces
changements d’échelle d’intervention.
Les problèmes de la gestion participative de l’environnement: du quartier à l’échelle des
plans de villes
Les expériences ouest africaines d’assainissement des villes par les ONG et les organisations
de base montrent des cas de figure similaire dès le moment où les ONG prétendent prendre
une part plus active dans l’assainissement à l’échelle de la ville.
Les succès des ONG à l’échelle des quartiers sont en général bien accueillis par les mairies et
les démembrements du gouvernement qui sont chargés de la gestion de la ville, tel que le
montrent les différents cas d’Avotrou, de Nouakchott et de Yaoundé. Dans le cas de
Nouakchott, les autorités urbaines ont même félicité l’ONG et attribué un prix de plusieurs
autres distinctions à son responsable pour la propreté de la ville. L’ASPHA a obtenu aisément
l’accord des autorités urbaines pour étendre son expérience à plusieurs autres quartiers de la
ville.

4
Les changements d’échelle s’accompagnent cependant d’effets dont les ONG et les groupes
associatifs portés par la légitimité et l’efficacité de leur intervention ne mesurent pas
immédiatement l’ampleur. Les ONG et les groupes associatifs comptabilisent leur succès en
comparant leurs résultats à ceux des entreprises officielles d’assainissement agréées soit par le
gouvernement soit par les mairies. Le cas d’Avotrou à Cotonou en est un exemple où l’ONG
montre qu’elle est plus efficace que l’entreprise d’assainissement. A Yaoundé et à Nouakchott
les résultats des ONG mettent sérieusement à mal les entreprises concessionnaires de
l’assainissement. Il s’en suit que le changement d’échelle d’efficacité que demandent les ONG
signifie la concurrence avec ces entreprises. Cela veut dire aussi que l’action purement sociale
marginale et non lucrative des ONG et des OCB timidement engagées dans les quartiers, se
mute progressivement en une activité économique qui menace les entreprises officielles au
niveau de l’important marché de l’assainissement. Par le biais des sociétés concessionnaires
c’est tout "l’establishment" de la collusion entre les administrations gestionnaires des villes et
les sociétés qui s’estime visée par des organisations populaires qui aspirent de bonne foi à
mieux gérer l’environnement et le marché qui en découle. Les mairies et les Ministères font
alors obstacle en empêchant les expériences des ONG de se réaliser à l’échelle des villes. Cela
va des refus d’autorisations, aux refus des assistances techniques et financières nécessaires
pour rendre plus opérationnelles l’action des ONG et des GIE à l’échelle urbaine.
Si la coopération entre ONG et gouvernement est rendue difficile au niveau des collectifs
d’ONG qui aspirent apporter leur expérience à l’échelle de la ville, les administrations
n’envisagent pas du tout l’implication des ONG et des OCB et des GIE en tant que membres
officiels des commissions des plans d’assainissement des villes.
Les handicaps du statut des ONG et des GIE à l’échelle des plans de villes
L’un des écueils évoqués par les administrations, est le statut des acteurs de la gestion de
l’assainissement urbain notamment la qualité d’ONG, d’association, de GIE ou de
coopératives qui n’est pas compatible avec des fonctions assumées par les sociétés anonymes
à responsabilité limitée comme le sont les entreprises délégataires. Il apparaît nécessaire de
résoudre ces problèmes qui n’en sont pas fondamentalement, si on pose que la mission de
service public peut être satisfaite par des organisations non foncièrement capitalistes même à
l’échelle de la ville quand cela implique des marchés importants.
Dans la sous région l’expérience des ONG en matière d’assainissement des quartiers est si
bien consolidée qu’il faut envisager maintenant la participation des GIE et des ONG à la
planification et la réalisation des programmes d’assainissement des villes. Il importe
d’envisager dans cette optique les soutiens qu’il faut leur apporter en terme logistique
financier et organisationnel.
Des problèmes technologiques rencontrés par les ONG et les GIE dans le passage à
l’échelle de la ville

5
Une autre difficulté relevée par les études de cas et les discussions qui les ont accompagnées
en ce qui concerne la sous région, sont les problèmes d’ajustement technique que les ONG et
les GIE rencontrent sitôt que leurs activités impliquent d’intervenir plus largement dans
plusieurs quartiers ou à l’échelle de la ville. Le matériel de collecte des ordures, les méthodes
de gestion des eaux usées, ne sont plus adaptés à ces échelles qui nécessitent des stations
épuration, ou à la place des charrettes, des véhicules plus conventionnels. Les efforts des
ONG et des groupements de précollecteurs tendant à trouver des solutions à ces problèmes
sont limités par les administrations qui ne souhaitent pas les voir entrer dans les monopoles
concédés.
Ces freins institutionnels et technologiques consciemment entretenus sont aujourd’hui les
facteurs fortement limitant de la promotion des initiatives locales de gestion de
l’environnement par les groupes associatifs et les ONG dans les villes d’Afrique de l’ouest.
Cela fait de la coopération ONG-Gouvernement un des axes majeurs de défrichement pour la
prochaine décennie afin de permettre la participation juste et efficace de la société civile à la
gestion de l’environnement urbain.
1
/
5
100%