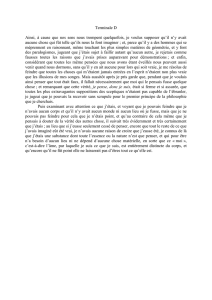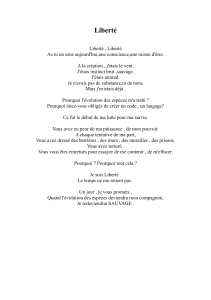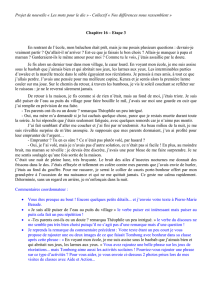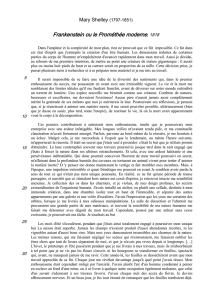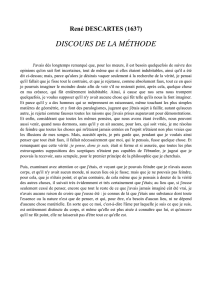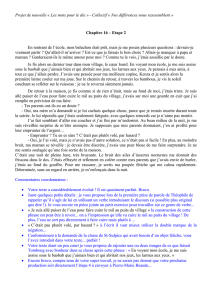Word - Le Château d`Avanton

Le
roman
d’un
homme
heureux
(67)
(Feuilleton
autobiographique
de
Pierre
Parlier)
Ainsi s’étaient dénoués les fils de mon enfance.Parfois il m'arrivait de rêver encore… j’habitais toujours là-bas,
ici je n’étais qu'en vacances, bientôt j’allais retrouver les ânes du square Bresson, les arcades de la rue
Bab-Azoun, le petit fou, le minushabens… Au réveil quel n’était mon soulagement de réaliser mon erreur !
Sauvé ! j’étais sauvé ! Une fois de plus je m’en étais tiré !…
Dans ma hâte de fuir mon passé et de m’enraciner dans ma nouvelle existence je me jetais sur toutes les
occasions avec une sorte de boulimie, et comme toujours les différentes parties de ma vie ne collaient pas
ensemble, demeuraient séparées les unes des autres, et tout au fond il y avait la survivance du moi ancien que
j’entretenais comme une vieille plaie, avec une jouissance morbide : l'ennui des longs dimanches à vagabonder
dans les rues, suffocant de désir sans objet, en quête d’aventures toujours inaccessibles (et je me répétais en
marchant les vers d’Apollinaire : J'erre à travers mon beau Paris sans avoir le coeur d'y mourir...). Parfois, il
m'arrivait même de refuser une sortie ou une invitation pour me retrouver seul ainsi, pour renouer avec les
sensations de mon enfance, savourer encore un peu le goût de l’ennui. Le reste du temps il y avait la vie banale
d'un étudiant de la Sorbonne, emporté dans le tourbillon du Quartier Latin, partagé entre les interminables
queues dans les restaurants universitaires, les joyeuses empoignades à l'entrée des amphithéâtres et les heures
de silence dans la chaleur humide de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et puis il y avait ma vie aux Trois
Masques, qui remplissait mes soirées et mes nuits : les fous rires, les conversations à n’en plus finir, les heures
passées dans des cafés ou dans des cabarets. Mes amis étaient géniaux, ça ne faisait pas le moindre doute, ils
étaient tous hors du commun : Paul, Christian, Danièle, la grosse Annie, la ravissante Françoise fine et
précieuse comme une porcelaine et le petit Bob que nous prenions pour Rimbaud. Je les aimais, je les admirais
et parmi eux je me sentais reconnu. Mais cela ne me suffisait pas encore. Sait-on jamais ! tout ça pouvait
s’envoler d’un seul coup et alors !… Alors, pour faire bonne mesure, comme ces anciens pauvres qui ne
peuvent se défaire de la peur de manquer, je me précipitais sur tout ce qui passait à portée de ma main. C'est
ainsi que j'allais frapper à la porte d'une troupe de théâtre qui avait son siège sous les combles de la Sorbonne et
qui s'appelait le G.L.M. (Groupe des Lettres Modernes ). On y montait quand j’arrivai deux petites pièces en un
acte. L’une était de Rousseau, l’autre de Marivaux. Aussitôt on me confia un rôle (je faisais toujours mon petit
effet quand j’arrivais dans une troupe de théâtre grâce aux cours de madame Favart et à ses fameux exercices :
Petit pot de beurre, quand te dé-peutit-pot-de-beurreriseras-tu ?…) Cette troupe, dans laquelle je ne fis qu'un
passage éphémère, étaient dirigée par deux étudiants qui s'y partageaient un pouvoir mal assuré. L'un,
boutonneux et un peu précieux, ressemblait lui-même à un personnage de Marivaux, l'autre grave et
lymphatique, réglait la mise en scène d'une main molle. Le tout aboutit à une pâle représentation dont je n'ai
guère de souvenir.
Mais cela ne suffisait pas encore. Mon rêve, depuis longtemps, c’était de faire partie du Théâtre Antique de la
Sorbonne. J’avais assisté à une représentation des Perses lors de mon premier séjour à Paris et j’en avais été
fort impressionné. Aussitôt j’avais voulu aller m’y présenter mais, parvenu devant la porte, j’avais entendu de
l’autre côté des clameurs dignes de Mounet-Sully et j’étais reparti en vitesse sans demander mon reste. Cette
fois, armé d'un courage inébranlable, j’étais décidé à aller jusqu'au bout, d'autant qu'une affiche, à l'entrée de la
bibliothèque, indiquait la date d'une audition destinée à engager de nouvelles recrues. Au jour dit, j'arrivais
donc tout palpitant d’émotion. Il y avait déjà beaucoup de monde dans la salle, des nouveaux comme moi, pour
la plupart. On nous expliqua qu'il s'agissait de monter les Choéphores et le metteur en scène, un petit homme
rondouillard, un plus âgé que nous et qui parlait avec autorité nous expliqua des choses compliquées sur
l’histoire des Atrides auxquelles je ne compris rien mais qui me parurent très profondes (je n’avais jamais lu les

Choéphores). Cependant je me rendis compte au bout d’un moment que ce metteur en scène n’était pas le
véritable directeur de la troupe mais qu’il avait été engagé simplement pour monter ce spectacle. Le vrai chef
du Théâtre Antique, c’était un jeune homme qui pouvait avoir à peine quelques années de plus que nous et se
tenait un peu en retrait pendant toute cette conférence. Un peu plus tard il vint s’adresser à moi pour me
demander qui j’étais. Il avait une belle voix grave et quelque chose d’excessivement courtois dans son
comportement en même temps qu’un peu froid. C’est ainsi que je fis la connaissance de Jean-Pierre Miquel. Je
me gardai bien de lui dire que j'avais déjà fait du théâtre ni que je dirigeais ma propre troupe, j’en serais mort
de honte ! Il m’inspira dès ce premier jour une grande admiration, mêlée de respect. Je crois d’ailleurs qu’il en
imposait à tous et trouva plus tard sa véritable place quand il devint administrateur de la Comédie Française.
Mais il y avait aussi d’autres jeunes gens autour de lui non moins impressionnants, des anciens, pleins
d'assurance eux aussi, qui étaient venus pour observer les nouveaux venus, d'autant que le groupe, rompant
avec la tradition qui était la sienne depuis le début, telle que l’avait imposée son fondateur Roland Barthes et
que justifiaient selon lui les usages de la Grèce ancienne, avait décidé cette année-là d’ouvrir pour la première
fois ses rangs aux femmes. Parmi les nombreuses jeunes fille présentes, venues postuler pour un rôle un rôle ou
une place dans le choeur, une blonde aux cheveux longs et au visage d'ange avait tout de suite attiré mon
attention. Depuis le début je guettais une occasion de lui parler mais cette occasion comme de bien entendu ne
se présenta pas de toute la soirée et lorsque je repartis, j’avais eu certes la satisfaction d’être pris dans le Chœur
mais je gardais en moi un sentiment d’échec de n’être pas arrivé à entrer en contact avec elle. Cependant, en
descendant la rue Saint-Jacques pour rejoindre le boulevard Saint-Michel, ne voilà-t-il pas que je l’aperçois qui
marche derrière moi ! Est-ce tout à fait un hasard ? Je ralentis le pas et la laisse arriver à ma hauteur. « - Alors ?
Comment as-tu trouvé ?… » (j’admire mon courage et cette désinvolture avec laquelle je me permets de la
tutoyer). Elle vient elle aussi pour la première fois, me parle de sa timidité : il lui a fallu, me dit-elle, beaucoup
de courage pour affronter ce groupe où elle ne connaissait personne... L'idée qu'une créature aussi sublime
puisse éprouver quelque chose qui ressemble à de la timidité et me le confie à moi, me paraît tout à fait
invraisemblable. Le plus probable est qu’elle se moque de moi. J'en tombe aussitôt amoureux.
Le Théâtre Antique devait prendre dans ma vie une importance au moins égale à celle des Trois Masques. Les
répétitions commencèrent dès la semaine suivante. Ma ravissante blonde était là. Ses cheveux en cascade, ses
yeux si bleus, son regard languissant me firent le même effet que la première fois et en plus je bénéficiais d’un
avantage grâce à la complicité qui s’était déjà ébauchée entre nous. Spontanément nous nous reparlons. Sa
présence me réchauffe l'âme. Nous repartons ensemble. L’habitude viendra vite, après chaque répétition de
repartir ensemble. Cependant, une fois cette étape franchie je ne sais pas comment faire progresser mes affaires,
et entre temps, au fil des jours, j’ai fait la connaissance d'autres membres du groupe, des nouveaux comme moi,
en particulier un étudiant en architecture aux cheveux crépus, aux sourcils broussailleux qui semble totalement
égaré ce qui constitue entre nous un point commun. Nous communions dans la même admiration pour la
ravissante blonde, admiration que nous nous sommes avouée réciproquement le premier jour, mais
contrairement à ce qu’il en est chez moi elle ne semble pas tenir pour lui la première place dans ses
préoccupations, son principal souci étant, me dit-il, la place qu'il parviendra à obtenir dans cette troupe et qu’il
espère bien être le premier. C’est un ambitieux et il me parle de son ambition un naturel confondant. Il est
certain de réussir, me dit-il, parce qu’il est convaincu de son talent. Il l’affirme avec une sorte de fausse naïveté
provocatrice qui cache mal une véritable naïveté affligeante. Ah ! s’il suffisait de croire à quelque chose pour
qu’elle soit vrai! Quant à moi je ne nourris aucune illusion sur mon sort. Ma seule ambition serait de séduire ma
ravissante blonde mais je ne sais pas comment m’y prendre. Et puis comment espérer qu’elle s’intéresse à moi
? Nous avons cependant de longues conversations ensemble, qui me ravissent : je lui raconte mon passé. À elle
j’ai osé confier ma carrière théâtrale et que je suis moi-même en train de monter un spectacle avec une troupe
que je dirige personnellement. Il me semble qu’elle m’admire, en tous cas qu’elle a de la sympathie pour moi.
Décidément, jamais de toute ma vie les choses ne sont allées aussi fort ! Des amies, des sorties, des projets, des
idées… Quelle différence avec l’année dernière ! Il me semble que cela remonte à des siècles. Quant à mes
parents, ils ont enfin trouvé un appartement, entre les Halles et le Marais où nous sommes allés nous installer à
Pâques. Les tableaux de mon grand-père, les meubles et les objets de famille ont réintégré leur place. Ma mère
a dû vendre ses bijoux et mon père souscrire un emprunt dont il ignore comment il le remboursera pour payer
cet appartement, mais enfin advienne que pourra, pour l’instant nous sommes sauvés !…
Le quartier des Halles était misérable à l'époque : des ruelles aux pavés gras, des façades décrépies. J'aimais la
perspective de ces rues étroites où les maisons se penchent les unes vers les autres, les trottoirs jonchés de
détritus sur lesquels dormaient des clochards. Chaque fois que je rentrais à la maison je guignais les prostituées
qui stationnaient à l'angle de la rue aux Ours. J‘avais fini par les connaître, c’était toujours les mêmes : la
grosse, avec sa poitrine laiteuse mal contenue dans un fourreau de cuir noir, la toute jeune avec ses cheveux
raides et ses jambes maigres comme des allumettes (elle se tient à l'écart, toujours sur le même coin de trottoir,
figée comme un mannequin), et puis l’horrible vieille qui porte des lunettes raccommodée par un bout de
sparadrap. À l’endroit où elle se tient il y a une plaque de marbre qui indique l’emplacement où Nerval a été

retrouvé mort.
J'aimais Paris, je l’aimais comme un fou. Le plateau Beaubourg, envahi par les cadavres de voitures, balayé en
hiver par un vent glacé, les camions des halles envahissant la rue Saint-Denis et les rues adjacentes au milieu
des clameurs, du fracas des cageots de légumes et de fruits dans la buée des petits matins… Là-bas, pendant ce
temps, mon pays n’en finissait pas d’agoniser. Après l'échec du putsch c'était la politique de la terre brûlée. On
tuait, on détruisait, les Facultés pillées, incendiées. Je m'en fichais, je n'étais plus concerné. Le massacre de la
rue d'Isly – « - Halte au feu ! Halte au feu !… » - je ne voulais plus en entendre parler. J’étais ailleurs, je m'en
étais sorti. Personne ici ne s'expliquait l'acharnement que les gens là-bas mettaient à tout détruire avant de s’en
aller. Moi seul je savais. Ça s’appelle l’amour ça, vous ne comprenez donc pas ? ça s’appelle le désespoir. On
irait jeter son frigidaire par dessus la rambarde du Boulevard avant de s’embarquer dans le premier bateau
venu, on ferait brûler sa voiture sur le bord du trottoir et puis basta ! chao et merci ! Pas un ne resterait, pas un
seul. Comment leur faire comprendre ça, ici ? Je pensais à Miliana, à la douceur de la lumière sous les platanes
de l'avenue Saint-Pierre, au cinéma en plein air où l’on jouait Pour qui sonne le glas, à la piscine où l'on dansait
sur les chansons de Georges Ulmer. Qui se souviendrait désormais de Maison-Carrée ? qui se souviendrait
d'El-Biar et de son équipe de football qui avait réussi à éliminer le stade de Reims en coupe de France ? Oui
j’étais bien heureux, je m’en étais sorti.
NB: Si vous avez raté un épisode, vous pouvez reprendre le feuilleton dans son déroulement depuis le début en
cliquant sur la rubrique: "Le roman d’un homme heureux" (Feuilleton autobiographique de Pierre Parlier)
Vous pouvez lire les commentaires et ajouter le votre sur le format parchemin du site internet.
1
/
3
100%