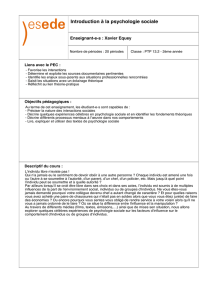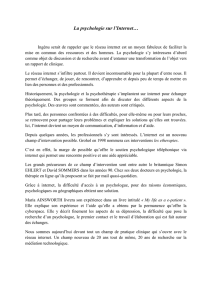la naissance d`une «conduite à la française » : de ribot

La Naissance d’une « conduite à la française » :de Ribot
à Janet
Alejandro Dagfal
Résumé - Si l’on a affirmé l’apparition d’un « inconscient à la française » à la fin
du XIXe, comme une « géographie particulière de l’irrationalité » (issue entre
autres choses de la confluence des conceptions de la race, de la dégénérescence,
des foules, de l’hérédité et de l’hypnose), on pourrait postuler qu’en France la
psychologie scientifique naquit justement comme la contrepartie rationnelle de
ce déclenchement de forces venues des profondeurs. Son objet, la conduite,
porta les traces de cette irruption, et la conscience, presque comme formation
réactionnelle, ne pouvait être absente de cette discipline nouvelle. D’une part,
elle était la réassurance de rationalité qui permettait de garder la foi dans
l’esprit des lumières, malgré le surgissement des incertitudes de la modernité.
D’autre part, elle était l’héritière d’une tradition de pensée, philosophique mais
aussi littéraire, qui avait toujours mis en relief la subjectivité, entendue comme
un espace intime irréductible. Ainsi, nous essayerons de montrer comment et
pourquoi « la conduite à la française », de Ribot à Janet, différait de son cousin
le plus célèbre : le behavior des Américains. À la différence des États Unis, la
« conduite à la française » aura toujours un composant subjectif, bien que les
méthodes proposées pour l’aborder aient des prétentions d’objectivité et
qu’elles soient nommées « expérimentales ».
histoire de la psychologie / conduite / behavior / France / États Unis
Summary – The birth of a “French-style behavior”, from Ribot to Janet. If it
has been argued that the “French-style unconscious” appeared at the end of the
19th century as a “particular geography of irrationality” (issued, among other
things, from the confluence of the conceptions of race, degeneration, masses,
heredity and hypnosis), we could add that in France scientific psychology was
born precisely as the rational counterpart of that release of unknown forces. Its
object, la conduite as well as le comportement, had the traces of this outbreak, and
the conscious, almost like a reactive formation, could not be absent from this
new discipline. On the one hand, scientific psychology was the rational
reassurance allowing to keep faith in the spirit of enlightenment. On the other
hand, it was the inheritor of a thought tradition –philosophical as well as
literary– , that had always underlined subjectivity, understanding it as an
irreductible intimate space. Thus, we will attempt to show how and why
“French-style behavior”, from Ribot to Janet, differed from its most famous
relative, American-style behavior. As opposed to the United States, French-style
behavior would always have a subjective component, even if the methods
proposed to deal with it had aspirations to objectivity and were supposedly
“experimental”.

history of psychology / conduite / behavior / France / United States
La psychologie objective française: la conduite et the behavior
Entamer une étude des diverses définitions du concept de conduite
dans le discours psychologique implique d’une certaine manière de faire
une recherche des différentes formes dans lesquelles l’objet de la
psychologie à été défini pendant une bonne partie du siècle dernier. Sans
aucun doute, ce terme a été privilégié au moment d’établir les limites du
champ disciplinaire. Néanmoins, sa portée sémantique ne fut absolument
pas univoque –comme pourrait le suggérer à présent son indéniable filiation
avec le béhaviorisme américain–. Elle renvoyait plutôt à une pluralité de
courants de pensée dans lesquels sa signification variait de manière
considérable à partir de son inscription dans des traditions souvent
opposées et de son articulation avec des termes théoriques tout à fait
hétérogènes à celui de behavior, dans son acception la plus classique –et la
plus étroite– du fameux manifeste watsonien.
Le concept de conduite fut utilisé en psychologie animale dès la fin du
XVIIIe siècle, probablement transposé de la chimie et de la biologie
(Jennings, Von Uexküll, etc.) aussi bien que de la physiologie (Huxley). Mais
indépendamment de l’utilisation du terme, on peut affirmer que la tendance
à objectiver les faits psychologiques dans le cadre des sciences naturelles ne
put se consolider qu’à partir des théorisations darwiniennes autour de
l’adaptation des organismes au milieu et de la continuité évolutive entre les
animaux et l’homme. Déjà en 1863 le physiologiste russe Séchenov
prétendait que la cause initiale de toute activité se trouvait toujours dans un
stimulus sensoriel extérieur et non pas dans la pensée. En 1903, Pavlov (qui
sans être disciple de Séchenov avait lu son œuvre), postula l’existence de
réflexes conditionnés, et tenta de rendre compte des conduites humaines en
termes strictement relatifs au système nerveux et aux réflexes. C’était le
début du déclin de plus de deux siècles monopolisés par l’étude presque
exclusive de la conscience, du moi, de la perception, des états mentaux, de la
sensation ; c’est-à-dire, de l’expérience subjective définie comme immédiate.
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ailleurs qu’en Russie, on
peut trouver cette tendance objectiviste incarnée dans au moins deux
traditions psychologiques relativement indépendantes, situées dans les deux
marges de l’Atlantique. D’un côté, aux États Unis, se produisit la célèbre
« révolution béhavioriste » menée par John Watson (avec son fameux
manifeste de 1913 : « Psychology as the behaviorist views it »). En revanche, de
l’autre côté (et sur l’autre côte), se développa en France une « psychologie
scientifique » qui formula aussi des principes théoriques et méthodologiques
qui seront plus tard reconnus erronément comme des inventions
exclusivement nord-américaines
i
.
Aux États Unis, la récusation de la conscience et de l’introspection
commença avec le fonctionnalisme pragmatique de William James [1]. En

1884, il publia un article où il montrait combien était inutile d’essayer de
saisir le flux de la conscience par le biais de l’introspection [2]. En 1904, il
publia un autre travail dont le nom est auto-évident : « Est-ce que la
conscience existe ? » [3]. Au début du XXe, la psychologie de conscience et
l’introspection étaient remises en question par plusieurs théoriciens de
renommée. D’abord, par les fonctionnalistes, depuis James jusqu’à McKeen
Cattell et Angell. McKeen Cattell avait été cofondateur du Psychological
Review, et Angell fut nommé président de la puissante American Psychological
Association (APA) en 1907. Tous les deux avaient exprimé leur réticence à
définir la psychologie comme science de la conscience, et proposaient
l’utilisation de méthodes objectives [4]. Si l’on considère aussi l’approche
comportementale de la psychologie animale de Thorndike [4] ou de Yerkes
[5], on devrait conclure que, en 1913, la conception objective de Watson
n’impliquait alors aucune nouveauté révolutionnaire. Seulement il prit une
position claire et radicale dans un contexte de crise disciplinaire, et sut se
faire reconnaître comme le fondateur d’une tradition qui le précédait.
En France, la « tendance objective » en psychologie commença
symboliquement avec les fameuses critiques d’Auguste Comte à l’égard de
l’introspection : l’œil ne peut se voir lui-même. Cependant, elle ne se
concrétisa qu’avec Théodule Ribot ; philosophe de vocation positive,
spencérien convaincu, il était à la fois le continuateur de Jean Martin
Charcot et d’Hyppolite Taine, bien qu’ils eussent été ses contemporains. De
Charcot, il prit et systématisa la tradition psychopathologique qui remontait
à Claude Bernard, voyant en la maladie une expérimentation de la nature
qui servait à expliquer la normalité. De Taine, il prit son intérêt pour l’étude
scientifique de l’intelligence et sa volonté de détacher la psychologie des
spéculations métaphysiques de la philosophie spiritualiste. Sur le plan
théorique, comme on le verra plus loin, il s’appuya sur la psychologie
anglaise et la psychologie allemande, introduisant en France les travaux de
Spencer, de Stuart Mill et de Galton, aussi bien que ceux de Fechner et de
Wundt. D’après Roudinesco, « l’œuvre de Ribot est semblable à une
‘passoire’. Elle forme un creuset où se retrouvent tous les courants
scientifiques, théoriques et idéologiques d’une époque [7]. » Sur le plan
institutionnel, en 1878, il fonda la Revue Philosophique de France et de
l’Étranger, première publication française consacrée à la nouvelle
psychologie. En 1885, il créa, avec Charcot, Paul Janet et Charles Richet la
Société de psychologie physiologique et, finalement, en 1888, il fut nommé
titulaire de la chaire de Psychologie expérimentale et comparée au Collège
de France. En somme, il se fit reconnaître comme le fondateur de la
psychologie scientifique française.
Néanmoins, force est de dire que les contextes de développement des
ces deux traditions « objectives » furent radicalement différents. Aux États
Unis, la psychologie était une discipline solidement installée et même plus
importante que la philosophie ou la médecine, dont l’organisation
professionnelle était plus récente
ii
. En fait, la psychologie, comme profession
autonome, fut une invention américaine. Le personnage du psychologue, tel
qu’on le connaît aujourd’hui, naquit aux États Unis, avec les premiers cursus

spécifiques dans la matière, voilà pourquoi la première association
professionnelle de psychologues fut l’American Psychological Association
(APA), fondée en 1892. En revanche, la première formation universitaire
« moderne » en médecine ne fut inaugurée qu’un an plus tard, en 1893, et
l’association de philosophes fut créée en 1901 (curieusement comme
dégagement de l’APA, qui était l’association mère). Le système universitaire
américain devait être construit de toutes pièces, sans que l’Etat fédéral jouât
un rôle très important, car il ne finançait qu’une partie minuscule de cette
construction. La portion la plus grosse fut apportée par les particuliers,
notamment par certains « philanthropes » tels que Jane Stanford, John
Hopkins, David Rockefeller, etc. Ainsi, il fut naturel que leurs bailleurs de
fonds gardassent un droit de regard sur l’enseignement et les recherches.
Une bonne partie des décisions et des ressources pour le développement des
universités restèrent dans les mains de quelques hommes d’affaires, des
businessmen et des entrepreneurs qui symbolisaient mieux que personne la
« générosité » du rêve américain. Loin des soucis philosophiques, ceux-ci
étaient des individus qui agissaient selon leurs propres intérêts
commerciaux, étant prêts à financer la recherche dans une discipline capable
de leur donner des réponses pratiques pour les problèmes posés par le
développement économique, tels que la formation professionnelle, les
relations industrielles, les habitudes des consommateurs, etc. C’est en raison
de cela que dans la psychologie américaine les courants visant à constituer une
technologie d’intervention s’imposèrent assez rapidement sur ceux qui
aspiraient à devenir de vraies disciplines de connaissance. En France, en
revanche, la situation paraissait toute autre. La psychologie n’était guère la
discipline professionnelle et autonome qu’elle était devenue aux États-Unis.
Comme en Allemagne, elle était plutôt la sœur cadette de la philosophie, ou
la parente pauvre de la psychiatrie. En tout cas, elle se débattait pour se
différencier de deux champs consolidés ayant une longue histoire
académique. L’université étant un symbole de la civilisation française, elle
faisait partie d’une tradition républicaine et laïque, selon laquelle la
responsabilité de la formation des citoyens incombait principalement à
l’État. Ainsi, les professeurs étaient soigneusement choisis et recrutés, car
d’une certaine manière ils étaient les gardiens de la République. C’est
pourquoi une fois nommés à leurs postes ils jouissaient d’une grande
autonomie et d’une stabilité relativement importante. Le champ académique
organisé et financé par l‘État, en son ensemble, était à l’abri des intérêts des
corporations. La production de la connaissance était validée soit par les
collègues consacrés, soit par les nécessités de l’État en quête du « bien
commun », mais jamais par des propriétaires des ressources économiques.
D’après Roudinesco,
Les psychologues français sont avant tout des lettrés, mandarins,
académiciens, titulaires de chaires, médecins, juristes ou philosophes.
Ils enseignent un savoir qui a d’emblée l’allure d’une parole
d’évangile. Ils sont doctrinaires, efficaces, soucieux de leur carrière,

imbus de leur notoriété et persuadés par-dessus tout que l’intelligence
française désigne l’essence même de toute intelligence ([7], p. 229).
D’autre part, dans le champ intellectuel, à cette époque-là, Henri
Bergson avait commencé sa tâche de démolition du positivisme. Autour de
1905, la nouvelle philosophie contenue dans sa thèse sur Les données
immédiates de la conscience, de 1889, devint à la mode dans les salons
parisiens. En outre, ses cours au Collège de France attiraient de vraies foules
[9]. Le philosophe connaissait la gloire de son vivant, grâce à une conception
qui mettait en valeur l’irréductibilité de la conscience à la schématisation
mathématique propre des sciences naturelles, et qui s’appuyait sur
l’intuition comme méthode d’accès à l’espace intime. D’un seul coup, il
récusa tout les supposés théoriques sur lesquels s’était fondée la psychologie
à partir de Fechner et de Wundt : il n’était pas possible de mesurer les
sensations sans perdre ce qu’elles avaient d’essentiel. En même temps, le
cousin de son épouse, Marcel Proust –quoique de manière indépendante–,
donnait à sa philosophie une expression littéraire et romanesque. À la
recherche du temps perdu, dont le premier volume parut en 1913, fut un
exemple réussit des conceptions bergsoniennes. La longueur capricieuse de
ses phrases rappelait que la durée pure de la conscience, débordant les
règles de la grammaire, n’avait rien à voir avec le temps conventionnel des
horloges. La richesse de ses évocations montrait également l’impossibilité de
saisir la complexité de l’expérience subjective avec les catégories réductrices
de la science.
Il est évident que, dans ce contexte, la psychologie française, pour
objective qu’elle fût, ne pouvait pas ressembler autant à la psychologie
d’outre Atlantique. Dans le pays de Descartes, la possibilité de décréter tout
simplement –comme Watson l’avait fait–, la mort de la conscience n’était
même pas pensable. Du reste, aux États-Unis, les successeurs de Watson, les
néo-béhavioristes, durent la faire revivre quelques années plus tard sous les
formes de l’intentionnalité et de la signification de la conduite.
De la méthode pathologique à la psychologie de la conduite
Revenons maintenant à la tradition scientifique française. Théodule
Ribot, en inaugurant la nouvelle psychologie, notamment comme
psychologie pathologique, fit un choix lié aux problèmes de son temps et de
son contexte. La médecine étant le prototype de la scientificité déifiée par le
positivisme, avec ses découvertes expérimentales, lui offrait aussi les
fondements biologiques dont la psychologie avait tellement besoin pour
échapper aux obscurités de l’éclectisme. Vis-à-vis d’une psychologie
philosophique, quelle meilleure issue qu’une alliance avec la psychiatrie de
base physiologique, parfaitement compatible avec l’évolutionnisme
régnant et jouissant encore de la gloire de l’aliénisme pinelien? Les
conséquences de ce choix caractériseront dorénavant la discipline en France,
qui aura toujours une dépendance marquée par rapport au modèle médical
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%


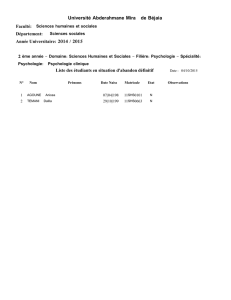

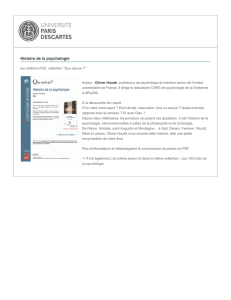
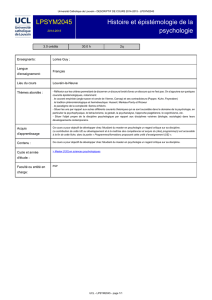
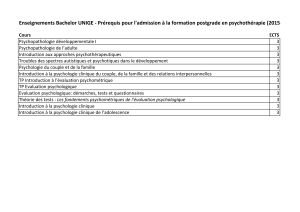
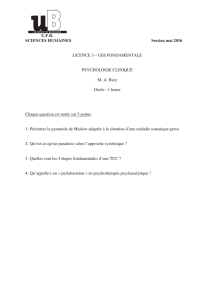
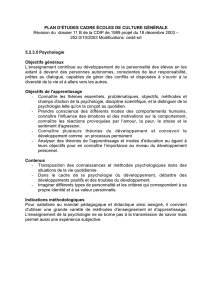
![Fiche projet n 2 [ PDF - 370 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008469253_1-179f3cc09c20e1657d654cc261bce6c5-300x300.png)