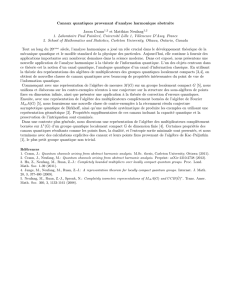REPR´ESENTATIONS DES GROUPES ALG´EBRIQUES ET

REPR´
ESENTATIONS DES GROUPES ALG´
EBRIQUES
ET ´
EQUATIONS FONCTIONNELLES
(COURS DE TROISI`
EME CYCLE,DEUXI`
EME NIVEAU, 2008/2009)
J. Sauloy 1
11 d´
ecembre 2009
1Institut math´
ematique de Toulouse et U.F.R. M.I.G., Universit´
e Paul Sabatier, 118, route de Narbonne,
31062 Toulouse CEDEX 4

R´
esum´
e
Le but du cours est de donner le minimum de connaissances sur les repr´
esentations des groupes
alg´
ebriques lin´
eaires complexes qui permette de d´
efinir le groupe de Galois d’une ´
equation diff´
erentielle
ou aux q-diff´
erences analytique. On prouvera la partie facile du “th´
eor`
eme de Tanaka” et on ad-
mettra l’autre partie, que l’on appliquera `
a des exemples int´
eressants en th´
eorie de Galois.
Contenu du cours :
– Cat´
egories et foncteurs
– G´
eom´
etrie alg´
ebrique affine
– Groupes alg´
ebriques lin´
eaires
– Comment reconstruire un groupe alg´
ebrique `
a partir de la cat´
egorie de ses repr´
esentations.
– Compl´
et´
e proalg´
ebrique d’un groupe.
– La correspondance de Riemann-Hilbert et le groupe de Galois.
Bibliographie :
1. Ahlfors L. : Complex Analysis
2. Borel A. : Linear Algebraic Groups.
3. Deligne P. and Milne J. S. : Tannakian categories in L.N.M. 900
4. Douady R. et Douady A. : Alg`
ebre et th´
eories galoisiennes.
5. Springer T. A. : Linear Algebraic Groups
Le r´
esum´
e ci-dessus reproduit la pr´
esentation du cours telle qu’elle figurait sur le site “Ensei-
gnement” du d´
epartement de math´
ematiques. Je ne pr´
etends pas que ce (vaste) programme soit
r´
ealisable. Le v´
eritable plan du cours et la v´
eritable bibliographie apparaissent plus loin!!!
Outre le cours polycopi´
e, les documents suivants ont ´
et´
e distribu´
es aux ´
etudiants :
– Le premier chapitre de mon cours de DEA de 2004-2005; ce chapitre porte sur le prolon-
gement analytique et la correspondance de Riemann-Hilbert.
– Des feuilles d’exercices de g´
eom´
etrie alg´
ebrique de M1.
– Le chapitre de g´
eom´
etrie alg´
ebrique d’un cours de L3 sous la direction de Jean-Pierre Ramis
et Andr´
e Warusfel, ´
edit´
e chez De Boeck.
– L’appendice de ma th`
ese portant sur le calcul ´
el´
ementaire de l’enveloppe proalg´
ebrique de
Z.

1

Table des mati`
eres
I Les bases 5
1 En guise d’introduction : groupe(s) attach´
e(s) `
a une ´
equation diff´
erentielle. 6
1.1 ´
Equations diff´
erentielles lin´
eaires analytiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1 Le faisceau des solutions de (1.1.0.1) sur X0................ 7
1.1.2 Le faisceau Fest un syst`
emelocal..................... 7
1.2 Exemplesbasiques ................................. 8
1.2.1 Les “caract`
eres” .............................. 8
1.2.2 Lelogarithme................................ 10
1.3 Retour au formalisme g´
en´
eral............................ 11
1.3.1 Le principe de monodromie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 La repr´
esentation de monodromie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 La th´
eorie de Galois diff´
erentielle ......................... 14
1.4.1 La th´
eorie de Picard-Vessiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.2 La dualit´
etannakienne........................... 17
2 Cat´
egories, foncteurs, ´
equivalences, limites, produit tensoriel 18
2.1 Cat´
egoriesetfoncteurs ............................... 18
2.1.1 Cat´
egories ................................. 18
2.1.2 Foncteurs.................................. 20
2.1.3 ´
Equivalences de cat´
egories......................... 22
2.2 Probl`
emesuniversels ................................ 23
2.2.1 Limites inductives (direct limits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.2 Limites projectives (inverse limits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.3 Le produit tensoriel : rappels et compl´
ements............... 26
3 Repr´
esentations lin´
eaires de groupes, enveloppe proalg´
ebrique 28
3.1 Repr´
esentations lin´
eaires.............................. 28
3.1.1 Repr´
esentations de Get K[G]-modules................... 29
3.1.2 Repr´
esentations de Z............................ 30
3.2 Quelques questions de classification (effleur´
ees).................. 31
3.2.1 Vocabulaire de la classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.2 Repr´
esentations compl`
etement r´
eductibles................. 33
3.2.3 Repr´
esentations des groupes ab´
eliensfinis................. 34
3.3 Premi`
ere approche de la dualit´
e........................... 35
3.3.1 Peut-on reconstituer G`
a partir de RepK(G)?............... 35
2

3.3.2 Produit tensoriel de repr´
esentations .................... 37
3.3.3 Enveloppe proalg´
ebrique d’un groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4 Rappels et compl´
ements de g´
eom´
etrie alg´
ebrique affine 40
4.1 Ensembles alg´
ebriquesaffines ........................... 40
4.1.1 La topologie de Zariski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.1.2 Correspondance entre ferm´
es et id´
eaux .................. 41
4.1.3 Lenullstellensatz.............................. 43
4.2 Fonctions r´
eguli`
eres................................. 44
4.2.1 Fonctions r´
eguli`
eres, alg`
ebresaffines ................... 45
4.2.2 Dimension d’un ensemble alg´
ebrique ................... 46
4.2.3 Qu’est-ce intrins`
equement qu’un ensemble alg´
ebrique? . . . . . . . . . 47
4.3 La cat´
egorie Af fK................................. 50
4.3.1 Morphismes ................................ 50
4.3.2 Aspects topologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3.3 Produits d’ensembles alg´
ebriques ..................... 54
II La suite 56
5 Groupes alg´
ebriques affines (th´
eorie ´
el´
ementaire) 57
5.1 Groupes dans une cat´
egorie............................. 57
5.1.1 Groupes et diagrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.1.2 Objetsengroupe .............................. 59
5.1.3 Groupes alg´
ebriquesaffines ........................ 61
5.2 Alg`
ebres de Hopf commutatives r´
eduites...................... 62
5.3 Groupes alg´
ebriques lin´
eaires............................ 64
5.4 Morphismes de groupes alg´
ebriquesaffines .................... 66
5.5 Action (ou op´
eration) d’un groupe alg´
ebrique affine sur un ensemble alg´
ebrique
affine ........................................ 68
5.5.1 Vocabulaire................................. 68
5.5.2 Approche topologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.5.3 Approche alg´
ebrique : la coaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.6 Tout groupe alg´
ebrique affine est lin´
eaire...................... 71
6 Repr´
esentations rationnelles d’un groupe alg´
ebrique 73
6.1 G´
en´
eralit´
es sur les repr´
esentations rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1.1 Repr´
esentations localement finies rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.1.2 La repr´
esentation r´
eguli`
ere......................... 75
6.2 Th´
eor`
eme de Tannaka et d´
ecomposition de Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2.1 Le petit th´
eor`
emedeTannaka ....................... 77
6.2.2 Rappels sur la d´
ecomposition de Dunford . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2.3 La d´
ecomposition de Jordan dans un groupe alg´
ebrique . . . . . . . . . . 81
6.3 Les th´
eor`
emesdeChevalley ............................ 82
6.3.1 La forme de base du th´
eor`
eme de Chevalley . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.3.2 Compl´
ements d’alg`
ebre multilin´
eaire ................... 83
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%