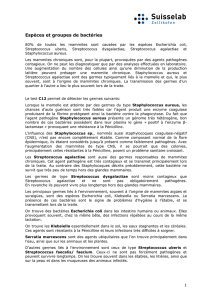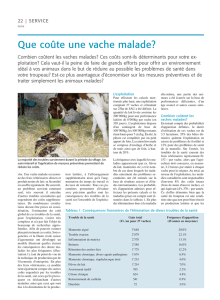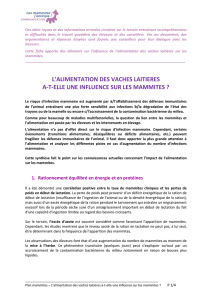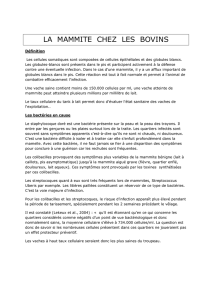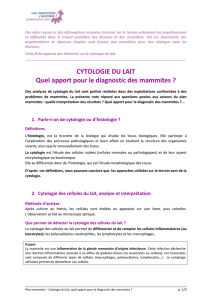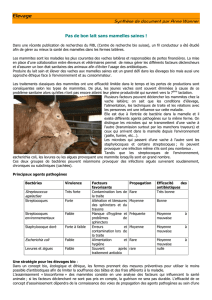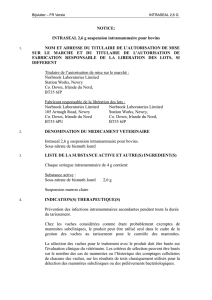Optimiser le traitement des mammites

herbivores
32 / 23-30 décembre 2011
Optimiser le traitement
des mammites
Lorsqu’on traite une mammite clinique sans
symptômes généraux, on a 9 chances sur 10
d’obtenir la disparition des grumeaux et de l’in-
fl ammation visible. Par contre, la disparition de
l’infection et un retour à la normale des comp-
tages cellulaires sont beaucoup plus aléatoires :
les chances de guérison bactériologique en
lactation varient de 50 % pour le staphylocoque
doré, à 70-80 % pour les streptocoques et
même à plus de 90 % pour les colibacilles.
Bien détecter les mammites cliniques
pour traiter immédiatement
Comme on ne connaît pas la bactérie respon-
sable de la mammite qui vient d’être détectée,
on traite en général par voie intra-mammaire
avec des médicaments contenant des antibio-
tiques à large spectre, c'est-à-dire susceptibles
d’agir aussi bien sur les colibacilles que sur les
staphylocoques ou streptocoques. Or, dès que
l’infl ammation devient importante, les condi-
tions de diffusion du médicament peuvent être
modifi ées : les canaux peuvent être obstrués
par des grumeaux et l’infl ammation modifi e la
nature du milieu. Sans compter que certaines
bactéries ont la capacité d’entrer et de persister
à l’intérieur des cellules et donc d’être à l’abri
de certains antibiotiques. La seule manière de
limiter ces inconvénients est de détecter les
Autant il est rentable de traiter rapidement
une mammite clinique sur une vache jusque là
saine, autant il est illusoire de vouloir guérir
en lactation une infection ancienne. Optimiser
les traitements passe donc par la qualité de la
détection, mais aussi par une bonne stratégie
de gestion des échecs de traitement.
par Marylise Le Guénic
Pôle herbivores
La détection des mammites cliniques
La méthode de référence reste l’observation systématique des
premiers jets dans un bol à fond noir. Elle a le mérite de détecter
rapidement les modifi cations du lait. En cas de doute, on peut
la compléter par la réalisation d’un CMT en fi n de traite, pour
vérifi er que les quelques grumeaux correspondent bien à une
infl ammation. La mesure de la conductivité permet aussi de repérer
les infections mammaires. Pour être fi able, elle doit reposer sur des
comparaisons entre quartier et entre traites et donc être intégrée au
système de traite informatisé. Les alertes doivent être validées par
l’observation du lait avant de déclencher un traitement de mammite
clinique.
Ce document provient de l’Agrithèque. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que dans le cadre de l’usage privé du
copiste ou après autorisation obtenue auprès des Chambres d’Agriculture de Bretagne.

herbivores 33
/ 23-30 décembre 2011
Que faire d'un quartier incurable
qui récidive sans cesse ?
Si on ne peut pas sortir la vache du troupeau, on peut être
tenté de tarir ce quartier pour limiter les traitements et la
contagion des autres vaches à la traite.
C’est possible à condition :
● De le faire en dehors d’une phase clinique.
● De surveiller attentivement, surtout les premiers jours et
de reprendre traite et traitement en cas d’infl ammation.
● De ne pas injecter de médicaments, si on souhaite livrer le
lait des trois autres quartiers (risques de résidus dans le lait
des trois autres quartiers, les médicaments pouvant passer
d’un quartier à l’autre via la circulation sanguine, selon des
règles de diffusion complexes).
● De ne pas injecter d’antiseptiques dans le quartier (risques
de résidus, voire risques pour la vache en cas d’utilisation de
produits caustiques). C’est bien l’arrêt de la traite qui tarit !
Mais, cela déséquilibre le faisceau trayeur d’où une dégra-
dation de la traite.Il s’agit donc d’une solution de secours, à
utiliser de façon occasionnelle.
Du registre des traitements
au protocole de soins
Enregistrer les traitements sur le registre des traitements
sanitaires permet de vérifi er l’effi cacité des traitements à posteriori.
Cela permet au vétérinaire prescripteur de réajuster le protocole
de soins au cours de la visite bilan sanitaire ou en cours d’année
si nécessaire. Ces obligations réglementaires sont donc aussi et
avant tout, des garants de l’optimisation des traitements.
Le vétérinaire fera le choix des molécules et
de la voie d’administration selon le profi l des
infections dans l’élevage.
Ce même traitement, dit
"de seconde intention"
doit être utilisé en cas de récidive dans le mois,
ou de rechute sur un quartier infecté (persis-
tance de comptages cellulaires élevés).
Savoir arrêter les frais
Les chances de guérison au troisième traite-
ment sont très faibles.
Au delà, elles sont quasiment nulles. Il est donc
possible, voire souhaitable, de ne pas traiter
après la deuxième récidive dans un quartier,
s’il n’y a que des signes locaux (dans tous les
cas, le lait modifi é ne doit pas être livré).
Il reste impératif de traiter immédiatement une
mammite avec des signes d’infl ammation de
la mamelle importants ou a fortiori avec des
signes généraux, tels que fi èvre ou abattement.
Mammites avec symptômes
généraux
En cas de mammites avec symptômes généraux (fi èvre, abattement),
le traitement a pour but essentiel de rétablir l’état général et de lutter
contre une éventuelle septicémie. L’éleveur ne se retrouve plus en face
d’un traitement de mammites, mais d’une maladie qui peut mettre
en quelques heures en danger les fonctions vitales de l’animal : cela
relève de l’urgence vétérinaire.
➤➤➤
mammites cliniques le plus tôt possible, pour
mettre en place immédiatement un traitement.
Respecter la prescription
Un traitement antibiotique ne doit jamais être
sous-dosé ou interrompu avant son terme.
Ceci pour éviter de sélectionner des bactéries
résistantes. Il faut donc respecter les doses,
fréquences d’administration et durée de traite-
ment prescrites, même s’il y a disparition des
signes cliniques avant la fi n du traitement.
Rappelons que la disparition des signes cli-
niques ne signifi e pas obligatoirement que la
bactérie ait été éliminée.
En cas d’échec ou de récidive,
changer de traitement
Inversement, notamment avec le streptocoque
uberis, il peut être normal d’avoir encore des
grumeaux au bout de 48 h de traitement : l’in-
fl ammation peut se poursuivre quelques jours
alors que les bactéries ont été détruites.
Cependant, on doit observer une amélioration à
48 h et une disparition des grumeaux à 5 jours.
Sinon, il faut changer de traitement : on choi-
sira alors un traitement adapté aux mammites
chroniques c'est-à-dire plutôt ciblé gram +
(staphylocoques et streptocoques) et souvent
de plus longue durée d’action.
Ce document provient de l’Agrithèque. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que dans le cadre de l’usage privé du
copiste ou après autorisation obtenue auprès des Chambres d’Agriculture de Bretagne.

herbivores
34 / 23-30 décembre 2011
Quand recourir aux analyses ?
La bactériologie permet de caractériser la (ou
les) bactéries présentes dans un échantillon.
Elle peut être, ou non, suivie d’un antibiogramme.
Ces examens sont coûteux et rarement indispen-
sables. Ils ne sont utiles que comme outils intégrés
dans un plan de lutte.
La bactériologie peut venir confi rmer l’analyse de la
situation vis-à-vis des infections mammaires. Elle
peut être remplacée ou précédée par des méthodes
moins onéreuses, comme, par exemple, les comp-
tages de staphylocoques dorés sur lait de tank, qui
donnent une estimation de la présence de cette bac-
térie.
L’antibiogramme consiste à mettre en contact la bac-
térie isolée avec des disques imbibés d’antibiotiques.
Le souci est qu'un antibiotique très effi cace dans
la boîte au laboratoire peut ne pas parvenir à dif-
fuser dans la mamelle en concentration suffi sante
jusqu’aux bactéries. Donc l’antibiogramme ne sert
pas à défi nir les traitements effi caces, mais les trai-
tements ineffi caces : si la bactérie est résistante dans
la boîte, elle le sera dans l’animal (sauf exception).
Il est rarement utile en matière de mammites.
On le mettra en œuvre en cas d’échecs répétés de
traitements apparemment bien conduits ou dans des
situations d’infections à staphylocoques dorés, résis-
tants aux pénicillines.
Dans tous les cas, ces analyses doivent être faites
sur du lait de quartier récolté dans des conditions
d’asepsie très rigoureuses (désinfection des trayons,
tube stérile, pas de contamination du tube au mo-
ment du prélèvement).
Vacciner les vaches laitières
contre les mammites ?
La vaccination a pour but de créer un premier contact
entre les antigènes portés par les bactéries patho-
gènes et le système immunitaire de l’animal, pour que
Faut-il traiter les vaches à cellules ?
Traiter les mammites subcliniques en lactation représente un coût et une
astreinte liés au traitement et à la non commercialisation du lait, qui ne sont
pas toujours rentabilisés par le bénéfi ce qu’on peut attendre du traitement.
Il est illusoire d’espérer la guérison d’une infection ancienne en lactation.
Par contre, il peut être judicieux de traiter, par voie locale ou générale, des
vaches nouvellement infectées, à condition de le faire avec des traitements
appropriés (autorisation de mise sur le marché avec indication "mammites
subcliniques") et dans le cadre du respect des prescriptions du vétérinaire.
La précocité du traitement augmente les chances de guérison, mais traiter
systématiquement les vaches, dont le comptage cellulaire individuel passe
au-dessus de 300 000 cellules par ml, conduirait à traiter des infl ammations
de courte durée à pathogènes mineurs (taux élevé de guérison spontanée).
On prendra donc plutôt comme repère une augmentation sur deux ou
trois contrôles. La réalisation d’un CMT permettra de repérer le quartier
infecté.
Les conditions de rentabilité d’un tel traitement sont :
●
le choix des vaches traitées (première ou deuxième lactation, infection
récente, CMT très positif),
●
l’existence de pénalités pour cellules,
●
un renforcement de la prévention pour éviter les ré-infections,
●
la réalisation du quota.
Il est particulièrement intéressant de le faire dans les situations où
l’éleveur jette du lait (dépassement de quota, tri des vaches leucocytaires,
poudre de lait pour les veaux). Le seul coût du traitement est alors celui
du médicament. Si les conditions de rentabilité ne sont pas remplies,
mieux vaut donc attendre le tarissement où les chances de guérison
sont supérieures (70 % pour le staphylocoque doré, plus pour les
streptocoques)
Optimiser le traitement des mammites
(suite)

herbivores 35
/ 23-30 décembre 2011
Pour en savoir plus :
Vous pouvez retrouver sur Synagri.com
les fi ches "Santé du troupeau" :
●
Traitement des mammites en lactation.
●
Traitement des vaches à
cellules en lactation.
●
Analyse de lait : bactério-
logie et antibiogramme.
●
Examen des premiers
jets.
L’ensemble du cahier
"Santé du troupeau" est
disponible auprès de
Madeleine Lefaucheur
(02 96 79 21 63).
Traitement des vaches à
Analyse de lait : bactério-
Examen des premiers
L’ensemble du cahier
"Santé du troupeau" est
Que penser des traitements alternatifs ?
La piste des huiles essentielles semble la plus prometteuse. Elles
peuvent avoir des effets sur les bactéries ou sur le système immunitaire.
Pour l’instant, les essais par voie intra-mammaire à l’aide d’huiles
essentielles, connues pour leurs effets sur les bactéries (bactéricide)
et autorisées en contact alimentaire, n’ont pas été concluants : le lait a
inhibé l’action bactéricide de ces huiles. D’autres pistes sont explorées.
L’homéopathie n’a pas fait l’objet d’évaluation scientifi que. En l’état actuel
des connaissances, les moyens les plus effi caces pour limiter le recours
aux antibiotiques pour le traitement des mammites restent la détection
et la mise en place précoce de traitement antibiotique par voie intra-
mammaire et la gestion rationnelle des échecs de traitement. On peut
cependant y adjoindre des traitements complémentaires tels que des
pommades décongestionnantes, de l’ocytocine pour obtenir une traite
complète ou des anti-infl ammatoires lorsque l’infl ammation est importante.
Traitements des mammites cliniques à partir d’un mélange
d’huiles essentielles : FRAB/GAB56 : Interbiobretagne. Résultats
d’expérimentations et de suivis techniques. Elevage bovin biologique.
Edition 2008.
Optimiser le traitement des mammites
(suite)
celui-ci développe des défenses spécifi ques (anticorps
notamment).
Les objectifs de la vaccination peuvent être de plu-
sieurs ordres : prévenir les nouvelles infections cli-
niques ou subcliniques, supprimer les infections
cliniques ou en réduire la gravité, réduire le niveau
cellulaire, réduire le nombre de traitement.
Mais la vaccination contre les mammites se heurte à
plusieurs diffi cultés majeures qui expliquent la diffi -
culté de mise au point de vaccins effi caces :
● les espèces et les souches bactériennes res-
ponsables de mammites sont très diverses.
Cette diversité s’observe souvent y compris à l’échelle
de l’élevage.
● les défenses immunitaires en matières de mam-
mites sont surtout non spécifiques, c'est-à-dire
qu’elles reposent surtout sur les leucocytes, et peu
sur les anticorps.
Un vaccin est actuellement autorisé
en France.
Il cible les infections à staphylocoques (staphylocoque
doré et staphylocoques coagulase négative) et les
infections à colibacille. Streptocoque uberis, un des
principaux responsables d’infection mammaire cli-
nique et subclinique n’est pas visé par ce vaccin.
Les résultats d’essais réalisés dans des troupeaux
confrontés à des antécédents d’infections mammaires
à staphylocoques ou colibacilles montrent une réduc-
tion du pourcentage de mammites cliniques et de
mammites subcliniques pendant les 130 premiers
jours de lactation, une réduction des comptages cel-
lulaires et du nombre de traitement.
Une des conditions d’effi cacité est d’avoir réalisé des
analyses bactériologiques préalables pour vérifi er la
prédominance des staphylocoques et/ou du colibacille.
Il est aussi impératif de respecter le proto-
cole de vaccination : trois injections sont néces-
saires à des délais précis par rapport au vêlage
et l’une par rapport à l’autre.Il faudra s’assu-
rer du respect de l’ensemble des précautions
d’emploi, y compris notamment pour l’utilisateur.
La mise en place et le suivi d’un protocole de vacci-
nation ne peuvent être faits que par le vétérinaire de
l’élevage.
La stratégie de vaccination doit obligatoire-
ment s’inscrire dans un plan de maîtrise global
des infections dans le troupeau. C’est une mesure
possible d’un plan d’action qui contribuera à la limi-
tation des infections. Ce ne peut pas être une mesure
isolée.
1
/
4
100%